Didier VAUDÈNE, Comme si c’était une fiction, revue ITER Nº3, 2024.
« Tu crois effacer le mot en le barrant. Ignores-tu que la barre est transparente ?
« Ce n’est pas la plume qui barre le mot mais les yeux qui le lisent », écrivait reb Taleb.[1]
Edmond Jabès
. comme si c’était une fiction. Ce point final, au commencement ? Cet espace, cette réticence, pourquoi cette feinte enfantine ? Un jeu ? Têtu taquin, te tais-tu en tous temps ? Il y a longtemps, j’avais entendu une émission radiophonique au cours de laquelle était évoquée la visite de Michelangelo Antonioni à Mark Rothko dans son atelier new-yorkais : « Vos tableaux sont comme mes films – ils ne parlent de rien… mais avec précision. »[2] À cause peut-être d’une qualité d’écoute médiocre (ou d’une mémoire trop inventive), j’ai longtemps cru avoir entendu ce que j’avais gardé en mémoire « … ils ne partent de rien… ». Qu’ils ne partent ou ne parlent de rien, le plus difficile, en matière de rien, n’est-ce pas encore la précision ?
Point de départ : non-avoir-lieu. Je laisse de côté l’empreinte accusative de la chose (rem, no-thing) qui façonne déjà rien. Autrement que rien. Non pas un néant d’être ou un rien de quelque chose, ou un quelque chose possible, seulement absent ou défaillant, mais : ce qui n’a pas lieu. Ne joues-tu pas avec les mots ? Mille négations et dénégations accumulées pourraient-elles t’éviter de faire être ce « ce » ? Comment pourrais-tu nommer « ce qui n’a pas lieu » sans d’abord « l’ » épingler comme ce « ce » – qui n’a pas lieu ? Moins que rien, dis-tu ? Pas même possible ? Comment serait-ce possible ? Ni possible (ou impossible), ni présence (ou absence), mais comme si. Comment, comme si ? Comme si c’était. Donc « c’ » était. Tu nous égares, tu tournes en rond et tu nous étourdis, tu te dédis et tu te contredis ! Lui donner lieu ? Tu n’y penses pas ! Comment pourrais-tu donner lieu à « ce » qui n’a pas lieu sans « le » perdre en tant qu’« il » n’a pas lieu (et d’abord, comment pourrais-tu perdre « ce » qui n’a même pas lieu ?) ? Est-ce si sûr si « c’ » était ? Si « la mort est un passage à rien »[3], crois-tu, en sens inverse, pouvoir revenir de l’oubli et de la mort, et nous donner à lire ou à entendre l’enchantement d’un « souffle autour de rien »[4] pour dire enfin ce que « c’ » était[5] ? Ton c’était ne passe pas, ce n’est pas un passage ; le rien ou la négation de l’avoir-lieu nihilise tout rapport et tout passage, et rien n’arrive par cette voie, car ce n’est même pas une voie, c’est sans issue, c’est une aporie !
Il n’y a point de départ, car ce n’est pas un commencement, ni une antécédence, encore moins une origine ou une nostalgie d’ex nihilo. Et « ce » ne vient pas avant, mais après. Après quoi ? Après comme si. Étrange chronologie : après comme si, c’était ! Oui, c’est cela, il n’y a c’était que depuis le comme si, une sorte de passé qui n’aurait jamais eu lieu et qui viendrait après, après coup, mais seulement comme si c’était une fiction. Pourquoi tiens-tu à ce point au non-avoir-lieu ? Ne penses-tu pas que beaucoup d’autres choses pourraient être approchées comme des fictions ? Beaucoup, oui. Mais, paradoxalement – vraiment ? –, c’est plus sûr de prendre appui sur ce qui n’a pas lieu. Tu plaisantes ! Tu dis d’abord que c’était vient après comme si, ensuite que ce que c’était n’a pas lieu, et maintenant que c’est sur ce qui n’a pas lieu que tu trouves un appui sûr, mais sur quoi, et sûr comment ? Non, je suis sérieux. Le chemin est peut-être plus long, car on évite de se laisser distraire par la hâte qui dérobe ce qu’on pressent ; mais cette ascèse théorique est un guide fidèle et fiable, inépuisablement patient et précis, quoique silencieux, qui ne laisse jamais en repos, une insomnie.
Je ne sais dire si tous les comme si sont comme celui-là, si tout comme si implique quelque fiction (dont il restera à préciser le sens en chaque occurrence). Je sais seulement montrer de quelle manière un certain comme si s’étaie d’une fiction, et en quel sens fiction s’y entend. Ce que je veux déplier ici peut se formuler très simplement : penser ou interpréter du non-avoir-lieu comme si c’était une fiction. Cette formulation d’allure assez anodine enveloppe un « ferment déconstructif »[6] quand on la comprend en sens inverse, c’est-à-dire quand on peut réinterpréter un agencement, éventuellement complexe (concept, structure, croyance, conviction, symptôme, théorie, discours, œuvre, etc.), comme si c’était une construction fictionnelle, corrélative d’un non-avoir-lieu qu’elle enveloppe pour l’abriter – peut-être parfois, comme son « objet » ou même son « fondement ». On trouvera donc ici deux usages de comme si, le premier quand on enveloppe un non-avoir-lieu dans une construction fictionnelle, le second quand on réinterprète un agencement comme si c’était une construction fictionnelle au premier sens (ce qu’on pourrait peut-être dire, au moins dans certains cas, la façon théorique du comme si). Pour autant, si le point de départ est du non-avoir-lieu, je ne pars pas de rien, loin s’en faut, et je voudrais montrer au contraire que l’analyse que je propose n’est qu’une moirure, une accentuation, une intonation particulière d’un motif transversal, à savoir l’articulation de plusieurs interprétations autour d’une médiation. Rien de surprenant, donc, au fil de ce cheminement, à recroiser parfois, peut-être seulement de manière allusive ou oblique, des problématiques qui hantent, si j’ose dire, les lieux du non-avoir-lieu et leurs entours : le supplément, le reste, le spectre, l’après-coup, l’originaire, la présence, le signe, l’objet a, le nœud borroméen, les fictions du droit, etc. – S’il vous plaît… dessine-moi un non-avoir-lieu !
I. Fiction
1. Un certain « comme si »
Dans L’Université sans condition, Derrida questionne « Que faisons-nous quand nous disons “comme si” ? » [USC 27] et envisage plusieurs possibilités. Est-ce, première possibilité, s’abandonner « à l’arbitraire, au rêve, à l’imagination, à l’hypothèse, à l’utopie ? » [USC 27], ou bien est-ce, « seconde possibilité », « [mettre] en œuvre certains types de jugements, comme par exemple ces “jugements réfléchissants” » de Kant [USC 27]. C’est la troisième possibilité qui donne toute son ampleur à cette indication d’un « certain “comme si” » :
Est-ce que, enfin, troisième possibilité, un certain « comme si » ne marque pas, de mille façons, la structure et le mode d’être de tous les objets qui appartiennent au champ académique qu’on appelle les Humanités, les Humanités d’hier ou celles d’aujourd’hui et de demain ? Je ne me hâterai pas pour l’instant de réduire ces « objets » à des fictions, à des simulacres ou à des œuvres d’art, en faisant comme si nous disposions déjà de concepts fiables de la fiction, de l’art ou de l’œuvre. Mais à suivre le sens commun, ne peut-on dire que la modalité du « comme si » paraît appropriée à ce qu’on appelle les œuvres, singulièrement les œuvres d’art, des beaux-arts (peinture, sculpture, cinéma, musique, poésie, littérature, etc.), mais aussi, à des degrés et selon des stratifications complexes, à toutes les idéalités discursives, à toutes les productions symboliques ou culturelles qui définissent, dans le champ général de l’université, les disciplines dites des Humanités – et même les disciplines juridiques et la production des lois, et même une certaine structure des objets scientifiques en général ? [USC 30]
C’est une question qui ne laisse pas d’inquiéter chacun des champs que cette série rassemble. Et, à rapprocher la modalité d’un « certain “comme si” » d’un « mode d’être » (au moins de certains objets), ne peut-on y apercevoir l’esquisse d’un motif : comme si c’était être, motif qui ne tarderait peut-être pas à se laisser réfléchir en cet autre : être, comme si c’était – une fiction ? Au moins peut-on souligner que la question d’un « certain “comme si” » s’était déjà radicalisée dans « Comme si c’était possible »[7] concernant la question du transcendantal :
Mais il n’y a sans doute rien de fortuit si la modalité du « quasi » (ou la fiction logico-rhétorique du « comme si ») s’est si souvent imposée à moi pour faire une phrase d’un mot, et d’abord, surtout, on l’a souvent noté et commenté, autour du mot « transcendantal ». Question de contexte et de stratégie problématiques, sans doute : il faut ici réaffirmer sans relâche la question de type transcendantal, et là, presque simultanément, s’interroger aussi sur l’histoire et les limites de ce qu’on appelle « transcendantal ». Mais il fallait avant tout prendre en compte la possibilité essentielle d’un « comme si » qui affecte de fictionnalité, de phantasmaticité, de spectralité possibles tout langage et toute l’expérience. [CSCP 510]
Le comme si agit comme une sorte de cheville qui permet d’articuler et de lier solidairement des inconciliables qu’une hâte excessivement logiciste réduirait volontiers à une contradiction, en l’occurrence, le recours au « quasi-transcendantal » comme « une manière de sauver, tout en le trahissant, l’héritage de la philosophie » [CSCP 511]. Ni l’un ni l’autre, tout en participant à la fois de l’un et de l’autre, le comme si se plaît à jouer les médiateurs, metaxu, ange, go-between, etc., ou encore traître. La difficulté de préciser comme si, que j’entends ici comme si c’était une fiction, se déplace donc d’abord sur fiction :
– Il faudrait là s’arrêter pour parler longuement du concept de fiction, lequel n’est pas forcément littéraire. […] Il y a de la fiction dans « la vie », mais aussi dans la philosophie.[8]
Je voudrais m’y arrêter quelques instants. Essayons, pour voir ce que cela donne. Quiconque a déjà écrit une lettre, lu un livre ou conversé au téléphone sait bien que ces dispositifs ne peuvent transmettre ou enregistrer des signifiés (ou des présences), de sorte que nos pratiques les plus quotidiennes ne sont compatibles ni avec la supposition des signifiés (ou des présences), ni avec la supposition du caractère indissociable des deux faces d’un signe. Mais à critiquer ainsi le concept de signe, que faudrait-il donc ôter (retirer, effacer, supprimer, détruire, etc.)… sinon rien, puisqu’il faudrait ôter ce qu’on vient à l’instant d’affirmer ne pas même avoir lieu[9] ? Ne suffirait-il pas alors de dire que ce non-avoir-lieu « est » une fiction ? Mais à s’en tenir à un sens étroit de fiction, solidaire du fictif et de l’illusoire, que ferait-on d’autre que répéter ce qui vient de motiver le questionnement lui-même ? Et, sauf à récuser toute efficience au concept de signe – ce qui est tout le contraire de cette critique –, comment pourrait-on comprendre qu’un non-avoir-lieu puisse être associé à quelque efficience que ce soit ? Le recours à fiction ne peut donc pas signifier la peinture d’un non-avoir-lieu sous les traits adéquats de la vérité, ni sous ceux plus ou moins ressemblants d’une mimesis, ni sous la figure péjorative d’une illusion ; c’est au contraire lorsque le montage du signe déploie toute son efficience, quand il provoque l’adhérence au point qu’on ne parvienne pas à entrevoir la cheville inapparente qui l’ajointe et lui permet de tenir, qu’il faut le regarder comme si c’était une fiction. Mais alors fiction… en quel sens ? Qu’au moins ce sens permette de concevoir comment conjoindre et articuler du non-avoir-lieu avec de l’efficience !
Je laisse donc de côté (« première éventualité ») la compréhension de fiction rapportée directement ou indirectement à des disjonctions telles que vrai et faux, vérité et mensonge, réel et illusion, authentique et simulacre, etc., qui laissent supposer qu’on sache toujours trancher entre les deux versants, fiction étant [évidemment] à entendre comme non-vrai, non-vérité, non-réel, non-authentique, etc. Je laisse aussi de côté la tentation de faire de fiction une propriété de certains énoncés, de certaines œuvres ou de certains agencements (tel énoncé, tel livre, tel film, etc., « est » une fiction) qui recroise l’impasse, déjà soulignée par Austin dans le cas des actes de langages, « à laquelle on aboutit “chaque fois que nous cherchons un critère simple et unique d’ordre grammatical et lexicologique” pour distinguer entre les énoncés constatifs ou performatifs »[10][SEC 390], et qui se heurte en particulier à la possibilité illimitée de l’itération, de la greffe citationnelle et de la dissémination impliquée par une médiation – pas seulement l’écriture au sens étroit – qui « ne donne pas lieu, “en dernière instance”, à un déchiffrement herméneutique, au décryptage d’un sens ou d’une vérité » [SEC 392].
Convoquer un comme si, c’est changer de regard, et c’est surtout laisser varier les interprétations, ce qui implique une médiation qui puisse jouer le rôle d’une sorte de pivot pour articuler les interprétations entre elles. En l’occurrence, dans l’exemple des signes, il s’agit au moins d’interpréter autrement les textes, discours, récits, opinions, figurations, représentations, images, mises en scène, concepts, jugements, théories, discours, etc., ainsi que leurs relations et articulations, qui sont habituellement référées à cela que j’affirme maintenant ne pas avoir lieu. Or, dans le contexte qui m’intéresse ici, si c’est déjà une première difficulté de concevoir l’éventualité d’ôter du non-avoir-lieu, c’en est une deuxième, qui n’est pas moindre, de concevoir comment ce qui n’a pas lieu pourrait entrer dans le jeu d’une médiation, c’est-à-dire d’abord, au moins, de donner lieu ou d’être associé à des traces. Et ce qui amplifie encore la difficulté, c’est qu’on ne saurait tout changer tout d’un coup :
Nous devons d’autant moins renoncer à ces concepts qu’ils nous sont indispensables pour ébranler aujourd’hui l’héritage dont ils font partie. À l’intérieur de la clôture, par un mouvement oblique et toujours périlleux, risquant sans cesse de retomber en-deçà de ce qu’il déconstruit, il faut entourer les concepts critiques d’un discours prudent et minutieux, marquer les conditions, le milieu et les limites de leur efficacité, désigner rigoureusement leur appartenance à la machine qu’ils permettent de déconstituer ; et du même coup la faille par laquelle se laisse entrevoir, encore innommable, la lueur de l’outre-clôture. Le concept de signe est ici exemplaire.[11] [DG 25]
Ce qu’on s’apprête à examiner en tant que non-avoir-lieu doit cependant être associé à quelque effectivité pour qu’on puisse y trouver un appui suffisant de manière à retourner son efficience (son « efficacité ») contre l’héritage dont il fait partie : comment comprendre maintenant, troisième difficulté, que du non-avoir-lieu puisse être associé à une effectivité qui procurerait une telle efficience ?
C’est déjà au moins cette triple difficulté que fiction doit permettre d’articuler et de rendre intelligible, faute de quoi la visée du non-avoir-lieu perdrait tout son sens. L’articulation entre trahison et héritage signifie qu’il ne s’agit pas de mettre en scène la confrontation contradictoire d’un duel « horizontal » où l’un des deux doit s’imposer à l’autre pour l’anéantir ou le reléguer à l’arrière-plan de la fausseté, de l’illusion ou de l’insignifiance, mais au contraire de prendre appui sur l’efficience de ce qui est à critiquer pour procéder à une réinterprétation « verticale » de cette efficience en lui procurant une autre raison ou une autre effectivité. Une réinterprétation n’est donc pas une généralisation obtenue par l’élargissement d’un territoire au-delà d’un horizon demeurant confiné dans l’horizontalité de son à-plat, car c’est un changement – un chamboulement, un remue-ménage, un événement, etc. – qui arrive dans une verticalité, inaperçue au regard de cet à-plat, et qui prend appui sur ce qui est en cause, non pour le détruire, mais pour l’amener à « se trahir » afin qu’il apparaisse, jusqu’au point où il devient possible de (re)constituer, (re)construire ou rendre manifeste un agencement dont on n’avait pas idée, jusqu’alors insoupçonné et inaperçu, qui portait cette efficience quoiqu’elle l’enveloppât et l’abritât, et ainsi recueillir cet agencement pour en « hériter ». C’est l’une des facettes de la déconstruction, qui peut être entendue aussi bien comme une dé-sédimentation, une dé-couverte, un dé-voilement, un dé-abritement, etc., que comme une invention, une constitution, un dépassement, un hissage, une élévation, etc., et qui implique, quant à ce que j’envisage ici, la mise en jeu de ce dont on n’a pas idée[12] grâce à une variation d’interprétation. En un sens étroit (et de surcroît ici, horizontal), comme si peut être apparenté, selon les cas, à une comparaison, à une métaphore ou à une analogie. Mais un « certain “comme si” » peut déployer ses effets dans la verticalité quand il intervient dans l’équilibre entre un non-avoir-lieu (je n’ai pas l’idée de) et l’avoir-lieu de ce qui se manifeste à moi comme si cela n’avait pas lieu (ce qui me demeure imperceptible, comme si ce n’était rien, tout comme le mouvement imperceptible de Galilée, come nullo), équilibre à la fois extrêmement vulnérable, parce qu’il suffit d’une plume d’ange pour le troubler, et farouchement résistant, aussi longtemps du moins qu’il ne me vient pas à l’idée ce dont je n’ai pas idée.
Car ce que je voudrais tenter avec vous, c’est cette chose apparemment impossible : enchaîner ce « comme si » à la pensée d’un événement, c’est-à-dire à la pensée de cette chose qui peut-être arrive, dont on suppose qu’elle a lieu, qu’elle trouve son lieu […]. [USC 32]
Au sein d’un « mouvement oblique et toujours périlleux », je voudrais pour ma part proposer ici de repérer le tracé de quelques « obliques » qu’une certaine compréhension de comme si et de fiction pourrait donner à entrevoir.
2. Un schéma d’interprétation
Ce que je propose ici d’associer à fiction est moins un concept qu’un schéma d’interprétation destiné, à supposer qu’on veuille l’appliquer, à attirer l’attention sur certains traits, aspects ou articulations pour guider l’analyse de constructions ou d’agencements à effets fictionnels, du moins de certains d’entre eux. Dès qu’on sait mentir – ou confectionner une théorie –, on sait élaborer de telles constructions[13] ; on ne s’étonnera donc pas du caractère parfois très enfantin des exemples choisis. Certains traits et accents caractéristiques de ce schéma proviennent du cinéma, de l’informatique et du droit, sachant que la pratique de l’informatique, parce qu’elle est particulièrement exposée à la problématique de l’écriture et de la trace, d’une manière plus radicale que dans les mathématiques formalisées, peut guider sans fléchir jusqu’à des conséquences peut-être inattendues.
Quand j’utilise les opérations usuelles d’un éditeur de textes comme couper, copier, coller, etc., je sais qu’il n’y a, dans un ordinateur, ni paire de ciseaux, ni photocopieuse, ni aucun pot de colle, mais j’attends que l’éditeur de textes me procure une contrepartie effective qui s’accorde à ces fictions et me permette de les mettre en œuvre, sans que je doive au préalable étudier l’architecture des ordinateurs et la programmation de ces logiciels. Ce qui ici est en cause n’est pas un jugement de fausseté, d’irréalité, d’imagination, de ressemblance ou d’illusion, mais un effet fictionnel (couper, copier, coller, etc.) permettant de favoriser une pratique d’usage de dispositifs complexes sans que je doive en connaître le détail, au moins dans certaines limites. Quand je regarde la course de chars dans le film Ben-Hur[14] je distingue, d’une part, le plan diégétique qui vise à produire l’effet fictionnel d’une course de chars supposée avoir eu lieu dans les années trente de notre ère, et, d’autre part, le plan filmique de la réalisation (scénario, décors, acteurs, figurants, techniciens, tournage, montage, mixage, etc.), conduisant jusqu’à un film projetable (pellicule, fichier vidéo, etc.) qui constitue la contrepartie effective de l’effet fictionnel du plan diégétique.
L’effet fictionnel n’est nulle part donné. Ce n’est ni un signifié dont le film serait le signifiant, ni une présence soudée à la médiation filmique : un effet fictionnel n’a lieu que pour un interprète qui prend en charge l’interprétation effective produisant l’effet fictionnel dont il s’affecte. Dans le cas du cinéma, chaque spectateur a sa propre lecture du film, et chacun doit assumer, à chaque projection, l’interprétation produisant l’effet fictionnel. Dans le cas de l’informatique, chacun sait – hélas ! – qu’il ne suffit pas de placer quelqu’un devant un écran d’ordinateur (de téléphone, ou de tout autre appareil compliqué) pour qu’il sache ipso facto s’en servir : de tels effets fictionnels (comme couper, copier, coller, etc.) ne se produisent que pour des utilisateurs qui peuvent leur associer une compréhension et une pratique appropriées.
Ces deux exemples esquissent le trait majeur du schéma, à savoir l’articulation, via une médiation, de deux dimensions d’interprétation et d’effectivité, l’une qui est associée à l’effectivité de ce qui porte ou produit la médiation en tant que contrepartie effective requise par l’effet fictionnel, l’autre qui est associée à l’effectivité de l’interprétation appliquée à la médiation et produisant l’effet fictionnel dont s’affecte l’interprète qui prend en charge cette interprétation. Il s’agit de deux dimensions d’interprétation en ce sens que chacune d’elles s’ouvre en une multiplicité d’interprétations possibles. Dans le cas du cinéma, par exemple, le regard d’un réalisateur n’est pas le même que celui d’un décorateur, d’un machiniste, d’un monteur ou d’un acteur, tandis que chaque spectateur s’affecte de l’effet fictionnel que produit sa propre compréhension du film. Le principe même d’une telle articulation requiert une médiation, en l’occurrence un film, qui puisse articuler les interprétations de chacune des deux dimensions pour chacun. En ce sens, on pourra dire qu’il n’y a pas de fiction in abstracto[15]. Dans l’exemple de l’éditeur de textes, la médiation correspond à toutes les interactions liées à l’interface homme-machine (affichages, frappes au clavier, actions avec la souris, gestes, etc.) ; la dimension d’interprétation associée à la contrepartie effective correspond aux aspects techniques, aussi bien matériels que logiciels, tandis que la dimension d’interprétation associée à l’effet fictionnel est prise en charge, par chaque utilisateur, en fonction de ce qu’il sait et de ses habitudes, et peut donc varier dans le temps.
Il ne s’agit pas, avec un tel schéma, de dire ce que « est » une fiction, encore moins de décider si ceci ou cela « est » ou « n’est pas » une fiction, parce qu’un effet fictionnel est lié à un point de vue, en tant qu’indissociable de l’interprétation dont s’affecte l’interprète lui-même. La fictionnalité de cet effet serait donc plutôt à attribuer, d’abord, à cette interprétation en tant qu’elle s’accomplit effectivement, d’où l’accent appuyé que je donne à l’idée d’un effet fictionnel. Ce schéma est extrêmement dynamique et doit suivre le mouvement, lui aussi extrêmement dynamique, des interprétations. Pour autant, il n’a pas pour fonction d’examiner en général et en détail les effets fictionnels pour eux-mêmes, comme on le fait, par exemple, dans les études littéraires ou cinématographiques : on retiendra que les effets fictionnels peuvent être complexes et faire intervenir plusieurs plans fictionnels entremêlés ou emboîtés, tout en jouant avec les frontières et les passages entre ces différents plans[16]. Si les « êtres de fiction » n’ont pas d’avoir-lieu comme tels, ils sont cependant portés, supportés ou suscités par les contreparties effectives qui portent la médiation. En regard, je réserve l’efficience pour dire la plus ou moins grande intensité ou efficacité avec laquelle une construction fictionnelle parvient à susciter, auprès d’un interprète, à chaque fois particulier, l’effet fictionnel dont il s’affecte : ce qui s’avère efficient pour l’un peut ne pas l’être pour un autre, ce qui était efficient pour moi hier ne le sera peut-être plus demain.
Le fait d’introduire deux dimensions d’interprétation souligne que ces deux dimensions ne jouent pas le même rôle. Dans les fictions intentionnellement construites, c’est souvent la contrepartie effective qui tend à être estompée ou même effacée pour que l’effet fictionnel soit le plus efficient possible. Au contraire, dans un contexte critique de déconstruction ou de dépassement, ce schéma vise plutôt à changer le regard porté sur un agencement d’évidences, de croyances, d’opinion, de concepts, de jugements, de théories, de discours, de pratiques, etc., c’est-à-dire à élaborer, constituer ou reconstituer à la fois un effet fictionnel et sa contrepartie effective de manière à réinterpréter rétroactivement cet agencement comme si c’était une fiction.
3. Le signe, comme si c’était une fiction
Je reviens sur l’exemple du signe. Qu’arrive-t-il quand on regarde le [concept de] signe comme si c’était une fiction ? Le trait majeur des médiations est l’asémie qui signifie que tout effet de sémie (signification, renvoi, référence, désignation, etc.) est l’effet d’une interprétation effective dont s’affecte l’interprète qui prend en charge cette interprétation. Quitte à insister avec quelque lourdeur, et de manière imagée, une médiation (orale, écrite, iconique, filmique, informationnelle, etc.) ne « contient » (à la manière d’une boîte à bonbons), ne « véhicule » (à la manière d’une brouettée de cailloux), ne « signifie » (à la manière d’un signifié indissociable d’un signifiant), etc., aucun « granulé sémique » qu’un interlocuteur, un lecteur, un spectateur, etc., pourrait recevoir passivement en son esprit. Comme je l’ai brièvement indiqué plus haut, tout le monde sait bien[17] cela car, par exemple, si la voix « contenait » ou « véhiculait » de soi-même de tels granulés, il n’y aurait ni téléphone, ni magnétophones ou autres enregistreurs, ni haut-parleurs (et, en fait, il n’y aurait même pas non plus la parole), et, toutes différences gardées, la même remarque vaut pour l’information, pour l’écriture et pour les traces :
Mais au-delà des mathématiques théoriques, le développement des pratiques de l’information étend largement les possibilités du « message », jusqu’au point où celui-ci n’est plus la traduction « écrite » d’un langage, le transport d’un signifié qui pourrait rester parlé dans son intégrité. Cela va aussi de pair avec une extension de la phonographie et de tous les moyens de conserver le langage parlé, de le faire fonctionner hors de la présence du sujet parlant. [DG 20]
Une telle indication concernant l’information, rédigée au milieu des années 1960, lorsque l’informatique était encore très confidentielle et les réseaux ceux de la télégraphie et de téléphonie, n’a rien perdu de son actualité, tant s’en faut, car tout cela « revient, en toute rigueur, à détruire le concept de “signe” et toute sa logique ». [DG 16]
Inversons maintenant le raisonnement, comme un film projeté en sens inverse qui montrerait les briques d’un mur écroulé s’arrachant de terre et se précipitant avec enthousiasme pour s’ajointer les unes aux autres et s’emmurer parfaitement. D’une part, plus les contreparties effectives sont estompées, voire effacées, et plus il faut élaborer des effets fictionnels dans lesquels les effets de sémie sont attribués aux médiations elles-mêmes. Ces médiations se voient ainsi dotées du pouvoir extraordinaire de produire d’elles-mêmes des effets de sémie, ce qui évite, au moins au plan grammatical, d’avoir à reconnaître que ces effets soient sans cause. Ne dit-on pas sans cesse qu’un mot ou une phrase « signifie », « contient », « véhicule », « désigne », « réfère à », etc., ceci ou cela ? Mais c’est seulement comme si, car ce ne sont que des manières de parler. Dans l’étude qu’ils consacrent au livre Gamma de la Métaphysique d’Aristote, Barbara Cassin et Michel Narcy soulignent :
Il est extrêmement frappant en effet que la première occurrence du verbe sēmainein dans le texte de Gamma soit aussi la dernière où ce verbe a pour sujet le locuteur : cette construction, normale pour le verbe, disparaît complètement dans la suite du chapitre, où ce sont toujours les mots qui signifient.[18]
Ce pouvoir extraordinaire prêté aux médiations peut ainsi concerner très largement tout ce qui requiert une médiation, par exemple « mémoriser » ou « extérioriser [la mémoire] » : nous ne mémorisons pas des « granulés sémiques » – on ne saurait donc a fortiori les « extérioriser » –, mais au mieux des traces asémiques (le linéaire A n’est toujours pas déchiffré).
D’autre part, pour que les interprétations à effet fictionnel soient efficientes quant à l’effacement des contreparties effectives, il convient aussi que ces interprétations tendent à s’effacer elles-mêmes dans les effets qu’elles produisent (je souligne ici la forme d’un réfléchi en quelque manière moyen, comme s’il était à la fois actif et passif : c’est aussi le processus d’effacement qui doit lui-même s’effacer dans l’effet qu’il produit). On peut alors comprendre que, lorsque sont effacées à la fois les contreparties effectives et les interprétations à effet fictionnel (effaçant ces contreparties et s’effaçant elles-mêmes), il ne doit plus subsister aucune effectivité ni empiricité apparente pour produire les effets de sémie, ni non plus aucune effectivité ou empiricité apparente pour s’en trouver affecté ; il ne reste plus, à ce stade, que les médiations. Restent seulement des traces[19] [LDS 239]. On reconnaît là, déjà, divers traits constitutifs de la fiction du signe qui nous figure des signifiés métempiriques inexplicablement et indissociablement liés à des signifiants sensibles, comme la ficelle grâce à laquelle un enfant empêche son très précieux ballon de baudruche de s’envoler dans les cieux. Cette fiction dissocie la résidence métempirique des granulés sémiques et l’instance effective qui peut s’en trouver affectée, dissociation bien compréhensible puisque c’est cette instance qui doit prendre en charge discrètement toute l’effectivité qui tombe en reste de la fiction du signe. D’où l’étrange assujettissement de cette instance – ici-gît –, sujet survivant à l’anéantissement commandé par une fiction qui n’a de cesse de l’effacer dans son empiricité, non sans le conserver à l’abri de son linceul fictionnel, puisque c’est lui qui assume toute l’effectivité à laquelle elle doit sa tenue ; et tandis qu’il anime un corps empirique, la discrétion que lui impose son effacement lui interdit d’y avoir lieu, autant comme effectivité que comme place, et d’y laisser une trace. Il suffira d’un léger déplacement d’accent pour qu’il bascule du côté métempirique, comme un pur esprit ou comme une fonction transcendantale, par exemple, ou du côté empirique, comme un moi psychologique, par exemple. Où pourrait-il avoir lieu dans le paysage d’une fiction qui l’a déjà effacé ? C’est en quelque manière une incise fictionnelle qui en dégage le hors-lieu quand elle disjoint l’empirique du métempirique, un entre-deux qui les ajointe en tant qu’il maintient séparés (ni l’un ni l’autre) les bords que, pourtant, il relie (à la fois l’un et l’autre), comme des parenthèses qui retiennent ce qu’elles feignent de soustraire.
À mesure que les effectivités et les interprétations sont effacées dans les effets fictionnels, la médiation voit son rôle s’amenuiser considérablement : elle ne peut plus servir pour articuler des interprétations (il n’y en a plus), ni à porter les effets de sémie portés par les contreparties effectives (elles sont effacées), ni non plus à porter la fiction du signe (dont l’interprétation qui en produit l’effet est elle-même effacée). Le rôle de la médiation peut alors devenir secondaire, voire résiduel, et la médiation elle-même peut être occultée ou ignorée dès que son empiricité est jugée indifférente ; elle peut alors presque s’évanouir dans l’adhérence d’une proximité absolue à ses effets de sémie (présence et voix, signifié et signifiant, etc.). Et lorsque les deux dimensions d’effectivité – donc aussi les deux dimensions d’interprétation – sont parfaitement effacées, c’est la médiation elle-même qui peut s’effacer pour sombrer dans la transparence aveuglante d’une immédiateté absolue[20] :
La « science » sémiologique ou, plus étroitement, linguistique, ne peut donc retenir la différence entre signifiant et signifié – l’idée même de signe – sans la différence entre le sensible et l’intelligible, certes, mais sans retenir aussi du même coup, plus profondément et plus implicitement, la référence à un signifié pouvant « avoir lieu », dans son intelligibilité, avant sa « chute », avant toute expulsion dans l’extériorité de l’ici-bas sensible. En tant que face d’intelligibilité pure, il renvoie à un logos absolu auquel il est immédiatement uni. Ce logos absolu était dans la théologie médiévale une subjectivité créatrice infinie : la face intelligible du signe reste tournée du côté du verbe et de la face de Dieu. [DG 25]
J’ai voulu ici esquisser une application possible du schéma des fictions à la critique du signe, critique qu’on ne saurait éviter ou contourner dès lors que ce schéma – et tous nos appareils modernes, et aussi l’écriture, et même la voix – requiert des médiations asémiques : le nerf de cette critique est de rappeler ou de (re)constituer l’effectivité des interprétations de manière à les reconnaître dans leur fonction de contrepartie effective des effets – fictionnels – de sémie. Je voudrais à cet égard souligner que si l’effectivité des interprétations et des contreparties est portée de part en part par des accomplissements empiriques, je ne l’entends pas dans le sillage d’une disjonction entre empirique et métempirique, ce qui reviendrait à reconduire la disjonction entre sensible et intelligible, mais dans une perspective qu’on pourrait peut-être dire « quasi-transcendantale » : en effet, d’une part, « métempirique » est ici le nom d’un certain effet fictionnel auquel n’est associé aucun avoir-lieu, comme le suggère cette esquisse de la critique du signe ; d’autre part, l’effectivité correspond à un accomplissement en tant qu’il a lieu, mais non pas en tant qu’il s’accomplirait comme ceci ou comme cela[21].
4. L’efficience d’un non-avoir-lieu
Ce schéma d’interprétation des fictions est aussi un schéma de traduction en ce sens qu’il favorise les réinterprétations en tant que variations d’interprétation articulées par des médiations. L’étude rapide menée sur le concept de signe attire en particulier l’attention sur l’éventuelle corrélation entre l’effacement (l’occultation, la méconnaissance, etc.) des contreparties effectives et les effets fictionnels qui doivent être élaborés pour envelopper cet effacement, et surtout le conserver puisque, même effacé, c’est à ces contreparties effectives que les effets fictionnels doivent leur efficience. Personne n’imagine, par exemple, que les signes linguistiques existeraient et subsisteraient par eux-mêmes dans quelque paradis enchanté et pourraient ainsi parader devant nous sans le secours de nos interprétations effectives qui en produisent l’effet. L’un des enjeux du comme si – au moins dans les cas où il se laisse entendre au sens d’un comme si c’était une fiction – est précisément de parvenir à mettre en jeu une efficience associée à un effet fictionnel enveloppant une contrepartie effective qui y demeure abritée et que, pour diverses raisons, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne sait pas, etc., apercevoir, affronter, connaître déplier, etc.
Considérer les fictions sous l’angle du vrai ou du faux, c’est se tromper de problème. Ce qui est aperçu et jugé comme « faux », c’est le fait qu’un « être de fiction » n’a d’autre corrélat que du non-avoir-lieu. Mais ce qui est aperçu comme « vrai », c’est qu’il doit sa tenue à une efficience que lui procure la contrepartie effective qu’il enveloppe et qui le soutient. La distinction entre le corrélat et la contrepartie effective d’un « être de fiction » est particulièrement nette dans le cas très simple d’un théâtre de marionnettes : l’être de fiction Guignol n’a, comme tel, d’autre corrélat qu’un non-avoir-lieu, tandis que c’est le marionnettiste, debout derrière le castelet, la main dissimulée sous la gaine de la marionnette, qui lui procure toutes les contreparties effectives nécessaires à l’administration des nombreux coups de bâtons qui pleuvent sur la tête de Flageolet pour la plus grande joie du jeune public. L’être de fiction Judah Ben Hur n’a d’autre corrélat qu’un non-avoir-lieu, et même si j’avais pu me trouver à Cinecittà en 1958 sur les plateaux de tournage du film, je n’aurais eu aucune chance de le rencontrer pour l’interviewer ; mais il a une contrepartie effective, Charlton Heston, pour le dire en bref, car la tenue d’un personnage fictionnel est aussi un effet global d’un film, de son scénario, de sa réalisation, etc. Il ne s’agit donc pas de récuser la réalité ou la pertinence d’un effet fictionnel au prétexte qu’il n’y aurait là rien d’autre qu’une illusion, c’est-à-dire rien d’autre que du non-avoir-lieu, mais bien de réinterpréter la corrélation entre un effet fictionnel et son non-avoir-lieu comme une manière d’enveloppement[22] qui abrite – et surtout conserve – les contreparties effectives pour qu’elles produisent l’efficience attendue ou constatée.
Inversement, même si cela peut sembler paradoxal en première approche, on comprend qu’il est concevable d’analyser l’efficience d’un non-avoir-lieu (ou, plus précisément, de munir un non-avoir-lieu d’une efficience fictionnelle) en constituant ou en reconstituant un corrélat fictionnel pour ce non-avoir-lieu, c’est-à-dire un effet fictionnel paré de cette efficience, et enveloppant une contrepartie effective procurant cette efficience. Bien que la caractérisation d’une fiction juridique (dont le principe est déjà mis en œuvre dans le droit romain, fictio juris) requière beaucoup de précautions et de nuances, cette approche des constructions fictionnelles me paraît déchiffrable dans cette définition d’une fiction juridique :
[La fiction juridique est un] artifice de technique juridique (en principe réservé au législateur souverain), « mensonge de la loi » (et bienfait de celle-ci) consistant à « faire comme si », à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droit.[23]
On peut comprendre, au moins dans certains cas, que « supposer un fait contraire à la réalité » est une manière de dire un non-avoir-lieu. Partant, on peut comprendre que ce non-avoir-lieu est logé, quant à son enveloppement, dans une notion juridique qui, elle, bénéficie, quant à son efficience, de contreparties effectives. Ce qui produit un effet de droit, en tant qu’efficience de la fiction, ce n’est pas que la fiction fasse passer pour « vrai » ou « réel » ce qu’on vient à l’instant de supposer « contraire à la réalité », mais c’est le faire du « faire comme si » : c’est ce faire qui constitue la contrepartie effective de l’effet fictionnel, et ce n’est qu’à ce faire que l’effet de droit doit son efficience[24]. En revanche, on comprend que tout puisse s’embrouiller et perdre son sens quand on croit devoir attribuer l’efficience, non aux contreparties effectives, mais à l’enveloppe fictionnelle et, par voie de conséquence, à son non-avoir-lieu corrélatif, comme si on pouvait croiser Guignol en se promenant le dimanche après-midi dans les rues de Lyon[25] ou venir interviewer Judah Ben Hur à Cinecittà !
5. « Croyance »
Parmi les raisons qui peuvent tenir des contreparties effectives abritées figure ce dont on n’a pas idée[26], en particulier dans les cas où l’effet fictionnel n’est même pas aperçu comme tel, ce qu’on peut formuler : « je n’ai pas l’idée qu’il y a quelque chose dont je n’ai pas idée ». Or, ce dont je n’ai pas idée [au présent] n’a pas lieu pour moi [au présent], de sorte que lorsque l’idée me viendra à l’esprit – si elle y vient –, c’est seulement rétroactivement que je pourrai tenter de dire ce que c’était pour moi que ce non-avoir-lieu. Pour étudier cette problématique, je ne peux prendre appui que sur des exemples relatés depuis des circonstances dans lesquelles « c’ » est venu à l’idée, puisque je n’ai pas idée, moi non plus, de ce dont je n’ai pas idée.
La « croyance » que peut avoir un tout jeune enfant dans le Père Noël sera tôt ou tard convertie en une fiction quand il comprendra que ce personnage saisonnier, au visage rubicond et souriant sous sa barbe cotonneuse et blanche, pratiquant avec virtuosité la spéléologie des cheminées, pourvu d’une extraordinaire ubiquité et surgissant ici et là au début de l’hiver, et avec une probabilité très élevée à proximité des magasins de jouets, est en fait un effet fictionnel produit par la contrepartie effective et affectueuse que lui procurent ses parents, ses proches, ses amis et de nombreux inconnus (non sans la complicité attentionnée de puissants intérêts commerciaux et de diverses institutions, tel le service des Postes qui assume sa part de la contrepartie effective du Père Noël quand il ouvre chaque année un service saisonnier dont la fonction est de répondre aux courriers qui lui sont adressés).
En tant qu’être de fiction, le Père Noël n’a d’autre corrélat qu’un non-avoir-lieu, car les pères Noël en chair et en os que l’enfant croise dans la rue ne sont que des figurants qui concourent à la contrepartie effective de l’effet fictionnel, c’est-à-dire à la mise en scène destinée au regard des enfants. J’ai placé croyance entre guillemets parce qu’il y a une difficulté dans la mesure où dire qu’un enfant « croit » au Père Noël procède déjà d’un point de vue dans lequel on sait qu’il s’agit d’un effet fictionnel. Si, grâce à une expérience de pensée, je me transporte par l’imagination dans le point de vue d’un enfant qui « croit » au Père Noël – par exemple, l’enfant que j’étais –, et que je tente d’imaginer ce que c’était avant que je n’y croie plus, je ne trouve rien qui vaille comme un croire, car je ne peux pas plus dire « je crois au Père Noël » que « je suis mort »[27], de sorte que la différence n’est pas plus saisissable comme une négation liant deux propositions contraires – « je crois au Père Noël » et « je ne crois pas au Père Noël » – que le passage n’est adéquatement recueilli comme la transition temporelle de la première à la seconde. Je ne peux pas plus l’imaginer en recourant à une clause d’énonciation introduisant une sorte de modalité pour formuler le passage comme la transition de « [je n’ai pas l’idée que] je crois au Père Noël » à « [j’ai l’idée que] je crois au Père Noël », puisque les deux énoncés présupposent que je ne croie pas au Père Noël. Ce n’est pas non plus un effacement, quelque chose qui, d’abord aurait lieu, « [je sais que] je crois au Père Noël » et qu’ensuite je pourrais placer sous rature, biffer, effacer ou dissimuler à ma propre vigilance « [je me cache à moi-même que] [je sais que] je crois au Père Noël ». Et ce n’est pas non plus un vécu de conscience, ce n’est même pas une synthèse qui resterait un temps blottie dans les replis d’ombre d’une passivité sensible attendant le moment opportun pour venir toquer aux huis de la conscience.
Lorsque je vois le visage émerveillé d’un enfant croisant l’un des innombrables pères Noël dans la rue et que je me dis « il “croit” au Père Noël », ce « croire » que je lui attribue n’a pas plus lieu pour cet enfant-là que pour moi lorsque j’étais un tel enfant. C’est à celui qui formule le jugement « il “croit” au Père Noël » de prendre en charge ce « croire » au titre d’une fiction qui signifie, dans son point de vue, qu’il regarde cet enfant agir, réagir et se comporter comme s’il croyait au Père Noël à l’égard de ce qui ne relève en somme que d’une mise en scène assez approximative. Et, dans son point de vue, l’enfant ne peut pas plus en parler comme croyance puisqu’il ne pourrait le faire qu’à la condition qu’il n’y croie déjà plus, ou du moins qu’il en ait le soupçon, ou même qu’il n’y ait jamais cru. Pour l’enfant, cette « croyance » n’a jamais lieu comme telle au présent et ce « croire » entre guillemets aura dû ne pas avoir lieu « avant » que ne se lève l’horizon fictionnel d’un comme si où pourra venir se présenter l’opposition entre croire et ne pas croire, un « avant » comme une « passivité plus passive que la passivité elle-même »[28] [PANPV 76]. C’est donc maintenant ce « croire » entre guillemets qui passe sous statut de fiction en tant qu’il dessine l’effet fictionnel corrélatif du non-avoir-lieu d’un il n’a pas l’idée de… Il faut aller jusque-là, jusqu’à envisager de penser il n’a pas idée de… comme si c’était une fiction.
6. Incoprésentabilité
Lorsque nous regardons distraitement les fictions, nous agissons et pensons comme si nous flottions dans le surplomb céleste et panoramique qui nous offrirait la contemplation maîtrisée de tous les points de vue, l’assignation exacte du vrai et du faux et, jusqu’en ses moindres détails, la cartographie exhaustive du possible et de l’impossible. Mais ce que ce lointain nous peint comme un paysage d’apparence apaisée est bien plutôt une texture chiffonnée d’ombres et plissée d’abîmes qui ne se laisse pas arraisonner dans l’à-plat d’une totalité dépliée, blanche et lumineuse. Il y a du point de vue, ce qu’on entendra aussi bien comme point de vue, un site depuis et selon lequel on voit ce qu’on voit comme on le voit, que comme point de vue, ce qui se soustrait dans ce qu’on voit comme ce qui conditionne la possibilité qu’il y ait du point de vue – plutôt qu’un surplomb total – et qui, indissociablement, le limite.
L’exemple enfantin du Père Noël permet d’approcher une différence de deux points de vue dans le cas où l’un des deux attribue à l’autre quelque chose qui, pour cet autre, n’a pas lieu comme tel au présent. On connaît des différences de points de vue qui peuvent être formulées, pourrait-on dire, à plat, qu’il s’agisse d’une différence de site (l’un pense que…, l’autre pense que…) ou d’une différence temporelle (hier je pensais que…, aujourd’hui je pense que…). De tels points de vue peuvent être dits compossibles au sens de Leibniz, en ce sens qu’ils doivent appartenir à un même monde. Mais l’étude de cet exemple d’une « croyance » entre guillemets attire l’attention sur le fait qu’il y a des différences de points de vue pour lesquels cet à plat est exclu parce que la mise à plat détruirait ou abolirait l’un des points de vue. Je dirai ces points de vue incoprésentables pour dire qu’on ne peut produire une somme, une formulation ou un récit qui pourrait être présenté, à chacun des deux dans les mêmes termes, et où chacun pourrait reconnaître la part qui le concerne, et cela parce que l’un des deux attribue à l’autre quelque chose dont cet autre n’a pas idée[29]. L’incoprésentabilité est donc tout autre chose qu’une incompatibilité, une disjonction, une contradiction ou une exclusion en à-plat, et il ne s’agit ni d’exclure des propositions contradictoires, ni d’exiger un choix entre des éventualités également possibles et formulées ; c’est aussi autre chose qu’un devenir, car il ne s’agit pas non plus de constater que ce qui était vrai (ou faux) hier deviendra peut-être faux (ou vrai) demain. L’incoprésentabilité est bien une co-contemporanéité qui exige l’en même temps de l’enfant et des contreparties effectives père-noëlesques pour que l’effet fictionnel déploie son efficience auprès des enfants.
L’incoprésentabilité est corrélative d’un reste (à dire, à savoir, à interpréter, à manifester, etc.) qu’on ne saurait amener au jour ou expliciter sans l’abolir. On peut seulement [tenter de] recueillir ce reste comme un effet fictionnel, et c’est seulement à ce titre qu’il correspond à un point de vue dans lequel on peut avoir idée de ce qui demeure incoprésentable. Aucun des metteurs en scène affectueux n’éprouve la croyance au Père Noël, et ils peuvent seulement se représenter, à titre de fiction, la « croyance » entre guillemets des enfants, car l’enfant n’a pas l’idée que ce qu’il perçoit et comprend de ce généreux personnage au manteau rouge démodé est une mise en scène ; et il n’a pas non plus l’idée qu’il n’a pas l’idée de cette mise en scène, ni l’idée qu’il n’a pas l’idée qu’il n’a pas l’idée…, et ainsi de suite sans fin. Aucune série de négations ou d’effacements ne confectionnera du non-avoir-lieu, et sans fin dit ici ce qui se refuse au rassemblement dans la totalisation d’une sommation, même infinie : l’inaperçu – en l’occurrence, ce dont on n’a pas idée – est ineffaçable. Et quand je dis « Quand j’étais enfant, je croyais au Père Noël », c’est seulement comme si, car je recueille dans le filigrane de cet aveu la trace silencieuse et blanche de ce qui n’a jamais eu lieu au présent, et qui, à cet égard, ne peut figurer dans aucune chronologie positive. Je n’ai jamais cru au Père Noël, même quand j’y « croyais », avant que je n’y « croie » plus, et je n’y aurai « cru » que depuis l’instant où j’ai compris que j’y « croyais », c’est-à-dire que je n’y « croyais » déjà plus ! C’était vient après comme si[30]. Après? S’il vient à l’idée, il vient comme événement.
Un passé qui n’a jamais été présent, cette formule est celle par laquelle Emmanuel Levinas, selon des voies qui ne sont certes pas celles de la psychanalyse, qualifie la trace et l’énigme de l’altérité absolue : autrui.[31] [DIF 22]
7. Espacement
Dans ce qui précède, j’ai évoqué des situations dans lesquelles il y a [au moins] deux points de vue incoprésentables, ce qui implique que le récit de ces situations soit composé depuis un point de vue dans lequel on a l’idée de… puisque la dissymétrie de l’incoprésentabilité exclut un récit composé depuis le point de vue dans lequel on n’a pas l’idée de…, à moins, au contraire, que ce ne soit la situation la plus ordinaire[32] ! Et de quoi donc n’aurais-je pas idée ? Eh bien, précisément, je n’en ai pas idée ! Que puis-je tenter d’en dire ? Tout au plus dois-je concevoir – si j’ose dire – qu’il y a du non-avoir-lieu en tant que je n’ai pas idée de…, si du moins j’accorde que je ne saurais me procurer la garantie qu’il n’y en ait pas. Il serait périlleux de convoquer ici la tension entre possibilité et impossibilité dans la mesure où l’incoprésentabilité exclut aussi bien la totalisation en à-plat des points de vue que celle des possibles, et peut-être ce qui n’est pas aperçu ou conçu comme possible dans un point de vue – par exemple, parce qu’on n’en a pas idée – peut-il l’être dans un autre, incoprésentable avec le premier. En tant qu’ils sont incoprésentables l’un par rapport à l’autre, de tels points de vue sont liés les uns aux autres, et les interprétations associées s’articulent via des médiations, c’est-à-dire in fine via des traces, ce qui est une manière de dire que la trace et l’incoprésentabilité ont, en leur principe, la même extension : là où il y a trace, il y a aussi – peut-être – de l’incoprésentabilité. En ce sens, l’incoprésentabilité participe de « ce qui empêche que tout soit donné tout d’un coup »[33] et si Bergson associe cet empêchement au temps, il convient aussi, à mon sens, de l’étendre aux trois « dimensions d’espacement » que sont la temporalité, la spatialité et l’incoprésentabilité. Comment imaginer un tel « tout, tout d’un coup », « avant » et donc « sans » espacement ? Peut-être comme si c’était une contraction, rien qu’un point, un seul, sans durée et sans étendue, mais aussi sans incoprésentabilité, donc sans savoir et sans secret, sans trace et sans blanc. Un point, un point c’est tout :
« Ce point si petit, pourtant, contient les autres points en cendres », disait-il.[34]
Peut-être n’est-ce qu’une fiction, mais nous pouvons lui associer une contrepartie effective, l’éclatement de ce point comme espacement, comme ce qui empêche que tout soit donné tout d’un coup, indissociablement condition de possibilité et effet de limitation. Au-delà ou en-deçà d’un reste à savoir, de ce que nous savons que nous ne savons pas, au-delà ou en-deçà des horizons que nous savons déterminer et qui caractérisent déjà, pour chacun d’eux, le reste d’inaccessibilité qui nous empêche de les atteindre ou de les épuiser, au-delà ou en-deçà de tout cela, il y a encore ce reste autre, ce dont nous n’avons pas idée [au présent] et que nous ne savons ou ne pouvons pas apercevoir [au présent].
8. Réinterpréter (1)
Comment le schéma des fictions s’applique-t-il lorsque les contreparties effectives ne sont pas intentionnellement construites et que personne ne tire les ficelles des « marionnêtres » ? Pour quelqu’un au fait des théories physiques – que je nommerai le physicien pour faire bref –, la sensation qu’il éprouve de l’immobilité de la terre (sensation qui ne disparaît pas, faut-il le souligner, avec la connaissance de ces théories) est référée – je dis cela rapidement – à un équilibre résultant d’une combinaison de mouvements, d’accélérations, d’attractions et de gravitations. Pour celui que je nommerai en bref l’insouciant – quelque lointain ancêtre, aussi bien que l’enfant que j’étais, par exemple – qui n’a pas encore croisé, fût-ce de loin, les rudiments primaires d’une cosmologie moderne non géocentrée, ça ne bouge pas : c’est (ou c’est devenu) pour lui une « évidence », une « évidence » évidemment entre guillemets dans la mesure où elle ne se dégagerait de ses guillemets qu’à contrer l’éventualité d’un ça bouge, donc – dans cet exemple – à s’abolir, en tant qu’évidence, dans le point de vue du physicien. En pratique, dans la vie quotidienne, pour l’insouciant comme pour le physicien, tout (ou presque) se passe comme si la terre était réellement immobile, le ou presque notifiant qu’il y a des limitations qui restreignent la pertinence et l’applicabilité de cette fiction. Pour qu’on puisse accorder que ça bouge (immobilité réelle) il faut en même temps réaffirmer que ça ne bouge pas (sensation d’immobilité), c’est-à-dire sauver la phénoménalité de la sensation d’immobilité dans l’un et l’autre point de vue. La sensation d’immobilité est donc, à cet égard, d’autant moins trompeuse qu’une théorie faisant valoir que la terre n’est pas réellement immobile devra, tôt ou tard, rendre compte de cette sensation d’immobilité que chaque terrien ayant les pieds sur terre est susceptible d’éprouver, que la terre soit ou non réellement immobile, qu’il soit ou non physicien. Il ne s’agit donc pas d’un problème logique qui mettrait en scène deux propositions contradictoires l’une par rapport à l’autre – ça bouge, ça ne bouge pas – afin d’exclure l’une des deux, car les deux propositions ne sont pas au même plan.
[Aristarque de Samos] pose comme hypothèse explicative le double mouvement de la Terre autour du Soleil et autour d’elle-même. […] Aristarque n’a pas eu de succès, et l’on ne sait pas pourquoi. On a dit parfois que l’idée du mouvement de la Terre contredisait trop fortement les conceptions religieuses des Grecs. Je pense que ce sont plutôt d’autres raisons qui ont déterminé l’insuccès d’Aristarque, les mêmes sans doute qui, depuis Aristote et Ptolémée et jusqu’à Copernic, s’opposent à toute hypothèse non géocentrique : c’est l’invincibilité des objections physiques contre le mouvement de la Terre.[35]
Parmi ces objections invincibles figure le fait que, dans le cadre de l’aristotélisme, on ne pouvait pas concevoir comment de tels mouvements auraient pu demeurer indécelables et ainsi rendre compte de la sensation d’immobilité. Pour y parvenir, il faudra « changer le système tout entier et développer un nouveau concept de mouvement : justement le concept de mouvement de Galilée »[36]. Un tel basculement ne s’est pas effectué un jour, une fois pour toutes et pour tout le monde, même si l’histoire de son élaboration en est complexe : cette problématique n’a rien perdu de son actualité car c’est toujours à chacun de prendre en charge la réinterprétation – pour autant qu’elle se produise pour lui – et de s’en affecter, éventuellement progressivement et partiellement.
L’insouciant n’aperçoit pas qu’il glisse un effet (sensation d’immobilité) sur une supposition (immobilité réelle), et c’est ce glissement qui détermine l’effet fictionnel : si la terre est immobile (sensation d’immobilité) c’est parce qu’elle est immobile (immobilité réelle). C’est le scalpel de la réinterprétation qui, incisant l’effet fictionnel, dissocie la pellicule phénoménale médiatrice (sensation d’immobilité) de son corrélat (immobilité réelle) en place de non-avoir-lieu. Pour le physicien, en effet, une telle immobilité réelle n’a jamais eu lieu, elle n’a donc jamais eu aucune efficience réelle, de sorte que, le moment venu, la supposition d’une telle immobilité peut être récusée sans aucun risque et sans que rien ne change réellement, puisque le physicien ne fait qu’ôter du non-avoir-lieu. Dès lors, le physicien n’est plus l’otage d’un absolu, et rien ne fait obstacle pour qu’il puisse envisager la sensation d’immobilité comme une sorte d’invariant pour réinterpréter cette sensation à sa façon comme l’effet des contreparties effectives commandées par les théories physiques et cosmologiques en vigueur[37]. Depuis son point de vue, le physicien peut analyser la position de l’insouciant à l’égard de la sensation d’immobilité comme l’équilibre entre un non-avoir-lieu (immobilité réelle) et ce qui se manifeste comme si cela n’avait pas lieu (les contreparties effectives du physicien), ou, en bref, comme l’équilibre entre nullo et come nullo.
Les guillemets de l’« évidence » sont les mêmes que celles de la « croyance », et rappellent le non-avoir-lieu de ce qui est placé entre ces guillemets pour l’insouciant : ce n’est pas un savoir enfoui, dissimulé, effacé ou incarné, ce n’est pas une sieste d’anamnèse, ce n’est pas non plus un palimpseste révélant peu à peu des sédiments anciens, ce n’est même pas une évidence inaperçue, c’est moins encore, moins que rien, il n’en a pas idée, et il n’a pas non plus l’idée qu’il n’en a pas idée, et ainsi de suite sans fin :
La « connaissance » sensible n’a pas à surmonter la régression à l’infini, vertige de l’intelligence, elle ne l’éprouve même pas. Elle se trouve immédiatement au terme, elle achève, elle finit sans se référer à l’infini.[38]
Quand j’étais enfant, ai-je cru à l’immobilité réelle de la terre ? Qu’y avait-il d’autre qu’une « évidence » enveloppant une question dont je n’avais même pas idée (combien d’humains auront vécu et vivront encore sans même en avoir le soupçon ?).[39]
II. Trace
J’ai convoqué « médiation » pour dire ce qui fait articulation entre des interprétations, pour différer un temps « trace » dont les obliques traversent tant de strates, de paysages et d’harmoniques. Question brûlante à force de résistance, chauffée à blanc, qui s’emble d’autant mieux qu’elle semble ici donnée à la sensibilité, mais là soustraite, ou ailleurs ni l’un ni l’autre. Elle hésite et s’écartèle entre un sens étroit tout empirique et un évanouissement silencieux qui signifie l’exact contraire, la trace qu’il y a encore quand il n’y a plus de traces.
Cet accent porté aux médiations laisse supposer une antériorité de la médiation en tant que ce à partir de quoi il y a lieu d’interpréter. Si la médiation est préalablement donnée, ce sont des traces au sens étroit, mais une telle donation n’est pas compatible avec le non-avoir-lieu : comment pourrait-on comprendre que du non-avoir-lieu donne lieu à des traces (au sens étroit) ? Dans le cas contraire, les traces doivent être constituées, ce qui met déjà en jeu de l’interprétation, et c’est ouvrir l’abîme d’une régression sans fin (et peu importe alors que cette constitution soit antérieure aux interprétations que ces traces permettent d’articuler, ou qu’elles leur soient coextensives et façonnées dans le tissage même de l’articulation, ou peut-être même parfois qu’elles en soient aussi l’effet). Autant la supposition d’une donation peut s’accorder à des traces au sens étroit, autant elle obstrue le passage et bloque la question quand il s’agit d’affronter la régression abyssale de la constitution, ce qui implique un arrêt, temporaire parce que toujours révocable, qui puisse en envelopper le reste énigmatique et secret comme si c’était un fond qui, pour un temps, tienne lieu de lieu, vicariance d’il y a, comme s’il fallait partir de rien. Comment ouvrir « trace », ne pas s’en tenir au sens étroit, et l’amener jusqu’à s’articuler avec du non-avoir-lieu ?
9. La trace s’emblant
Le sens étroit de trace serait évident. Trop. Au point peut-être d’anesthésier parfois le souci critique quand on s’attache à en préciser le contour. Ma première réticence est attisée lorsque trace emprunte la forme de l’empreinte, glisse dans le sillage, se disperse en fumées, etc. : la trace comme conséquence d’un tracement et, par métonymie, du cela qui traça. Je ne conteste pas que cet usage étroit de trace ait sa pertinence, en particulier dans toutes les circonstances ordinaires où la forme de la trace, quelle que soit sa phénoménalité, semble exprimer une signature, un sceau, un trait caractéristique, et bientôt un signifiant du cela qui l’aurait imprimé ou tracé, comme un signe enveloppant la connexion métonymique du tracé à sa cause. La trace est alors comprise comme trace-de, s’exposant à une critique analogue à celle du signe, comme s’il fallait encore donner une dernière chance au signe. La connexion métonymique (le de) qui semble faire la soudure entre une trace et son cela pour obtenir une trace-de-cela est déjà l’effet d’une interprétation. Même si on accorde, dans le cas de traces perceptibles, que la trace soit donnée, le de-cela, quant à lui, n’est pas donné, du moins dans la même donation : la trace doit s’enlever, se décoller, se dissocier, etc., du cela pour qu’elle acquière le statut d’une trace-de. Une trace, en ce sens étroit d’une trace-de, se comprend donc comme un effet dont s’affecte l’interprète prenant en charge l’interprétation produisant cet effet de « de », comme si c’était une fiction. En témoigne la possibilité très générale du leurre, qui ne concerne pas que les interprétations assumées par des humains, loin s’en faut.
Ma seconde réticence, qui prolonge à certains égards la première, est attisée par l’idée d’effacement. On comprend très bien la métaphore de l’effacement de traces perceptibles, quelle que soit leur phénoménalité. Mais il arrive deux questions. D’une part, peut-on concevoir l’effacement de traces qu’on n’aurait pas, d’abord, aperçues, ou du moins qui pourraient l’être ? D’autre part, que devient la différence entre (a) un pas-de-trace (de manière imagée : un tracement qui n’a pas eu lieu), et (b) ce qui résulte d’une trace tracée puis effacée, ou qui résulterait d’un tracé qui s’effacerait dans le mouvement même de son tracement[40] ? La métaphore de l’effacement convoque à son tour un de pour produire un « effacement-de-trace », qui pourra être prolongé en un « effacement-de-(la trace-de-cela) », et plus encore, sans fin, si on conçoit qu’on peut encore effacer ce qui résulte d’un effacement.
– mais c’est justement ce qu’il appelle la trace, cet effacement. J’ai maintenant l’impression que le meilleur paradigme de la trace, pour lui, ce n’est pas, comme certains l’ont cru, et lui aussi peut-être, la piste de chasse, le frayage, le sillon dans le sable, le sillage dans la mer, l’amour du pas pour son empreinte, mais la cendre (ce qui reste sans rester de l’holocauste, du brûle-tout, de l’incendie l’encens)[41]
Au sens étroit d’une trace-de, une trace est perceptible, car c’est le de-cela qui doit être constitué comme l’effet d’une interprétation (et non la trace). Mais avec l’effacement, c’est aussi la trace qui doit être constituée comme l’effet d’une interprétation, car seule une décision d’interprétation peut faire la différence entre (a) un pas-de-trace (un non-avoir-lieu [de trace]) et (b) un effacé-de-trace (un avoir-lieu non perceptible [de trace] résultant de l’effacement d’une trace). Le dialogue se poursuit :
– Qu’elle reste pour très peu de personnes, et pour peu qu’on y touche elle tombe, elle ne tombe pas en cendres, elle se perd, et jusqu’à la cendre de ses cendres. En écrivant ainsi, il brûle une fois de plus, il brûle ce qu’il adore encore mais qu’il a déjà brûlé, il s’y acharne et le sens, je veux dire l’odeur du corps, peut-être du sien. Toutes ces cendres, il s’acharne en elles. [FLC 27]
La métaphore de la trace au sens étroit est d’autant plus féconde et diverse dans ses usages qu’elle prend appui sur l’évidence de la perceptibilité, quelle que soit la phénoménalité intéressée, ce qui suggère avec insistance une manière d’objectivité, une donation de la trace dans sa matérialité perceptible (et peut-être la cendre garde-t-elle trace de ce lien, du moins allusivement). C’est aussi, en contrepartie, ce qui en cerne la limitation : quel sens accorderait-on encore à trace quand on ne pourrait l’associer à rien de perceptible ?
10. Retrait
La compréhension la plus rudimentaire de trace au sens étroit met en jeu un support (ou un milieu) matériel qui puisse se prêter à des altérations (ou à des modifications). On perçoit une trace au sens étroit quand on perçoit une forme (le tracé de la trace), comprise comme une altération du support (ce qui résulte du tracement du tracé), et qui soit suffisamment distinguable de ce qui lui fait entour (prégnance de la trace) pour que cet entour joue le rôle d’un fond relativement auquel la trace est jugée suffisamment déterminée et identifiée. Dans les exemples ordinaires, la prégnance d’une trace est d’autant plus forte que le contraste entre fond et trace est lui-même élevé et que le fond qui lui fait entour est lui-même plus régulier : encoche dans une tablette d’argile lissée, trace de pas dans une neige immaculée, tracé d’encre noire sur un papier blanc, cri perçant dans le silence, points saillants du braille, pointe d’amertume dans une crème sucrée, odeur du café dans un matin printanier, etc. L’indication d’une altération annonce déjà le trace-de-cela.
Je vais dire horizontale cette compréhension de trace pour souligner qu’une telle trace est déterminée comme une « variation contrastante » relativement au fond qui l’entoure, comme si c’était un à-plat. Dès qu’on s’éloigne des cas simples ordinaires, cette compréhension rudimentaire de trace tend à s’éloigner de son ancrage perceptible pour agir comme une analogie permettant déjà d’entendre l’articulation entre fond et trace de manière ouverte et dans des contextes comportant des fonds eux-mêmes complexes où le repérage des variations contrastantes peut relever de décisions d’interprétation.
L’expression imagée d’une variation contrastante évoque allusivement non seulement la neurophysiologie de la perception, humaine ou non, mais aussi, bien au-delà, le principe des interactions, au sein du vivant ou non, et on pourra même aller jusqu’à la dissoudre dans la problématique générale de l’information : « tout est trace »[42] [PANPV 69]. C’est dans le contexte de telles variations contrastantes que la question de la trace croise l’expérience du trait :
Quand je dis trait ou espacement, je ne désigne pas seulement du visible ou de l’espace, mais une autre expérience de la différence. […] Je parle du dessin plutôt que de la couleur parce que dans le dessin, […] il y va de l’expérience du trait, de la trace différentielle. C’est l’expérience de ce qui vient poser une limite entre des espaces, des temps, des figures, des couleurs, des tons, mais une limite qui est à la fois condition de la visibilité et invisible. [PANPV 77]
La tension entre condition de visibilité et invisible est peut-être ici nouée un peu trop serré dans la mesure où la visibilité associée au trait (une forme ou une variation déterminée, par exemple) n’est pas aperçue au même niveau que l’invisibilité de la condition de cette visibilité. En desserrant un peu ce nœud, on peut comprendre que le trait décide de l’assignation d’une limite (pose une limite) qui est à la fois condition de la détermination d’une forme ou d’une variation (visibilité [associée au trait]) et inassignable (invisible [comme trait]). Ce dénivelé entre deux niveaux n’est pas sans rappeler qu’est « inaudible la différence entre deux phonèmes, qui seule permet à ceux-ci d’être et d’opérer comme tels » [DIF 5], mais aussi, quoique dans une autre perspective, que c’est grâce à l’espace (blanc, invisible) entre les lettres (noires, visibles) que les lettres peuvent tenir ensemble. Derrida poursuit :
Naturellement, il y a des traits épais comme on dit, des traits qui ont une épaisseur de visibilité, un gros trait noir, mais ce qui fait trait dans ce gros trait noir, ce n’est pas l’épaisseur noire, c’est la différentialité, la limite qui, en tant que limite, en tant que trait, n’est pas visible. [PANPV 77]
Qu’est-ce qui fait trait en dépit de l’épaisseur noire ? Qu’est-ce qui fait comme si c’était un trait ? D’une part, que l’épaisseur noire ne soit pas elle-même regardée comme autre chose qu’un trait (une forme, une région, un aspect, etc.) et, d’autre part, qu’elle soit référée à la décision d’assignation d’une variation à l’endroit d’une limite inassignable (invisible) entre des régions, formes ou aspects autres qu’elle-même. Dès que l’épaisseur noire [d’un trait] est regardée pour elle-même, c’est-à-dire comme une région, un aspect, etc., au même titre que tout le reste, ce trait s’évapore – il n’y a plus de trait –, et se pose de nouveau la question de la limite inassignable (invisible) entre cette région d’épaisseur noire et ce qui lui fait entour. C’est une régression sans fin dont on peut proposer au moins deux arrêts, comme deux manières de l’arrêter. Le premier, on vient de l’examiner, c’est la fiction du trait : la limite invisible est en rôle de non-avoir lieu, le trait en rôle d’effet fictionnel, et la variation contrastante (l’épaisseur noire) en rôle de contrepartie effective. C’est parce qu’on suspend l’interprétation du trait comme autre chose qu’un trait (une région d’épaisseur noire) que le trait – et même plus précisément : l’effet-de-trait – peut fonctionner comme un supplément qui arrête la régression sans fin, mais en dégageant un reste (une limite invisible) associé à une contrepartie effective (variation contrastante). Un second arrêt de la régression sans fin consiste à s’abstenir de vouloir assigner la limite et à la laisser flotter, ce qui conduit à des techniques dans lesquelles tout est fait pour renforcer, en quelque manière garantir, le caractère inassignable de la limite. Par exemple, la technique du sfumato de Léonard de Vinci dont Daniel Arasse synthétise les enjeux :
Au XVIIe siècle, on dit que la grâce c’est le mouvement, et qu’il faut savoir le représenter car il est l’essentiel de la peinture. Mais chez Léonard, ce n’est pas seulement l’essentiel de la peinture, c’est l’essentiel du monde. Le monde est mouvement, le monde n’est que mouvement et les formes fixes ne sont que des conventions. Quand je dis formes fixes, je pense par exemple à l’anatomie : dans les dessins de Léonard les parties de l’anatomie sont fixes, elles sont vraies mais ne sont pas visibles et Léonard le dit très bien. On ne voit pas dans la nature ce qu’il représente dans ses dessins, non seulement parce qu’il synthétise ce qu’il a vu, mais aussi parce qu’on ne voit pas les lignes de contour dans la nature On ne les voit pas, tous les peintres le disent, Goya, Delacroix, et Léonard est le premier à le dire. Alberti le disait déjà, il ne faut pas les voir en peinture, mais Léonard va plus loin, on ne les voit pas dans la nature, même si elles sont vraies. Donc, pourquoi construire un monde à partir de géométries et de lignes alors que le monde n’est que fluidité et passage ?[43]
J’ai cité ce passage en longueur car il montre comment le rapport des traits et des contours (les limites inassignables) peut aussi être mis en œuvre comme un dialogue à distance où les deux approches sont duales, chacune donnant à voir ce qui demeure invisible au regard de l’autre car, dans le sfumato, c’est le trait qui demeure invisible. Dans les études qu’il consacre à la musique, Jankélévitch insiste sur le caractère inassignable du seuil qui sépare le pianissimo et le silence chez Debussy :
Mais le grand génie de l’infinitésimal c’est évidemment Debussy chez qui toutes les transitions différentielles sont représentées entre le pianissimo et le silence.[44]
Entre deux régions de couleurs ou de blancheurs, de musique ou de silence, l’inassignable laisse apercevoir l’hésitation d’une ambigüité entre deux interprétations : on ne sait décider de la fin de l’une ni du commencement de l’autre, et en chaque point ou instant de cette hésitation, chacune des deux peut dire à l’autre « ici, c’est encore moi, ce n’est déjà plus toi », tandis qu’à l’instant d’apercevoir cette hésitation pour la thématiser, c’est déjà la limite entre cette hésitation et ce qui lui fait entour qui s’annonce, elle aussi inassignable, et c’est encore une régression sans fin, et ainsi de suite sans fin. En se tenant en retrait des régions et des formes, en restant abstrait des prégnances figuratives, en se refusant à entrer dans l’hésitation des limites, le trait ne se soustrait au vertige de l’inassignable qu’en se niant comme forme ou région comme s’il était tracé sur un calque qui viendrait se superposer en imposant la variation contrastante de son épaisseur noire. Et peut-être pourra-t-on déchiffrer dans le fond de cette difficulté le filigrane ou l’écho du souci renouvelé de l’articulation entre deux sortes d’approches, les unes plutôt discrètes et les autres plutôt continues, où le balancement plutôt… plutôt… écarte l’opposition figée de termes irréductibles issus d’une disjonction sans reste, pour suggérer une indissociable complémentarité, chacune suppléant à ce qui n’a pas lieu dans l’autre, mais au prix d’une ambigüité irréductible[45], comme le trait précis des dessins d’anatomie ne cesse de dialoguer silencieusement avec les innombrables glacis quasi-transparents du sfumato.[46]
11. Comme si c’était une trace
L’analogie de la trace au sens étroit atteint sa limite lorsque la variation contrastante s’évanouit, et avec elle la différence sensible entre fond et trace, de sorte que la trace va devenir indécelable. Juste avant que cet évanouissement ne soit complet, je peux apercevoir, au moins comme une expérience de pensée, la faible lueur du presque-rien qui retient encore un instant une variation perceptible :
Écoutez plus attentivement ! Le pianissimo bien qu’il soit encore audible, est la forme presque insensible du supra-sensible : il est donc à peine sensible ; à la frontière du matériel et de l’immatériel, du physique et du transphysique, le presque-rien désigne l’existence minimale au-delà de laquelle serait l’inexistence, le rien pur et simple.[47]
À proximité du presque, l’imminence du rien dessine, sous les traits d’un évanouissement, ce qu’un éveil ou un événement devrait franchir en sens inverse. L’évanouissement, en ce sens, n’est pas un amenuisement dans l’à-plat d’une chronologie linéaire et horizontale, mais une manière de tangence dans la verticalité, un « infinitésimal d’incoprésentabilité », pourrait-on risquer. Et peut-être cette « évanessence » parvient-elle à retenir encore un instant ce presque-rien grâce auquel se laisse entrapercevoir ce que c’était.
[le système de la perspective dominant, celui d’Alberti] est concurrencé et même mis à bas par des systèmes radicalement différents, notamment l’abstraction. Avec Carré blanc sur fond blanc, c’est terminé, il n’y a plus de perspective.[48]
Juste avant que cette perspective ne s’évanouisse, je retiens ce trait qu’elle demande un double regard, une double lecture, une double interprétation. D’une part, on ne se laisse prendre dans les rets d’un effet de perspective que pour autant qu’on soit parvenu à occulter ce qui est donné à voir, dessin ou peinture, comme [si c’était seulement] une composition abstraite de traits et de masses colorées en à-plat. D’autre part, l’effet de perspective implique du non montré, du non figuré, le côté des choses qui n’est pas tourné vers nous, comme l’envers d’un décor opaque, ce que je dois imaginer tenu en réserve dans ce qui est figuré comme une condition pour que ce qui est figuré puisse avoir l’aire de se gonfler en volume et ainsi avoir l’air d’une perspective.
La perspective, mise à bas ? Pas si sur. Est-ce si sûr que le carré blanc soit sur un fond blanc[49] ? Si je regarde le tableau comme un à-plat, je vois un carré d’un blanc légèrement bleuté entouré d’un blanc un peu ocré et, au moins en français, le sur de [carré] blanc sur [fond] blanc peut s’entendre quasiment à plat comme lorsqu’on dit ton sur ton. Il reste que le titre n’est pas [carré] blanc entouré de [fond] blanc. Je voudrais seulement changer de perspective, entendre l’invitation parergonale[50] du sur et lui faire droit, mettre le titre en mouvement, jouer encore d’une double interprétation pour regarder le tableau comme si c’était en perspective, un carré blanc sur un fond blanc, non pas comme une représentation à la Alberti, mais comme si c’était un carré qui serait situé devant le fond relativement à mon regard. Admettons. Mais le tableau n’est-il pas le même dans les deux cas ? En quoi y aurait-il changement ? Quelle serait la différence entre blanc entouré de blanc et blanc sur blanc ? La même que celle entre un à-plat et une perspective ! Mais quelle différence dans le cas particulier de ce tableau où il n’y a ni géométrie, ni horizon, ni point de fuite… ? La différence est dans la décision de concevoir qu’il y a ce qui est soustrait au regard, cette partie du fond, tenue en réserve dans le tableau parce qu’occultée par le carré blanc qui vient sur ou devant, cette partie dont je ne sais rien, car rien ne m’oblige à supposer, par exemple, que le fond alentour du carré se prolonge du même blanc sous ou derrière le carré. Le titre compte deux blancs, le blanc bleuté du carré et le blanc ocré de son entour. Mais j’en compte un troisième, le supplément qui reste « en blanc » dans mon imagination – una cosa mentale –, suppléant à ce qui fait défaut dans le tableau, cette part indéterminée du fond qui n’a pas lieu, qui ne peut pas avoir lieu en tant qu’elle serait peinte et visible, mais que je dois « ajouter » comme « soustraite » pour assurer le sur, l’effet fictionnel d’un comme si c’était sur.
Je dirai verticale cette compréhension différentielle de trace : la différence entre ce que je perçois, en tant que fond avec trace, et ce que j’imagine, conçois ou suppose en tant que fond sans trace, ce qu’il y aurait s’il n’y avait pas la trace. Différence verticale entre deux à-plat horizontaux incoprésentables : décider d’une trace, décider qu’il y a trace, c’est d’abord affirmer l’incoprésentabilité des deux à-plats horizontaux, avec trace et sans trace, relativement auxquels la différence – donc aussi la trace – trouve sa détermination. Avant d’être ressaisie, peut-être, dans les rets d’une trace-de, une trace vaut d’abord en tant que trace de l’interprétation qui la constitue telle pour l’interprète qui assume cette interprétation et s’affecte de l’effet de trace qu’il produit. On pourrait dire qu’une trace différentielle n’est qu’à demi-perceptible, non seulement parce que les deux termes de la différence sont incoprésentables, mais aussi parce que l’un est imaginaire tandis que l’autre est perceptible (c’est peut-être une autre manière d’entendre que la trace « n’est ni perceptible ni imperceptible » [O&G 76]). C’est dire aussi qu’une trace différentielle n’est jamais, jamais donnée comme telle à la passivité d’une sensibilité, ce qui signifie ici qu’une trace différentielle se laisse analyser comme une construction fictionnelle : d’une part, l’effet fictionnel est porté par l’analogie avec le sens étroit de trace (une trace [différentielle, verticale] comme si c’était une trace [au sens étroit, horizontale]) et, d’autre part, la contrepartie effective est étroitement liée au mouvement d’interprétation qui fait la différence.
12. L’évanouissement
J’ai esquissé ici, sous la forme d’un apologue, une interprétation « verticale », c’est-à-dire, parmi d’autres possibles, une interprétation qui intègre l’incoprésentabilité en tant qu’elle correspond au point de vue d’un spectateur regardant le tableau. Il ne s’agit pas d’une étude « horizontale » (dimensions d’espacement de la spatialité et de la temporalité) du Carré blanc sur fond blanc, c’est-à-dire une étude chronologique, historique, critique ou technique du tableau[51], qui rappellerait le contexte suprématiste, les intentions de Malevitch, les différentes étapes de la réalisation du tableau, les différentes couches ou dépôts de peinture ou de mine de plomb, etc. Dans le point de vue vertical (dimension d’espacement de l’incoprésentabilité), ce qui est en jeu est d’abord le déploiement des interprétations que je peux associer à ce que je perçois, maintenant, dans le moment contemporain de l’interprétation elle-même : c’est la dimension de la constitution d’une trace différentielle, dimension qui s’impose d’autant plus dans des contextes où je [ne] perçois « rien », c’est-à-dire aucune trace au sens étroit.
Dans le tableau de Malevitch, le léger contraste entre le carré blanc bleuté et le fond ocré est encore perceptible. Mais se taire n’est pas chuchoter, ni parler bas, ni même suspendre un instant le flux des paroles (comment pourrais-je encore m’être tu quand je ne parlais pas ?). Il reste encore à laisser s’évanouir l’exigence d’une variation contrastante perceptible pour délier la trace de l’analogie trop serrée avec la trace au sens étroit. Lorsque tout contraste perceptible s’évanouit, il n’y a qu’une décision d’interprétation pour constituer une trace, et qui puisse, en quelque manière, faire la différence à partir de rien. Cet évanouissement de la variation contrastante en entraîne un autre, celui de la différence perceptible entre pas-de-trace (non-avoir-lieu d’une trace) et trace indécelable (avoir-lieu d’une trace, mais non perceptible). Comment pourrais-je encore me taire si on ne pouvait pas faire la différence entre une absence de voix et une « voix de silence »[52] ? Autant, dans la conception de la trace au sens étroit, la variation contrastante est déterminante au détriment de l’interprétation, autant, dans la conception différentielle, l’interprétation sera d’autant plus déterminante que la constitution de la trace dépendra moins de la perceptibilité.
Fig. 1 – Le mouvement de l’interprétation.
En avant-plan, le tableau que j’intitule Carré blanc sur fond coloré dans son état final qui doit être regardé comme entièrement blanc. C’est à ce tableau que je fais jouer le rôle d’un fond avec trace, même s’il n’y a aucun contraste apparent ni aucune trace au sens étroit qui soit perceptible. Je décide d’imaginer, en arrière-plan, un fond blanc, à l’exception d’une partie centrale colorée – rien ne m’oblige à n’imaginer que des fonds uniformes –, auquel je fais jouer le rôle d’un fond sans trace. Ce fond sans trace est incoprésentable avec le tableau compris comme fond avec trace. J’ai suggéré en pointillés, entre les deux fonds, une interprétation concevable de ce qui donne lieu à ce que je décide de regarder comme une trace [non perceptible] dans le tableau final, à savoir une différence entre ce qui est perçu (en avant-plan) et ce qui est imaginé comme faisant fond (en arrière-plan). Dans cet apologue, on pourrait remarquer que le titre du tableau donne à « voir » (imaginer, una cosa mentale) ce que le tableau ne donne pas à voir (percevoir). Le mouvement de l’interprétation « remonte » en quelque manière vers un fond sans trace imaginé ou supposé, pour ensuite « redescendre » vers le fond avec trace pour recueillir la trace comme une différence, comme s’il s’agissait, pour cette trace, de se manifester : en ce sens, et de manière très générale, le premier moment de l’interprétation « remonte » ce que le second moment va « redescendre » comme s’il s’agissait d’une manifestation[53]. Dans cette analyse, rien n’impose – mais rien n’exclut – de supposer des tracements de traces et/ou des effacements des traces ainsi tracées ; corrélativement, rien n’impose donc – ni n’exclut – de lier une trace à un cela pour la constituer en une trace-de-cela.
Ce schéma de base se prête à de multiples lectures et mises en scène. On peut imaginer qu’il s’agit d’un effacement, comme dans l’œuvre de Robert Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing (1953), qui présente une feuille de papier presque vierge, présentée dans un encadrement doré, obtenue par l’effacement méticuleux d’un dessin de Willem de Kooning. On peut aussi imaginer un recouvrement, comme dans les Chroniques de Bustos Domecq[54] où le peintre Tafas, d’une « lointaine origine musulmane », contourne les interdits de représentation du « “Coran de Mahomet”, pour ne rien dire des juifs russes de la rue Junin » :
Il peignit d’abord avec une fidélité photographique des vues de Buenos Aires […]. Il ne les montra à personne […]. Il les effaça ensuite avec de la mie de pain et de l’eau du robinet. Il les recouvrit enfin d’une couche de cirage jusqu’à ce qu’ils devinssent complètement noirs. Mais il eut le scrupule de conserver à chacune de ses toiles, qui étaient devenues toutes semblables et d’une noirceur identique, son nom exact, et vous pouviez lire dans la salle d’exposition, Café Tortoni ou Kiosque aux cartes postales.
Avant les œuvres de Malevitch, de Rauschenberg, de Klein et de bien d’autres, l’idée du monochrome attisait déjà les sarcasmes autant qu’elle a inspiré les penseurs ou les humoristes, en témoigne, par exemple, l’Album Primo-Avrilesque d’Alphonse Allais[55].
Une autre mise en œuvre du schéma consiste à recueillir un non-avoir-lieu comme trace. Par exemple : une amie devait venir me rejoindre à la Philharmonie, mais sa place est restée inoccupée ; le fond sans trace est constitué par mon attente que mon amie assiste au concert et soit assise à sa place ; mais je constate – c’est le fond avec trace – que la place est demeurée inoccupée. Je ne peux guère imaginer quelque tracement ou effectuation, parce qu’il me faudrait accorder que ce soit un non-avoir-lieu qui ait effectué ce « demeurer inoccupée » de la place que je recueille comme trace (et ce n’est pas non plus un tracement suivi d’un effacement, comme si elle était venue quelques instants puis repartie aussitôt). C’est mon attente et mon interprétation qui déterminent le fond sans trace relativement auquel je peux constituer, par différence, ce qui fait trace dans le fond avec trace perçu : elle n’est pas venue. Dès lors qu’on n’associe pas une trace à l’accomplissement d’un tracement, mais plutôt à l’interprétation qui constitue la trace comme une différence à demi-perceptible, on franchit le pas qui ouvre la trace au non-avoir-lieu d’un tracement, c’est-à-dire à la possibilité de recueillir comme trace – en analogie avec une trace au sens étroit – ce qui n’a pas lieu, la trace de ce pas, et qui, au regard de la trace au sens étroit, ne serait rien de perceptible, rien d’autre, précisément, qu’un pas-de-trace.[56]
13. Réinterpréter (2)
Ce détour par l’imperceptible invite à faire retour sur la trace au sens étroit qui semble ne pas requérir d’interprétation, comme si l’interprétation était en quelque manière diluée dans l’évidente supposition d’un entour prolongé sous la trace de telle sorte que le contraste avec le fond soit suffisant pour que sa prégnance s’impose. On peut donc réinterpréter une trace au sens étroit en à-plat (fig. 2 ci-dessous, schéma 1, à gauche) dans l’approche différentielle : il suffit d’imaginer (schéma 2, à droite) un fond sans trace obtenu simplement par prolongement, au lieu de la trace, de l’entour de la trace tel qu’il apparaît dans le fond avec trace perçu :
Fig. 2 – Réinterprétation de la trace au sens étroit.
Certes, au quotidien, dans la plupart des cas, nos pratiques et nos habitudes, tant sociales que perceptives et cognitives, nous dispensent de ces exercices d’interprétation différentielle, et les merles noirs n’ont pas attendu d’avoir lu le texte que je suis en train d’écrire pour surveiller le cerisier et savoir ne picorer de leur bec jaune piquant que les cerises grenat à pleine maturité toutes gonflées de sucre. Grâce à cet exemple très simple, je voudrais attirer l’attention sur le fait qu’une réinterprétation fonctionne à double sens, de sorte que le comme si se laisse lui aussi comprendre en un double sens. On utilise ici le fond avec trace, tel qu’il est perçu, comme la médiation articulant les interprétations. Ces deux sens ne sont pas symétriques, car, dans le sens 1→2 (voir fig. 2), la réinterprétation dépasse, amplifie ou généralise en ce sens qu’on regarde une trace en à-plat (schéma 1, à gauche) comme si c’était seulement un cas particulier de trace différentielle (schéma 2, à droite) ; au contraire, dans le sens inverse 2→1, la réinterprétation réduit, appauvrit, simplifie, aplatit, etc., en ce sens qu’on regarde une trace produite par une interprétation différentielle (schéma 2) comme si c’était seulement une trace en à-plat (schéma 1). Corrélativement, les rôles s’échangent : dans le premier sens 1→2, c’est l’approche différentielle qui joue le rôle d’un effet fictionnel, et l’analyse en à-plat celui d’une contrepartie effective (c’est l’exemple des merles) ; dans le sens inverse 2→1, c’est la trace en à-plat qui joue le rôle de l’effet fictionnel, et c’est l’interprétation différentielle qui joue le rôle de la contrepartie effective (c’est l’exemple de Carré blanc sur fond blanc). On notera que les deux sens de basculement ne sont pas non plus équivalents, car si toute trace perceptible au sens étroit en à-plat peut être réinterprétée comme une trace différentielle, l’inverse ne se vérifie pas.[57]
14. Abîme
Dans cette étude de la trace différentielle, j’ai raisonné comme si le fond sans trace pouvait valoir en tant que terme premier pour la constitution de la différence. Ce fond sans trace est certes seulement hypothétique, mais il est clair que, quelle que soit l’hypothèse de ce fond, même s’il est supposé uniforme, rien n’empêche de l’interpréter, à son tour, comme s’il s’agissait d’un fond avec trace associé à une trace différentielle imperceptible relativement à un autre fond sans trace, et ainsi de suite, sans fin. Cette ouverture au sans fin est liée au fait que l’approche différentielle permet de réinterpréter des fonds quels qu’ils soient, quand bien même ils seraient sans trace perceptible au sens étroit des traces en à-plat, comme si c’était des fonds avec trace (c’est l’exemple du carré blanc sur fond coloré, fig. 1). C’est une problématique régressive qui ouvre l’abîme de l’impossibilité qu’il y ait un fond qui soit premier, ultimement sans trace ou absolument originaire, pas même « le vide papier que la blancheur défend »[58], pas même le secours de quelque infini qui le somme et l’accueille dans le repos lointain de son horizon. Il n’y a donc non plus aucune trace ultimement première ou absolument originaire qui pourrait venir dans le premier matin d’un fond absolument originaire qu’il n’y a pas.
Mais si le motif régressif est sans fin en son principe, on ne peut le mettre en œuvre et le rendre praticable, à des fins différentielles, par exemple, qu’à la condition de décider d’un arrêt, en l’occurrence d’une hypothèse de fond, arrêt toujours révocable par l’effet du motif régressif lui-même, et se tenant au milieu de l’abîme, en-deçà de quoi reste l’abîme inépuisable qui, en quelque manière, le porte. Si tout ce qui est appelé à faire office de fond n’assume son mandat qu’à voiler ou envelopper (et peut-être représenter) l’abîme qui l’y porte, c’est en tant qu’il tient lieu de ce fond qu’il n’y a pas. Et il ne peut en tenir lieu qu’à être regardé comme si c’était un fond sans trace, au sens étroit de la trace en à-plat, comme si c’était un fond qui soit premier, non révocable et délié de cet abîme différantiel. Incertain comme si : le leurre du fond – à défaut de certitude.
Il y a dans le cogito cartésien, certitude première (mais qui, pour Descartes, repose déjà sur l’existence de Dieu), un arrêt arbitraire, qui ne se justifie pas par lui-même. […] En réalité, dans le cogito, le sujet pensant qui nie ses évidences, aboutit à l’évidence de cette œuvre de négation, mais à un niveau différent de celui où il a nié. […] C’est un mouvement de descente vers un abîme toujours plus profond et que nous avons appelé ailleurs il y a, par-delà l’affirmation de la négation.[59]
III. Événement
15. Verticalité
Imaginer l’incoprésentabilité comme verticale, par opposition à l’à-plat horizontal des deux dimensions de la spatialité et de la temporalité, est une manière de suggérer que ce qui peut être déployé dans cette verticalité ne peut être réduit à cet à-plat horizontal sans s’y abolir en quelque manière, que ce soit en tant qu’il s’y manifeste, s’y projette, s’y condense ou s’y consume : traces énigmatiques ou imperceptibles. Ce que figure l’image de la verticalité, c’est cette une en plus, une dimension ajoutée en tant que soustraite, une dimension en plus de l’à-plat horizontal, quel que soit le nombre de dimensions déjà agglomérées dans cet à-plat. Dans une camera obscura, aussi bien que dans l’œil, seuls les rayons lumineux qui passent à travers l’unique point d’ouverture (ou la pupille) forment l’image obtenue, inversée, sur le fond opposé à ce point (ou sur la rétine), et plus l’ouverture sera petite, et plus l’image sera nette. L’effet de représentation d’une perspective comme celle d’Alberti s’apprécie dans la comparaison entre ce que notre perception visuelle perçoit (dans les trois dimensions ordinaires) et ce que propose l’image (sur les deux dimensions d’un plan)[60]. Si la perte d’une dimension conditionne la possibilité d’une réduction à l’à-plat d’une image, elle impose en contrepartie un effet de limitation : la représentation est liée à un point de vue, qui résonne ici en écho comme ce qui n’est point vu, car l’image obtenue ne recueille, de ce qui est situé devant la chambre noire (ou situé devant nous), que ce qui est tourné vers elle (ou vers nous).
L’analogie de la perspective permet déjà de suggérer ce que peut signifier la verticalité comprise comme une dimension en plus de l’à-plat horizontal (spatialité et temporalité) ; mais cette verticalité excède l’analogie en ce sens que cette dimension verticale est toujours en plus, et qu’on peut seulement la supposer soustraite ou évanouie dans l’à-plat horizontal, c’est-à-dire qu’on ne peut rien faire d’autre ni de mieux que de l’inventer, l’élaborer ou la découvrir en interprétant les traces – perceptibles ou non – que nous décidons de lui associer. On a reconnu, dans la figure d’une verticalité ajoutée comme soustraite, le motif du mouvement de l’interprétation déjà croisé dans l’étude des traces (voir fig. 1). Cette verticalité, qui correspond à l’incoprésentabilité, participe de ce qui empêche que tout soit donné tout d’un coup. Elle signifie ainsi que toute assignation d’à-plat est une manière de situer cette assignation relativement à cette verticalité, non pas comme une altitude qui serait mesurée absolument en référence à un sol lui-même absolument originaire (qu’il n’y a pas), mais de manière différentielle, comme l’aviateur sait que l’aiguille de l’altimètre indique la différence entre la pression de l’air observée dans l’avion et une pression servant de référence. Ce qu’il convient d’entendre ici : cette verticalité figure ce qui, indissociablement, intervient comme une condition de la possibilité de cet à-plat et s’impose à lui comme un effet de limitation.
16. Défaut
L’analogie de la perspective laisse apercevoir que la supposition d’une dimension en plus d’un à-plat est indissociable de la supposition d’un reste (reste à montrer, reste à enregistrer, reste à dire, etc.) se manifestant comme un défaut au niveau de l’à-plat, défaut qui, lui aussi, doit être ajouté en tant que soustrait dans cet à-plat, faute de quoi cette supposition d’une dimension excédentaire serait éliminable, puisque rien – du moins à l’égard de ce défaut – ne viendrait s’opposer à sa complète manifesteté ou résorption dans cet à-plat-là. La difficulté d’approcher ce qui fait défaut est donc double : d’une part, en tant qu’ajouté comme soustrait dans l’à-plat, il doit demeurer indécelable, imperceptible, etc., relativement à cet à-plat ; d’autre part, il joue deux rôles indissociables, articulés l’un à l’autre comme le recto et le verso d’une feuille de papier, le rôle d’une condition de possibilité à l’égard de la dimension excédentaire, pour la raison qu’il en empêche la résorption dans l’à-plat (et donc à cet égard s’en porte garant), mais aussi, exactement pour la même raison, celui d’un effet de limitation (ou de reste) qui se manifeste comme ce défaut, et qui participe de ce qui empêche que tout soit donné tout d’un coup, du moins dans cet à-plat.
Dans le cas de la perspective, seul celui qui veut voir un dessin ou une peinture comme une représentation en perspective (et non comme un à-plat de traits et de masses colorées) « voit » ce qui y fait défaut : l’autre côté des choses, celui qui n’est pas tourné vers nous ou vers le point de vue de la perspective. Dans l’interprétation verticale que j’ai proposée de Carré blanc sur fond blanc, il n’y a de retrait du fond blanc sous ou derrière le carré blanc que pour qui veut entendre l’invitation du sur comme si c’était une perspective. Dans le cas du cinématographe, où le mouvement joue le rôle de la dimension excédentaire, seul celui qui veut voir une inscription de mouvement dans une suite linéaire de photogrammes, peut « voir » que c’est précisément l’inscription du mouvement qui fait défaut dans l’à-plat médiateur de la pellicule ; et lors de la projection, c’est au spectateur qu’il revient de prendre en charge la contrepartie effective – processus neuro-perceptifs, cognitifs et d’interprétation – de ce qui n’est pas enregistré, ni a fortiori perceptible, pour synthétiser des effets de mouvement qu’il n’aura jamais perçu mais dont il s’affectera[61]. Dans le cas du langage, quelle que soit la modalité médiatrice de l’à-plat des traces asémiques (voisée, graphique, gestuelle, etc.), c’est la dimension sémique qui est excédentaire, de sorte que c’est à qui veut donner sens à ces traces de prendre en charge, en tant qu’interprétation produisant les effets de sémie dont il s’affecte, la contrepartie effective de ce qui fait défaut comme trace.
Ces quelques exemples suffisent pour souligner que ce qui fait défaut dans l’à-plat n’est pas imputable à la phénoménalité ou à la matérialité des milieux médiateurs – ce qu’on dira en bref, quoique métaphoriquement et improprement, les supports – mais au principe même du mouvement d’une interprétation qui, dans un premier moment, « remonte » en tant que décision ou volonté d’interprétation, ce qu’au second moment, elle « descend » comme manifestation, tracement ou représentation (comme dans la fig. 1). C’est lors de la « descente » que le reste est déterminé comme retenu en réserve dans le mouvement même de cette manifestation (tracement, représentation, etc.), et c’est ce reste qui, au plan de la médiation, se manifeste (se trace, se représente, etc.) comme ce qui fait défaut, et c’est en ce sens qu’on pourra dire que ce qui fait défaut est adossé à la manifestation (au tracement, à la représentation, etc.). Le subtil scalpel de la réinterprétation sépare ainsi la médiation (ce qui articule les interprétations et qui procure un avoir-lieu pour ce qui fait défaut en tant qu’il témoigne de la dimension excédentaire), et le milieu médiateur empirique (la consistance matérielle des traces de la médiation, ce qu’on dit un support pour faire bref : molécules d’air, papier de chiffon, signaux électroniques, etc.).
17. Introuvable
À l’égard d’un à-plat, la détermination majeure de la médiation est la corrélation entre ce qui fait défaut et la dimension excédentaire, tandis que les supports, potentiellement multiples, ne sont choisis que pour autant qu’ils conviennent aux autres caractéristiques de la médiation. Pourquoi seulement aux autres ? Pour la raison que ce qui fait défaut n’est tel qu’ajouté comme soustrait au plan de la médiation ! Le scalpel de la réinterprétation procède ainsi à une sorte d’incision fictionnelle qui sépare ce qui fait défaut, au plan de la médiation, et son corrélat, au plan empirique du support, comme non-avoir-lieu : c’est déjà (ou encore) le schéma d’une construction fictionnelle. De manière concise, on pourra dire : quant à ce qui fait défaut au plan de la médiation, rien ne manque au plan des supports. D’une part, ce qui fait défaut n’est pas imputable à l’empiricité du milieu médiateur. Ainsi, par exemple, le fait que l’autre côté des choses fasse défaut dans une perspective n’est évidemment pas imputable au support (papier, toile, ou autre) ; le défaut d’une inscription du mouvement n’est imputable ni à la photographie, ni aux pellicules, ni non plus aux dispositifs électroniques qui remplacent l’argentique ; le fait que le sens d’un dire voisé ne se trace pas comme tel n’est imputable ni aux molécules de l’air ambiant, ni aux téléphones ; de même le fait que le sens d’un écrire graphique ne s’inscrive pas comme tel n’est imputable ni à l’argile, ni au papyrus, ni au papier de chiffon, ni aux dispositifs électroniques habituels ; etc. D’autre part, ce qui fait défaut, au plan médiateur, a pour corrélat, au plan empirique, un non-avoir-lieu, et non pas un trou (un vide, une lacune, une béance, un gouffre, un abîme, etc.) qui serait manifeste, perceptible, objectivable, etc. Dire que rien ne manque au plan empirique des supports signifie : ce qui fait défaut [au plan médiateur] ne fait pas trou [au plan du milieu médiateur empirique des supports].
Dans le cas d’une perspective à la Alberti, le côté des choses opaques qui n’est pas tourné vers nous fait défaut en ce sens qu’il n’est pas peint. Pourtant, ce qui fait défaut ne fait pas trou dans la toile ou le dessin. Comment comprendre cela ? Parce que la place est déjà prise ! Par quoi ? Par la peinture du côté tourné vers nous des choses opaques, c’est-à-dire par ce grâce à quoi l’interprétation trouve prise pour décider d’une perspective, et ainsi « voir » ce qu’elle ne peut pas voir. On pourrait même aller jusqu’à remarquer que si ce qui fait défaut (au plan de la médiation) faisait trou (au plan du support), c’est le côté tourné vers nous des choses opaques qui ne serait pas peint (il « tomberait en trou »), de sorte qu’il n’y aurait pas non plus de prise pour une interprétation qui voudrait affirmer l’existence d’un côté non tourné vers nous pour des choses qui ne seraient même pas peintes, et il n’y aurait donc rien qui fasse défaut, ni non plus, par conséquent, rien qui doive faire trou. Dans le cas du dire ou de l’écrire, quelle qu’en soit la modalité (voisée, graphique, gestuelle, etc.), la place est déjà prise par les traces : une trace doit d’abord assumer sa manifesteté (une trace comme résultant de son tracement, ou éventuellement de sa constitution différentielle), ce qui occupe la même place que la trace prise dans un effet de sémie (la trace comme trace-de-cela). C’est peut-être dans le cas du signe que cette articulation est la plus nette : le côté du signifié est, au côté du signifiant, ce que l’autre côté non peint des choses (ce qui fait défaut sans faire trou) est au côté tourné vers nous et qui est peint[62].
Ces remarques permettent peut-être de mieux comprendre pour quelles raisons le recours à des vocables comme manque, vide ou rien, par exemple, peut devenir problématique dès qu’on les échange les uns avec autres et qu’on les laisse glisser aux différentes places dont j’ai proposé une possible mise en perspective, en particulier les places du reste, du défaut et du trou. Et peut-être parfois, dans certains usages, ces vocables sont aussi convoqués pour signifier l’articulation de ces trois places, la troublante articulation entre un reste (au plan de la dimension excédentaire) qui se manifeste comme ce qui fait défaut (au plan de la médiation) sans pour autant faire trou (un non-avoir-lieu au plan empirique des supports) : un manque qui ne manque pas, un vide qui n’est pas vide, un rien qui n’est pas rien, etc.[63]
18. Exister
Comme je l’ai déjà souligné, une réinterprétation implique un changement d’interprétation, ce qui suppose qu’on prenne appui sur une ambiguïté et qu’on en joue comme d’un pivot autour duquel articuler ces interprétations. La corrélation entre un défaut [au plan de la médiation] qui ne fait pas trou [dans l’empirie] et une dimension ajoutée en tant que soustraite [dans l’à-plat] peut jouer comme une telle ambiguïté quant aux positions d’acceptation ou de refus à l’égard de ce défaut et de cette dimension, puisqu’elle signifie en particulier que ce qui fait défaut est aussi ce qui pourrait en apporter un témoignage, une preuve ou une garantie. Autrement dit, relativement à l’à-plat où la discussion se joue, il ne peut y avoir ni preuve ni réfutation de la supposition qu’il y aurait ou qu’il n’y aurait pas un tel défaut, une telle dimension et leur corrélation. Il ne s’agit pas de viser, d’atteindre ou de dépeindre quelque structure ou entité métempirique, mais de proposer un schéma d’interprétation, qu’on décide ou non d’appliquer, qui se laisse apercevoir comme une construction fictionnelle dans laquelle le trou [introuvable] est en place de non-avoir-lieu, le défaut et la dimension excédentaire en place d’effet fictionnel, tandis que les contreparties effectives auront pour tâche de faire exister cette dimension, c’est-à-dire de faire comme si ce défaut et cette dimension « existaient ». Il faut aussitôt souligner que ce faire comme si n’est pas une manière de simulacre ou d’imitation qui viendrait en second à l’égard d’une « existence » qui serait déjà assurée de soi, car cet exister ne peut se voir attribuer d’autres détermination et effectivité que celles d’un faire comme si, c’est-à-dire un faire des contreparties effectives en tant qu’associées au comme si des effets fictionnels. Par conséquent, dans le cadre de ce schéma, un tel exister ne suppose ni n’implique aucune présence, extériorité, transcendance, métempirie, ni aucun dehors ; a fortiori, ce schéma ne sous-entend ni ne met en œuvre aucun accès, ni aucune proximité ou immédiateté à l’égard de telles résidences ou entités et, à cet égard, il s’accorde au principe de l’asémie des traces : il n’y a d’effets de sémie que comme effets d’interprétations effectives. Le recours au mode infinitif – exister – souligne que cet exister n’est rien d’autre ni rien de plus que l’effet fictionnel résultant du faire comme si de contreparties effectives.[64]
Une extrême prudence s’impose donc ici quant à l’exister et aux lectures qu’on peut donner à un tel schéma. Comme les exemples l’ont clairement montré, le schéma de la corrélation entre défaut de trace et dimension excédentaire peut être appliqué à des contextes très divers, aussi bien pratiques et théoriques que fondamentaux, transcendantaux et métaphysiques ; et en outre, il peut être appliqué aussi bien dans le sens d’une manifestation (aspect « descendant » du mouvement d’interprétation), que dans celui d’une élévation (aspect « montant » du mouvement d’interprétation). Dans le cas du cinématographe, par exemple, le mouvement (dimension excédentaire) ne s’inscrit pas comme tel sur la pellicule (côté manifestation, le mouvement fait défaut), mais lors de la projection, c’est quand même à partir de cette pellicule, via le dispositif de projection, que les spectateurs peuvent synthétiser un effet de mouvement (côté élévation, c’est grâce à ce qui fait défaut[65] que la pellicule peut être interprétée comme un effet de mouvement référé à la dimension excédentaire). Cette remarque se transpose au cas de la perspective où un dessin peut utiliser les principes de la perspective pour produire un effet de spatialisation sans qu’il doive résulter de la représentation d’une véritable scène en trois dimensions. Cette remarque se transpose aussi aux effets de sémie où le vouloir-dire d’un dire ne s’inscrit pas dans les traces asémiques (côté manifestation), quoique ce soit à partir de ces traces qu’il faille interpréter si on veut donner sens à ces traces en tant qu’effet de sémie (côté élévation).
Cependant, les divers exemples que j’ai mobilisés pour donner quelque chair au schéma sont à double tranchant et peuvent induire un effet trompeur quand ils nous donnent à imaginer que nous pourrions avoir d’abord un accès plus ou moins immédiat à des originaux dont les réalisations, les manifestations ou les représentations médiées seraient ensuite autant d’approximations dégradées, corrompues et parfois bricolées : l’exemple de la perspective d’Alberti suppose implicitement que chacun puisse se promener dans l’espace qui vient s’aplatir dans la représentation, et l’analogie de l’aveugle présente une difficulté comparable quand elle est mobilisée par ceux qui voient ou qui ont vu. Il s’agirait plutôt de renverser ces analogies pour faire valoir des « contre-perspectives » dans lesquelles on ne connaît qu’un à-plat de traces – perceptibles ou non – de sorte qu’on doit, à partir de ces traces et depuis cet à-plat, imaginer à la fois les « paysages » et les « procédés d’une perspective » grâce auxquels ces « paysages » pourraient être recueillis comme ces traces dans cet à-plat. L’insistance avec laquelle je souligne l’indication d’une dimension ajoutée en tant que soustraite renvoie à l’incoprésentabilité et à ce dont on n’a pas idée : nul n’a encore jamais « vu » ces « paysages » de la verticalité qui ne sont jamais que les « paysages » de ce dont on n’a pas idée. L’interprétation ne peut être ni une mimesis ni une anamnèse ; elle procède à partir de traces qui sont données (traces au sens étroit) ou qu’elle constitue ou contribue à constituer (traces différentielles) ; elle veut ajouter à l’à-plat de ces traces l’ampleur d’une verticalité qu’elle n’a jamais contemplé et qu’elle veut inventer, imaginer ou déchiffrer depuis la texture chiffonnée des traces. Faute de la décision d’affirmer un défaut qui ne fait pas trou, l’à-plat des traces pourrait à loisir abraser l’expansion d’une ampleur imaginaire par avance aplatie dans le trompe-l’œil d’une verticalité de pacotille[66].
19. Séparer
Donner l’accent majeur aux traces et aux interprétations dans le contexte de la supposition d’une dimension excédentaire conduit à prendre quelque distance par rapport aux constructions qui s’en remettent à la supposition d’une scission entre « empirie » et « métempirie » : toute la difficulté se reporte sur une relative porosité entre les deux termes de la scission, porosité inévitable, sauf à reconnaître que la scission a viré vers un pas-de-rapport. Les noms, les figures et les modalités de cette porosité structurale sont multiples : l’immédiateté, le signe, les anges, la grâce, l’inspiration, l’appel, la révélation, les voix, la représentation, etc. Décider – je souligne – de penser la supposition d’un dehors comme la supposition d’une dimension excédentaire corrélative d’un défaut qui ne fait pas trou, ce n’est pas trancher pour ou contre telle ou telle position de croyance relative à l’« existence » d’un dehors, car c’est seulement affirmer ou réaffirmer qu’il n’y a de liberté à l’égard de la thèse d’un tel dehors que comme le défaut de tout témoignage, de toute garantie, de toute certitude, de toute évidence, de toute preuve, et, plus généralement, de tout argument qui serait de nature à restreindre cette liberté dans un sens ou dans l’autre, aussi bien pour démontrer que pour récuser l’« existence » tout autant que la « non-existence » de ce dehors. En son principe, le schéma de la corrélation ne dit rien d’autre quand il propose de comprendre que la supposition, au niveau de l’à-plat, d’un défaut qui ne fait pas trou – une trace non perceptible – conditionne la possibilité d’une dimension excédentaire relativement à cet à-plat, comprise « verticalement », c’est-à-dire incoprésentable avec cet à-plat.
Mais dire cela, c’est dire que la triple supposition d’une dimension excédentaire, d’un défaut qui ne fait pas trou et de leur corrélation est déjà une construction fictionnelle qui procède d’une interprétation et qui requiert la contrepartie effective d’un faire comme si. Appliquer ce schéma d’interprétation est ainsi une manière de « traduire », par réinterprétation et différence de points de vue, ce qui, dans un point de vue, est compris en tant que croyance ou adhérence, comme des constructions fictionnelles associées à des contreparties effectives dans un autre point de vue. Évidemment, cette traductibilité n’est envisageable que pour autant que les éventuels dehors soient démunis de tout ce qui pourrait intervenir dans l’à-plat des traces pour prouver ou récuser leur « existence » aussi bien que leur « non-existence ». Autrement dit, la liberté à l’égard de ces dehors est une condition de la possibilité de cette « traductibilité ». On comprend que l’accent donné aux traces et à l’interprétation conduise à récuser l’efficience supposée du logos et du signe quant à leurs potentialités de communication avec les dehors, comme Derrida le souligne dans un passage déjà cité :
Ce logos absolu était dans la théologie médiévale une subjectivité créatrice infinie : la face intelligible du signe reste tournée du côté du verbe et de la face de Dieu. [DG 25]
La perspective de la trace déçoit tout espoir d’immédiateté ou de porosité à l’égard des dehors : depuis cette perspective, aucun logos ou signe, ni aucun autre procédé n’a jamais pu jouir d’une telle immédiateté ou porosité, quoi qu’on ait pu croire. C’est une séparation en un sens qui pourrait recroiser celle qui est impliquée dans l’idée de Levinas d’un être séparé :
On peut appeler athéisme cette séparation si complète que l’être séparé se maintient tout seul dans l’existence sans participer à l’Être dont il est séparé – capable éventuellement d’y adhérer par la croyance. La rupture avec la participation est impliquée dans cette capacité. On vit en dehors de Dieu, chez soi, on est moi, égoïsme. L’âme – la dimension du psychique – accomplissement de la séparation est naturellement athée. Par athéisme, nous comprenons ainsi une position antérieure à la négation comme à l’affirmation du divin, la rupture de la participation à partir de laquelle le moi se pose comme le même et comme moi. […] C’est certainement une grande gloire pour le créateur que d’avoir mis sur pied un être capable d’athéisme, un être qui, sans avoir été causa sui, a le regard et la parole indépendants et est chez soi.[67]
L’approche par la trace [telle que proposée ici] n’a rien à dire ni pour ni contre l’« existence » des dehors ; elle ne doit donc rien engager dans les débats selon les disjonctions en à-plat du pour et du contre, du vrai et du faux, de la croyance et de l’illusion, etc., mais au contraire tout tenter pour traduire et réinterpréter, depuis sa perspective, les points de vue qui sont différents du sien.
Interpréter, c’est forcément agir sur la destinée des individus et du monde ; c’est donner à cette destinée un cours nouveau, en prendre l’absolue responsabilité et être prêts à en subir les conséquences et à en payer le prix.
Aussi, interpréter le Livre c’est, d’abord, s’élever contre Dieu afin de soustraire voix et plume à Son pouvoir. Il faut nous défaire de la part divine qui est en nous, dans le but de rendre Dieu enfin à Lui-même et jouir souverainement de notre liberté d’homme.[68]
La séparation me fait libre maintenant, de sorte que c’est aussi et d’abord maintenant qu’elle me fait responsable. Ce n’est donc pas le moment de tourner la face vers les lointains dehors qu’aucune sensibilité ne peut effleurer, car seules les contreparties effectives que nous prenons en charge maintenant peuvent leur procurer l’efficience que nous pouvons envisager maintenant de leur reconnaître et de leur attribuer :
L’éthique se trouve ainsi exceptionnellement proche de cette théologie [du Nom], conformément au mot du prophète (Jérémie, 22, 10) : « Faire droit au pauvre et au malheureux – voilà certes ce qui s’appelle me connaître, dit l’Éternel ». L’éthique n’est pas le préalable ou le corollaire du religieux – il en est l’intimité ultime.[69]
Dans la perspective proposée ici, l’idée d’une séparation participe d’un schéma d’interprétation applicable de manière diverse à des contextes eux-mêmes divers, de sorte que c’est à chaque cas d’application qu’il appartient de préciser le sens des places et des articulations du schéma. Dans le champ de l’institutionnalité, aussi bien juridique qu’étatique, Pierre Legendre souligne à maintes reprises les enjeux de la construction d’un écart instituant une place vide :
Quelque chose, à quoi nous ne prêtons pas suffisamment attention et que toute mise en scène liturgique ou rituelle propose comme supposition première au sujet entrant dans son théâtre, se trouve, si j’ose dire, massivement notifié. Il s’agit de la condition sine qua non, condition sans laquelle le prodige ne serait pas ni ne produirait ses effets : la construction de l’infranchissable distance, de l’écart irréductible, d’un vide que rien ne saurait combler.[70]
En commentant le récit de sa visite à Jorge Luis Borges, Legendre laisse apercevoir de manière très synthétique l’enjeu des fictions et des représentations :
Rendant visite à Borges à Buenos Aires, nous en vînmes à mes écrits et j’eus à lui faire lecture d’un texte intitulé « Haute Mère ». L’aveugle alors me conduisit dans la chambre de sa mère morte, et près du Lit monumental eut lieu un échange insolite. Aujourd’hui, cette scène mythologique me revient toujours neuve à la mémoire, et je l’évoque ici pour montrer ce que veut dire le lieu de l’éblouissement, à la fois scène intérieure de l’homme et théâtre extérieur de la place vide, lieu où chacun vient, pour l’habiter, y adosser son être et commémorer l’absence et la négativité, si je puis dire en le peuplant d’objets-emblèmes qui nous parlent en silence. […] on peut concevoir qu’à l’échelle macroscopique d’une société fonctionne aussi, sur un mode public complexe mais structuralement homologue, la scène fantastique du lieu de l’éblouissement, appelant contes, narrations mythologiques, espaces d’écriture où se déplacent les signes qui sont des masques. Pour rendre possible la vie de la représentation, la vie tout court, l’humanité doit en passer par là, par la domestication du Rien et les célébrations de la place vide peuplée d’objets-emblèmes ou mise en scène comme forme emblématique pure ; de ce fantastique épuré, témoignent les architectures religieuses enserrant le vide.[71]
Le schéma de la corrélation entre une dimension excédentaire et un défaut qui ne fait pas trou permet peut-être de mieux apercevoir comment un espacement (un blanc, un vide, une place vide, etc.) peut tantôt signifier un dehors, quand on emprunte au signe [la supposition de] sa face intelligible, et tantôt figurer le défaut corrélatif d’un dehors, non en le présentant directement comme tel, ce qui est impossible puisque le défaut doit demeurer imperceptible en tant qu’il ne fait pas trou, mais en le figurant indirectement sous les traits d’un espacement, qui lui serait consacré, et qui tienne lieu d’un trou que, justement, il n’y a pas. Dans l’espace des écritures, cela ne change rien – ou presque[72] :
[…] le tout sans nouveauté qu’un espacement de la lecture. Les « blancs », en effet, assument l’importance […][73]
On pourrait transposer à vide et à rien ce que j’ai dit plus haut de manque quand on les laisse glisser aux différentes places du schéma. Mais l’ambigüité qui en résulte appartient peut-être à la mise en scène requise par ces célébrations.[74]
Rien derrière les rideaux. D’où la surprise ingénue du non-juif quand il ouvre, quand on le laisse ouvrir ou quand il viole le tabernacle, quand il entre dans la demeure ou dans le temple et qu’après tant de détours rituels pour accéder au centre secret, il ne découvre rien – que le rien.
Pas de centre, pas de cœur, un espace vide, rien.[75]
20. Qu’arrive-t-il ?
Introduite comme une dimension de l’espacement du « pas tout, tout d’un coup », l’incoprésentabilité participe d’une certaine temporalisation, qu’on pourrait dire oblique, en prolongement de l’articulation entre l’à-plat et la verticalité, pour suggérer le mouvement d’une temporalisation qui s’accomplit dans les trois dimensions d’espacement à la fois, et qui ne se laisse épuiser ni dans une chronologie linéaire (et plate), ni dans un « concept vulgaire » du temps [DG 105, O&G 33]. L’oblique de ce qui arrive déplace, modifie ou porte atteinte à ce dont on n’a pas idée, et donc déplace l’à-plat en provoquant un changement d’interprétation qui force un changement de niveau dans la verticalité. Sous cet aspect, ce qui arrive provoque – et/ou est provoqué par – la réinterprétation d’une sorte d’insouciance – adhérence, croyance, sommeil, etc. –, une « insouciance » entre guillemets et insoupçonnable, comme si c’était ce dont on n’avait pas eu idée, et qui se laisse maintenant apercevoir et peut-être concevoir, mais à un autre niveau, car incoprésentable avec cette « insouciance » – qui n’aura jamais eu lieu au présent (l’aveugle du voir est l’insouciant de l’idée).
Dès qu’il y a ou dans la mesure où il y a un horizon sur le fond duquel on voit venir quelque chose, rien ne vient, rien ne vient qui mérite le nom d’« événement » ; ce qui vient à l’horizontale, c’est-à-dire nous fait face et vient vers nous en s’avançant là où on le voit venir, cela n’arrive pas. […] On doit ne pas le voir venir et donc l’événement n’a pas d’horizon. […] L’événement, s’il y en a et qui soit pur et digne de ce nom, ne vient pas en face de nous, il vient verticalement : il peut venir du dessus, de côté, par derrière, par-dessous, là où les yeux n’ont pas de prise, justement, n’ont pas de prise anticipative ou préhensive ou appréhensive. [PANPV 61]
La verticalité de ce qui vient est à voir comme figurant tout ce qui se trouve soustrait au voir venir devant d’un tel champ de vision (compris ici comme à-plat), non en raison d’une hétérogénéité à la possibilité du voir, mais en contrepartie du voir venir devant qui se voit ainsi, indissociablement, conditionné quant à sa possibilité et limité quant à son extension : « Il faut voir au sens courant du terme pour déployer ces puissances d’aveuglement » [PANPV 77]. L’ampleur de cette verticalité est double, double abîme, double aveugle, double sans fin, etc. – « Le fond de l’eau est parsemé d’étoiles »[76] – et l’à-plat horizontal ne serait peut-être alors que leur médiation :
Qu’un événement digne de ce nom vienne de l’autre, de derrière ou de dessus, ça peut ouvrir les espaces de la théologie (le Très-Haut, la Révélation qui nous vient d’en-haut), mais aussi de l’inconscient (ça vient de derrière de dessous ou bien simplement de l’autre). [PANPV 62]
Mais peut-être les « puissances d’aveuglement » n’ont rien ni personne à aveugler si ce qui est « à voir » n’est d’aucune manière « visible ». Et ce serait alors en « pleine lumière » qu’on doive entrevoir « l’invisible ». Un défaut qui ne fait pas trou n’a besoin d’aucune trace perceptible pour s’adosser, car il faut concevoir qu’il ne sombre pas quand s’évanouissent les traces perceptibles. Même quand il n’y a déjà plus aucune trace perceptible, même quand il pourrait sembler qu’on ait atteint la contemplation d’un fond ultime et originaire, vierge, immaculé, délié de toute créance et de toute dette, inentamé et indemne de toute incise ou effraction, même quand une sorte de kénose ichnée a déjà dispersé toute cendre de trace, même quand il ne reste rien, le défaut y trouve encore son adossement, comme un « désert dans le désert »[77], dans les toiles noires du peintre Tafas, dans les plans noirs de L’Homme atlantique[78] ou dans le silence sur silence de la musique chez Jankélévitch[79], et aussi lorsque je me tais, ou lorsque ce dont je n’ai pas idée s’ajointe à des traces que je ne sais pas apercevoir ou constituer. Il faut qu’il soit dit qu’il y a ce qui fait défaut dans l’à-plat pour qu’il y ait ouverture à cette ampleur, car c’est ce défaut qui s’en porte garant, scellant le témoignage d’une « garantie » coïncidant avec le défaut lui-même, c’est-à-dire avec l’impossibilité d’aucune garantie.
Nul
ne témoigne pour le
témoin.[80]
IV.
21.
Dans le regard de l’enfant, aucun effet fictionnel, aucune contrepartie effective, rien que « le Père Noël ». Qu’est-ce que cela aura signifié, sinon qu’il n’y a pas « le Père Noël » ? Rien que rien ?
La déconstruction n’est pas critique, n’est pas seulement une critique, parce qu’elle doute, elle met en question même la problématisation, la critique, le doute, le scepticisme, le nihilisme, etc. Elle est plus enfantine que chaque philosophe qui a prétendu repartir ab ovo, du début, n’est-ce pas ? Tous les philosophes commencent par le commencement.[81]
Ne pas commencer. Non pas : comment c’est ? Mais : comment c’était ? Alors, comment sais-tu comment c’était si commencer tait ? Comment c’est tu. Ou plutôt, comment c’était tu. Tenter de commencer par l’être, et la béance entre sensible et intelligible s’itère aussitôt en s’étirant dans l’éventail des questions qui la préservent : vérité, immédiateté, signification, représentation, adéquation… Comment traduire et réinterpréter cette béance et tout son cortège ?
Dès lors que cette opposition sensible/intelligible, passivité/activité se trouve non pas disqualifiée (rien n’est disqualifié dans tout cela) mais en tout cas limitée dans sa pertinence, il faudrait parler autrement, penser autrement, écrire autrement. Quand je dis trait ou espacement, je ne désigne pas seulement du visible ou de l’espace, mais une autre expérience de la différence. [PANPV 77]
Un être de fiction : éclaté entre un effet fictionnel – un non-avoir-lieu qui se laisse volontiers envelopper d’idéalité, d’identité, d’intemporalité, de transcendantalité… –, et une contrepartie effective à laquelle chacun est invité à apporter son écot pour lui tisser le vêtement de son exister.
Mais le mouvement du discours – et ce sera peut-être là le principe de son salut – est ici à l’image du mouvement des choses : la simplicité du simple ne se livre à nous que dans le mouvement par lequel elle se divise. […] Le simple se perd lorsqu’il se divise ; mais peut-être se retrouve-t-il dans le mouvement qui le perd.[82]
22.
Le principe d’un schéma d’interprétation permet de ne pas feindre l’hypothèse d’une simplicité inconditionnée (anhypothétique) et originaire qui ne déroberait l’abîme qu’à en [inter-]dire l’accès : tu [n’]interpréteras [pas]. Cependant, quand on imagine « commencer au milieu », quelque part dans l’inachevable, quelque part dans l’abîme des interprétations et des traces, la question devient : comment s’y tenir, comment y rester ? N’a-t-on pas d’abord tendance à espérer l’inconditionné, le principe au sujet duquel il est impossible de se tromper, le ferme et le constant, la certitude, etc. ? Or l’abîme n’accorde rien de tout cela. Où arrêter ? Où trouver, sinon un repère provisoire ou un appui révocable, du moins la respiration d’une attente ? C’est ce que j’ai voulu dessiner comme l’évanouissement d’un « certain “comme si” » dans l’à-plat horizontal, quand il ajointe, comme le fléau d’une balance de précision exactement en équilibre sur son couteau, un non-avoir-lieu (je n’ai pas l’idée de), et l’avoir-lieu de ce qui se manifeste à moi comme si cela n’avait pas lieu (ce qui me demeure imperceptible). Ce qui fait stase, repos, certitude, évidence, suspens, époque, etc., c’est lorsque ni la balance ni son équilibre ne sont soupçonnés, lorsqu’on n’a même pas le soupçon de ce dont on n’a pas idée. Mais cette parfaite « symétrie » est déjà une (dis)symétrie dont la brisure impondérable n’est pas détectée par la précision ultime de la balance : le défaut ne fait pas trou. Pour indiquer, à la manière d’une esquisse, quelques aspects du sillage oblique de cette (dis)symétrie, je voudrais risquer le rapprochement de quelques fragments. Le premier, de Heidegger :
L’Impensé, dans une pensée, n’est pas un manque qui appartienne au pensé. L’Im-pensé n’est chaque fois tel qu’en tant qu’il est Im-pensé. Plus une pensée est originelle, plus riche devient son Impensé. L’Impensé est le don le plus haut que puisse faire une pensée.[83]
Le deuxième, de Derrida :
Que veut dire dans ces conditions « hériter » d’une tradition, dès lors qu’on pense depuis elle, en son nom, certes, mais justement contre elle en son nom, contre cela même qu’elle aura cru devoir sauver pour survivre en se perdant ? Encore la possibilité de l’impossible : l’héritage ne serait possible que là où il devient im-possible. C’est une des définitions possibles de la déconstruction – justement comme héritage. [CSCP 507]
Contrer sans disqualifier tout en limitant, sauver tout en trahissant, ne pas renoncer aux concepts qui sont indispensables pour ébranler aujourd’hui l’héritage dont ils font partie, etc., autant de traits qu’on pourrait remarquer aussi dans d’autres traditions, scientifique et juridique, par exemple, où l’héritage joue un rôle majeur et qui sont, elles aussi, du moins quant à leurs aspects fondamentaux, des traditions d’interprètes. Le troisième, d’Einstein, synthétise l’enjeu des réinterprétations dans le contexte de la tradition scientifique, surtout quand il s’agit de dépasser des théories en procédant à un remaniement de principes fondamentaux :
C’est le plus beau destin d’une théorie physique, que de montrer elle-même le chemin pour la mise en place d’une théorie qui la contient et au sein de laquelle elle survit comme cas limite.[84]
Ainsi entendu, le destin superlatif d’une construction discursive, scientifique ou non[85], est de « se trahir », de laisser paraître son « secret » en laissant s’ouvrir la possibilité d’une réinterprétation au prix d’une survie comme cas limite – comme si c’était [devenu] une fiction (le soleil se lève-t-il moins à l’Est aujourd’hui qu’hier ?). Mais on comprend mieux où gît la difficulté de tels héritages quand on souligne que c’est d’abord la possibilité [de la réinterprétation] qui fait « héritage », de sorte qu’affirmer la possibilité [de la réinterprétation] c’est d’abord affirmer qu’il y a ce dont on n’avait pas idée, le « secret » – qui est aussi bien le fondement. Autrement dit, il n’y a d’héritier à cet égard que pour qui se déclare tel du fait de proposer lui-même une réinterprétation qui témoigne, au titre d’une contrepartie effective, de la possibilité de cette réinterprétation, possibilité qu’il aura constituée et dont il aura ainsi « hérité », comme si c’était possible. C’est une construction fictionnelle dans laquelle la réinterprétation intervient au titre des contreparties effectives à l’égard du non-avoir-lieu de ce dont on n’avait pas idée, enveloppé dans un effet fictionnel approprié (le fondement, le secret, le legs, le supposé savoir, le réel, l’abîme, le sans-fond, etc.). Ce qui fait médiation, et donc aussi articulation pour les interprétations, c’est l’autre côté du fléau, à savoir l’avoir-lieu de ce qui se manifeste comme si cela n’avait pas lieu (l’immobilité réelle de la terre qui devait tout porter s’est évaporée dans le non-avoir-lieu d’un effet fictionnel, tandis que nul n’avait idée d’une contrepartie effective qui puisse à la fois rendre compte de la sensation d’immobilité et « porter » effectivement ce qu’aucune fiction ne saurait jamais porter). Dans le contexte d’une tradition d’interprètes, un tel destin superlatif implique – et même exige – l’inachevabilité de la tradition où chaque construction discursive ne s’inscrit dans sa filiation que pour son rôle (qu’on pourrait presque dire « prophétique ») de « léguer » la possibilité de l’héritage comme ouverture aux réinterprétations, éventuellement multiples : sur aucune branche, il ne devra y avoir de construction dernière. Et, à la manière d’un arbre dont les racines nourricières se déploient en proportion des frondaisons, chaque réinterprétation devra aussi réinterpréter en retour toutes les constructions qui, directement ou indirectement, lui auront procuré quelque appui ; il ne devra donc pas y avoir non plus de construction première, ultime, originaire, et cette place doit rester libre, comme dans un jeu de taquin, car c’est elle qui est garante de l’ouverture : l’inachevabilité du déploiement est corrélative de l’inépuisabilité radicale d’une « origine », qu’il faut sans cesse évider, recreuser, réinterpréter et réinventer – l’abîme[86].
« Qui te soutient ? », demandait reb Asri à reb Debban.
« Le vide », lui avait répondu celui-ci.
Et il ajouta : « Ne soutient-il pas l’univers ? »[87]
Toute tradition d’interprètes n’a pas les mêmes contraintes que celles de la tradition scientifique, et ne vise pas nécessairement des filiations de théories ou de discours. Les héritages sont donc, eux aussi, divers. Cependant, le « mouvement oblique », que j’ai cru pouvoir rapprocher, au moins selon certains aspects, de l’incidence verticale de l’incoprésentabilité, invite à porter une attention particulière à l’application du schéma des fictions à la problématique des « héritages » par réinterprétation liés à une événementialité elle aussi « oblique » qui met en jeu ce dont nous n’avons pas idée. Ce nous, quelque ampleur qu’on lui donne, autour duquel s’enroule ce qui fait unité, confiance, communauté ou consensus, identité peut-être, se règle autant sur le su que sur le tu, effet d’insu qui noue d’autant plus sûrement ce nous qu’aucun d’eux ne l’attend, aussi longtemps du moins qu’il n’arrive pas – comme événement –, l’envers d’un décor soudain entr’aperçu où commence peut-être à se laisser déchiffrer l’envers d’un accord, ce qui vient à l’idée. La solidité qu’on attribue aux fondements, aux certitudes, aux croyances et aux évidences est elle-même une enveloppe fictionnelle pour la résistance farouche de ce dont nous n’avons pas idée ; et comme cette résistance aura dû céder pour que « ça » soit venu à l’idée, l’enveloppe de solidité aura dû se dissiper, comme une légère brume matinale d’été, laissant apercevoir que ce qu’on croyait si ferme et si constant n’était qu’un effet fictionnel corrélatif d’un non-avoir-lieu.
Paradoxalement, l’absence d’horizon conditionne l’avenir même. Le surgissement de l’événement doit trouer tout horizon d’attente. D’où l’appréhension d’un abîme en ces lieux, par exemple un désert dans le désert, là où l’on ne peut ni ne doit voir venir ce qui devrait ou pourrait – peut-être – venir. Ce qui reste à laisser venir.[88] [F&S 16]
23.
La perspective d’Alberti est d’abord une perspective de l’œil, de l’espace, de la géométrie, des architectures et des nombres ; c’est d’abord la cohérence de l’agencement des lignes, même si nombre de perspectives sont très tôt délibérément faussées ou construites autrement. C’est aussi, déjà, ce qu’elle garde en retrait, l’autre côté, celui qui ne donne pas sur le point de vue. Sur la ligne d’horizon, à l’endroit du pli qui répartit l’en-haut et l’en-bas dans l’à-plat, l’infini fait un dernier clin d’œil avant de s’ombrer dans le pli, tandis que l’horizon horizontal du lointain là-bas s’évanouit dans la ligne qui partage en deux l’à-plat de la représentation. Changer de perspective pour une perspective des espacements (et non plus seulement une perspective de l’espace, déjà comprise dans l’à-plat de la représentation), une perspective de la dimension verticale de l’incoprésentabilité, une perspective des strates et des niveaux, des vides et des abîmes, du sans fin. Ce qui y demeure en retrait n’est plus la conséquence d’une limitation s’imposant à la finitude d’une représentation, réduction d’une totalité panoramique infinie combattue par l’à-plat, car c’est une condition du tableau ou du dessin – son « sujet » –, pour autant que tu désires qu’il y ait ce retrait et que ton regard remarque ce retrait « dans » l’œuvre qui ne l’accueille que dans son abritement, comme le gardien qui se dresse devant la loi et interdit à l’homme venu de la campagne de franchir la porte de l’entrée qui lui était pourtant réservée[89].
24.
Avancer d’un pas, encore. Pas de voile. L’approche par la visibilité, par un « sur » ou un « devant » est encore dessinée dans les ombres de l’analogie de l’occultation ou du voilement. Mais ce n’était pas un voile, rien n’était caché ni dissimulé. Il n’y aura rien eu à dévoiler, il n’y aura donc rien eu à revoiler (la terre devrait-elle se dévoiler à chaque fois que quelqu’un prendrait conscience qu’elle n’est pas réellement immobile ?). « Penser à ne pas voir » : point de fuite et de (dé)construction, croisement et convergence de nombreuses lignes, cristal à multiples facettes. Qu’il scintille. L’essentiel est invisible pour les yeux[90]. Le jeu de la différence n’est pas le même suivant qu’il se situe dans un à-plat ou dans une verticalité de termes incoprésentables. Ce n’est pas seulement la différence du jour et de la nuit [PANPV 77]. C’est imprésenté, ni représenté, ni non représenté, mais aussi ni présent comme présenté, ni absent comme caché ou voilé. Imprésenté et invoilé. Feuilleter l’abîme, inventer une marche puis descendre cette marche, et descendre, des cendres encore ; à chaque pas, tu trouveras seulement l’appui d’une attente : ce qui porte est aussi ce qui cèdera. Penser à perte de vue. Veille à ne pas savoir, veille à ne savoir que sous réserve de ce qui s’y cèle. L’infini est peut-être une idée plus grande que ce que je peux concevoir, et la transcendance des perfections est au loin, là-bas ou là-haut, d’un tout autre ordre. Mais ce qui est incoprésentable avec ce que je peux savoir, c’est là, c’est tout proche, au plus intime, et cela ne laisse pas de trace, et je n’en ai même pas l’idée. Accord parfait, silencieux, indécelable, insoupçonnable. Question effacée d’une nescience essentielle à la conscience : comment pourrais-je jamais me délier de ce dont je n’ai pas idée ? Comment quelqu’un peut-il se cacher devant ce qui ne sombre jamais ?[91] Aucune parenthèse pour tracer au loin l’horizon de cette apnée blanche, aucune parenthèse non plus pour en suspendre l’insomnie superlative. Je se divise là, au lieu des traces. Et pourtant, à ne pas laisser de trace, c’est dans tout ce que tu traces que se trouve peu à peu ciselé cette fissure blanche se faufilant entre les traits, les lettres, les mots et les phrases qui en façonnent la forme. Aussi tout ce que tu dis ou écris, fais ou produis se laisse déchiffrer en noir sur fond blanc. Mais c’est aussi là que se sécrète en même temps cette trace qui reste en blanc, une trace en blanc sur fond blanc, une trace sans tracement, imprésentée autant qu’invoilée, un tracement qui n’a jamais eu lieu, auquel seul un autre regard, un regard d’héritier, l’égard d’une rencontre, pourra peut-être donner lieu comme trace[92]. Comme si c’était une trace. (Comment pourrais-tu vouloir tracer ou effacer ce dont tu n’as même pas idée ?)
Et il dit : « De quoi le livre peut-il se souvenir sinon des paroles essentielles qu’il n’a point su tirer de son silence : indicibles paroles du livre qui est dans le livre ? »[93]
25.
Cette aquarelle de la Sainte-Victoire vue des Lauves[94]. Là, l’été y a tout effacé sauf ce que Cézanne en a sauvé, quelques ombres mauves et mouillées, quelques traits obliques, à peine un ciel, le bruissement assourdi d’une torpeur végétale clairsemée, un horizon oublié sous l’immense masse rocheuse de la montagne, ses formes alourdies de sommeil dans le terrible ruissellement de la lumière méridienne, et son ventre de pierre blanche, éblouissant, sans rien de peint ou presque, ce vide central laissant venir à nous le support intact, blocs de rocs blancs sur la blancheur immaculée du vélin ; là, à l’endroit du sur, rien n’est peint, et c’est pourtant ce vide, ce rien-de-peint, que nous devons voir comme opaque si nous désirons la voir, la Sainte-Victoire, et comment pourrions-nous la voir sans voir ce que nous ne pouvons pas voir, l’autre côté de la montagne, celui qui n’est pas tourné vers nous et que cette opacité massive dérobe sous ce rien-de-peint qui ne nous dérobe rien. Pas de voile. Rien. Ostension étincelante, silencieuse. Blanche.
Où la face soustraite des choses se trouve restituée au travers même du volume qui nous la dérobe, ‘nous’ disparaissons…[95]
Ce qui se passe ensuite : le ciel, le même ciel, soudain ouvert, noir absolument et vide absolument, révélant (comme par la vitre brisée) une telle absence que s’y est depuis toujours et à jamais perdu, au point que s’y affirme et s’y dissipe le savoir vertigineux que rien est ce qu’il y a, et d’abord rien au-delà. L’inattendu de cette scène (son trait interminable), c’est le sentiment de bonheur qui aussitôt submerge l’enfant, la joie ravageante dont il ne pourra témoigner que par les larmes, un ruissellement sans fin de larmes. On croit à un chagrin d’enfant, on cherche à le consoler. Il ne dit plus rien. Il vivra désormais dans le secret. Il ne pleurera plus.[96]
—
[1]. Edmond Jabès, L’ineffaçable L’inaperçu, Paris, Gallimard, 1980, p. 18.
[2]. « Your paintings are like my films – they’re about nothing… with precision », cité dans Seymour Chatman, Antonioni : Or the Surface of the World, Berkeley, University of California Press, 1985, p. 54.
[3]. Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Quelque part dans l’inachevé, Paris, Gallimard, 1978, p. 203.
[4]. « Ein Hauch um Nichts ». Rainer Maria Rilke, Sonnets à Orphée, I, 3.
[5]. Ce « dire enfin ce que c’était » n’est peut-être pas sans évoquer un autre « ce que c’était », certes dans le contexte d’une tout autre perspective, inversée en quelque manière, celle de la détermination de l’être sensible chez Aristote comme τὸ τί ἦν εἶναι (to ti èn einai), ce que, dans Le problème de l’être chez Aristote (1962, Paris, PUF, 1994, en particulier p. 456-484), Pierre Aubenque propose de rendre comme « ce que la chose est, c’est-à-dire était » (473) où l’imparfait « ne corrige, en la figeant, la contingence du présent, que parce qu’il est l’image et le substitut d’un impossible parfait » (472). Dans le cours de cette discussion, Aubenque rappelle « cette idée, si profondément grecque, selon laquelle tout coup d’œil essentiel est rétrospectif, qui nous parait justifier le ἦν [l’imparfait était] du τί ἦν εἶναι » (469) ; il rappelle aussi la « fonction révélante de la mort » (470), et ainsi « retrouvons-nous, mais sous une forme cette fois démythifiée, le lien que Platon avait reconnu, à la suite des Pythagoriciens et des Orphiques, entre la philosophie et la mort. La mort ne libère plus l’essence des choses, mais, en la supprimant, elle la révèle » (472). Perspective inversée, du moins réorientée, disais-je à l’instant : que signifient encore ces imparfaits dans l’éventualité ou dans les contextes dans lesquels l’antécédence de l’être sur le discours n’est pas accordée ?
[6]. Jacques Derrida, L’Université sans condition, Paris, Galilée, 2001 (dorénavant USC), p. 28.
[7]. Jacques Derrida, « Comme si c’était possible, “within such limits”… », Revue Internationale de Philosophie, 1998, 205/3, p. 497-529 (dorénavant CSCP).
[8]. Jacques Derrida, « Scènes des différences. Où la philosophie, la poétique, indissociables, font événement d’écriture » (entretien avec Mireille Calle-Gruber), Littératures, 2006/2, n° 142, p. 27 (en ligne).
[9]. On entrevoit ici incidemment, dans ce cas particulier du concept de signe, comment du non-avoir-lieu peut intervenir dans la constitution de l’« objet » d’une théorie.
[10]. Jacques Derrida, « Signature, événement, contexte » (1971), in Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972 (dorénavant SEC).
[11]. Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967 (dorénavant DG), p. 25.
[12]. Pour une étude des effets d’insu liés à je n’ai pas l’idée de, voir mon texte « Dialectique des effets d’insu », Eikasia, n° 78, 2017 (en ligne).
[13]. Je vais revenir sur ce raccourci de structure. Au plan fondamental des théories, voir « Dialectique des effets d’insu », op. cit.
[14]. William Wyler, Ben-Hur, USA, Metro-Goldwyn-Mayer, 1959, avec Charlton Heston (Judah Ben-Hur), Stephen Boyd (Messala), Jack Hawkins (Quintus Arius), Haya Harareet (Esther). La plus grande partie du film, dont la course de chars, a été tournée à Cinecittà en 1958.
[15]. Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas, au sens où je l’introduis ici, de fiction manifeste là où règne la supposition de l’immédiateté. La réserve concernant la manifesteté est requise par l’éventualité que [la supposition de] l’immédiateté soit elle-même [(ré)interprétée comme] une construction fictionnelle.
[16]. Voir Gérard Genette, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris, Seuil, 2004. Voir aussi, de Sylvie Thorel, La fiction du sens, Mont-de-Marsan, Éditions InterUniversitaires, 1994, et Duras ou les fantômes d’Anne-Marie Stretter, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022.
[17]. Je sais bien… mais quand même : voir Octave Mannoni, Clefs pour l’Imaginaire ou l’Autre Scène, Partis, Seuil, 1969, p. 9-33.
[18]. Barbara Cassin et Michel Narcy, La décision du sens, Paris, Vrin, 1989, p. 31.
[19]. Jacques Derrida, « La double séance » (dorénavant LDS), in La dissémination, Paris, Seuil, 1972, p. 239.
[20]. Voir, en particulier, Jacques Derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967, concernant, dans le contexte de la phénoménologie husserlienne, cette question d’un signifié antérieur à toute expulsion dans l’extériorité mondaine de l’ici-bas sensible.
[21]. Je ne re-déplie pas ici la problématique de l’effectivité, liée à celle de la mise en œuvre des régressions sans fin, que j’ai étudiée dans « Un acheminement vers la question de l’écriture », Intentio, 2019, n° 1, en particulier p. 263-272 (en ligne).
[22]. L’idée d’enveloppe, en particulier pour l’enveloppement d’un non-avoir-lieu, est empruntée aux travaux de François Baudry sur l’objet en psychanalyse. Voir en particulier, François Baudry, « L’enveloppe de l’objet (et la compacité du vide) » (1993), in Éclats de l’objet, Paris, Campagne-Première, 2000, p. 163-172.
[23]. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 6e éd., Paris, PUF, 2004, p. 402.
[24]. Bien au-delà des fictions de droit, au sens d’une technique juridique, voir l’ensemble des recherches de Pierre Legendre sur l’enjeu des fictions dans l’institutionnalité (juridique aussi bien qu’étatique, par exemple) et au plan anthropologique. Voir, par exemple, Le désir politique de Dieu (Étude sur les montages de l’État et du Droit, Leçons VII), Paris, Fayard, 1988. L’une des sources de l’approche proposée ici des fictions, en tant que constructions à effets fictionnels associées à des contreparties effectives, se trouve dans les « montages » de Legendre. Une autre source provient des « dimensions » [dites] du réel, de l’imaginaire et du symbolique, introduites par Jacques Lacan et articulées via un nœud borroméen (par exemple : Encore, Séminaire XX, Paris, Seuil, 1975, p. 107 sq.), mais avec au moins deux différences majeures : d’une part, je prends appui sur des traces (et non sur une figuration géométrique, topologique ou empruntant ses traits à une mathématicité) et, d’autre part, je mets l’accent sur l’effectivité des interprétations et des contreparties effectives (pour une étude sur l’articulation entre le nœud borroméen, l’objet a et le vide, voir François Baudry, « Le nœud borroméen et l’objet a », in Éclats de l’objet, op. cit.).
[25]. Si la marionnette à gaine Guignol a été crée par Laurent Mourguet au début du XIXe siècle à Lyon, l’Antiquité connaissait déjà des marionnettes, ainsi que divers usages métaphoriques qui peuvent en être faits, chez Platon, (allégorie de la caverne) et chez Philon d’Alexandrie, par exemple.
[26]. C’est le psychanalyste Serge Hajlblum qui a initialement attiré mon attention sur je n’ai pas l’idée de…
[27]. Je ne peux certes pas le dire, quoique rien ne m’empêche de le dire, et même aussi de l’écrire, comme on le voit. Je suis, j’existe, cela est certain. Mais combien de temps ? Peut-être aussi longtemps que je trouverai une Toinette qui voudra bien me donner la réplique : « Ah ! ah ! le défunt n’est pas mort ! » (Molière, Le Malade imaginaire, 1673, acte III, scène 13).
[28]. Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir » (2002), in Penser à ne pas voir, Paris, La Différence, 2013 (dorénavant PANPV), p. 76.
[29]. C’est ce trait de l’incoprésentabilité qui est visé, sinon à l’œuvre, dès la confection des premiers mensonges, où le mensonge, pour réussir, doit être tout entier replié dans le cône de l’ombre portée de ce dont l’autre n’a pas idée.
[30]. Cette formule est proche d’une « structure d’après-coup » (Nachtraglichkeit) au sens freudien, accentuée ici comme réinterprétation d’un non-avoir-lieu. En tant qu’il requiert des traces et l’interprétation (voire la constitution) de ces traces, l’après-coup est d’abord, à mon sens, à envisager comme un fait d’interprétation extrêmement général, et moins à regarder comme une modalité de temporalisation – une « chronie », dia-chronie ou syn-chronie – qui serait plutôt un effet de l’interprétation. Ce n’est pas seulement le cela, mais d’abord le c’était, qui vient après comme si (voir supra la note n° 5).
[31]. Jacques Derrida, « La différance » (1968), in Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972 (dorénavant DIF), p. 22.
[32]. ῾Ομοίους ἡμῖν (homoious hèmin), semblables à nous, comme les prisonniers, dans l’allégorie de la caverne, qui ne voient ni les manipulateurs produisant les ombres merveilleuses, ni le soleil. Platon, La République, Livre VII, 515a.
[33]. Henri Bergson, La pensée et le mouvant (1938), Paris, PUF, coll. Quadrige, 1990, p. 102.
[34]. Edmond Jabès, • El, ou le dernier livre, Paris, Gallimard, 1973, p. 9.
[35]. Alexandre Koyré, « Les étapes de la cosmologie scientifique » (1948), in Études d’histoire de la pensée scientifique, Paris, Gallimard, 1973, p. 90.
[36]. Alexandre Koyré, « Galilée et la révolution scientifique du XVIIe siècle » (1955), in Études d’histoire de la pensée scientifique, op. cit., p. 203.
[37]. Concernant l’histoire des différentes étapes de ces réinterprétations, voir, par exemple, Françoise Balibar, Galilée, Newton lus par Einstein, Paris, PUF, 1984 ; Jean-Jacques Szczeciniarz, Copernic et la révolution copernicienne, Paris, Flammarion, 1998.
[38]. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, La Haye, Martinus Nijhoff, 1971, coll. Le livre de poche, p. 144.
[39]. Dans le contexte scientifique, j’ai choisi cet exemple de l’immobilité de la terre parce qu’il est très largement partagé, et que chacun peut éprouver la sensation d’immobilité. Mais il s’agit d’un schéma récurrent, en particulier dès qu’il faut envisager de remanier le cadre fondamental en vigueur.
[40]. Jacques Derrida, « Ousia et grammè, note sur une note de Sein und Zeit » (1968), in Marges de la philosophie, op. cit. (dorénavant O&G), p. 76.
[41]. Jacques Derrida, Feu la cendre, Paris, Des femmes-Antoinette Fouque, 1987 (dorénavant FLC), p. 27.
[42]. Cette formule appellerait une discussion précise concernant les articulations entre information, interaction et trace, surtout si on accorde que la trace (tout autant que l’écriture) n’est rien d’étant.
[43]. Daniel Arasse, Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004, p. 147.
[44]. Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Quelque part dans l’inachevé, Paris, Gallimard, 1978, p. 231.
[45]. Je ne développe pas plus avant la problématique des articulations entre discret et continu qui affleure ici, et qui ne cesse de hanter les enchevêtrements entre trace, trait, écriture, entre-deux, information, etc., et sans doute le développement des technologies de l’information contribue-t-il à accentuer cette problématique, non sans la renouveler. Dans « De l’information à l’écriture », Revue d’intelligibilité du numérique, n° 2, 2021 (en ligne), j’analyse certains aspects de la fiction selon laquelle tout (ou presque) se passe comme si les dispositifs de traitement de l’information discrète étaient [réductibles à] des écritures et [à] des opérations appliquées à ces écritures.
[46]. Évanouissant, inassignable, infinitésimal, etc., autant de thèmes et de vocables qui renvoient à Leibniz, dont on sait qu’il a abordé les infinitésimaux – les quantités évanouissantes – par un procédé discret, le calcul différentiel, initialement nommé le calcul des incréments. L’intervention des fictions est explicitement conçue : « En parlant philosophiquement, je n’admets pas plus les grandeurs infiniment petites que les grandeurs infiniment grandes, c’est-à-dire pas plus les infinitésimaux que les infinituples. Je les considère en effet toutes deux comme des façons commodes de parler, des fictions de l’esprit, bonnes pour le calcul, qui sont de même nature que les racines imaginaires en Algèbre. Cependant, j’ai démontré que ces expressions sont d’un grand secours pour faciliter la réflexion et même l’invention » (Gottfried Wilhelm Leibniz, À Des Bosses (11 mars 1706), GII, p. 305, reproduit dans Leibniz, les deux labyrinthes (textes choisis par Alain Chauve), Paris, PUF, 1973, p. 47). Je souligne pour ma part que ces « manières commodes de parler », ces « fictions de l’esprit » sont « bonnes pour le calcul », c’est-à-dire que c’est le calcul (au sens large d’opérations formelles réglées avec des lettres) qui joue le rôle des contreparties effectives permettant de faire comme si. Dans le cas des racines imaginaires, les racines qu’il n’y a pas au niveau des nombres réels (non-avoir-lieu) peuvent être saisies comme des fictions grâce au fait que la formalité algébrique fournit la contrepartie effective qui confère efficience à cette fiction. L’incorporation apaisée de ces « objets » comme nombres complexes au sein de l’à-plat des nombres, a motivé l’introduction en 1777 par Euler du symbole i (dont le carré est, par définition, −1).
[47]. Vladimir Jankélévitch, La Musique et l’Ineffable, Paris, Seuil, 1983, p. 175.
[48]. Daniel Arasse, Histoires de peintures, Paris, Gallimard, 2004, p. 47.
[49]. Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc (1918). Le titre original est Супрематическая композиция – Белое на белом [Белый квадрат] (Souprematitcheskaïa kompozitsia – Beloïé na belom [Bely kvadrat]), mot à mot : Composition suprématiste – blanc sur blanc [Carré blanc]. Cette toile est exposée au MoMA à New York sous le titre Suprematist Composition : White on White.
[50]. « Cartouches donne à remarquer que tout titre est lui-même un cartouche, pris dans la structure (parergonale) d’un cartouche », Jacques Derrida, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978, p. 272.
[51]. On pourra se reporter aux nombreux ouvrages spécialisés, par exemple : Denys Riout, La peinture monochrome (1996), Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006.
[52]. Samuel Beckett, Nouvelles et Textes pour rien, Paris, Minuit, 1958, p. 186.
[53]. La figure s’inverse quand on situe métaphoriquement les provenances supposées « en-dessous » de l’à-plat : le mouvement de l’interprétation « descend » ce que la manifestation « remonte ».
[54]. Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges, « Notre grand peintre : Tafas », Chroniques de Bustos Domecq (1967), tr. F.-M. Rosset, Paris, Robert Laffont, 2011, p. 107-110.
[55]. Alphonse Allais, Album Primo-Avrilesque, Paris, Ollendorf, 1897 (en ligne sur Gallica). Voir aussi Raphaël Rosenberg, « De la blague monochrome à la caricature de l’art abstrait », in Ségolène Le Men (dir.), L’art de la caricature, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2011 (en ligne). Dans un tout autre domaine, on peut aussi évoquer les procédés de camouflage et de leurre mimétique, par exemple, les étonnantes possibilités de la seiche pour se fondre dans la couleur et la texture du fond environnant.
[56]. Je remercie Lucien Massaert de m’avoir incité à préciser et à développer cette approche différentielle de la trace dont il a remarqué une ébauche dans un de mes textes (« L’œil de la structure », in Jean-Pierre Marcos (dir.), La lettre et le lieu. Présence du modèle et action de la structure en psychanalyse (Freud et Lacan), Paris, Kimé, 2006) et dont il a su apercevoir le lien avec les problématiques du trait et du dessin (en particulier dans « L’impropriété du dessin », Appareil, n° 17, 2016 (en ligne)).
[57]. La même remarque s’applique à l’exemple de l’immobilité de la terre : ce qui vaut comme « croyance » ou « évidence » (entre guillemets) dans le point de vue de l’insouciant est seulement un effet fictionnel dans le point de vue du physicien.
[58]. Stéphane Mallarmé, Brise marine. Œuvres complètes (éd. B. Marchal), t. I, Paris, Gallimard, 1998, p. 15.
[59]. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 93.
[60]. Comme en témoigne, en 1415, l’expérience de Filippo Brunelleschi devant le baptistère de la cathédrale de Florence.
[61]. Plus précisément, le cinématographe n’est possible que parce que c’est d’abord le mouvement qui n’est pas visuellement perceptible « comme tel », au moins aux yeux des humains, ce qui s’accorde avec le fait qu’il ne s’inscrive pas « comme tel » (sur une pellicule ou ailleurs). Voir, par exemple, Lionel Naccache, Le Cinéma intérieur, Paris, Odile Jacob, 2020. Que ce soit ou non au cinéma, c’est à chacun de prendre en charge la synthèse effective des effets de mouvement dont il s’affecte, de sorte qu’on « voit » entre guillemets le mouvement, tout comme l’enfant « voit » entre guillemets le Père Noël.
[62]. Cette analogie n’est pas sans évoquer un autre trait caractéristique de la fiction du signe, à savoir l’indissociabilité de ses deux faces, quand on comprend ici que le côté du signifiant s’entend comme une condition de possibilité de l’impossibilité de présenter médiatement le côté du signifié comme tel : « Le signifié y fonctionne toujours déjà comme un signifiant ». [DG 16]
[63]. Dans le domaine des arts graphiques, voir l’étude de Lucien Massaert sur l’articulation entre vide, blanc et rien dans « D’une surface vacante, d’un discours déjà-là », La Part de l’Œil, n° 17-18, 2002, p. 143-157. Il me semble en outre, à lire ce texte, qu’il serait possible, au moins à certains égards, de rapprocher l’articulation entre support et surface de l’articulation avancée ici entre milieu médiateur (support empirique) et médiation (lieu du défaut) : « Si cette surface est à construire, cela indique forcément qu’elle manque, qu’à un moment, elle est venue à manquer à la peinture – et pas seulement à la peinture, à l’épistémè en général – en tant que surface d’inscription, en tant qu’origine qui puisse supporter toute l’opération d’élaboration de l’espace imaginaire. » (p. 144).
[64]. Cet aspect des contreparties effectives n’est pas sans évoquer l’insistance de Heidegger sur la verbalité de être, aussi bien que l’essance, dans l’orthographe suggérée par Levinas, pour souligner l’esse et dire l’acte d’être (Autrement qu’être, Dordrecht, Kluwer Academic, 1978, coll. Biblio essais, p. 9). Relativement au schéma d’interprétation proposé ici, l’usage courant du substantif existence et du verbe exister s’entend entre guillemets, comme lorsqu’on dit que le Père Noël « existe ».
[65]. C’est aussi grâce au fait que le mouvement ne s’inscrit pas comme tel qu’il est possible de produire des dessins animés ou des films réalisés au moyen de d’images de synthèses, tout autant que des trucages ou des effets spéciaux.
[66]. Dans La 901e conclusion (Étude sur le théâtre de la Raison, Leçons I), Paris, Fayard, 1998, p. 150 sq., Pierre Legendre interprète certains aspects des délires du Président Schreber comme l’effet d’une fausse altérité.
[67]. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 52.
[68]. Edmond Jabès, Elya, Paris, Gallimard, 1969, p. 44.
[69]. Emmanuel Levinas, « Le Nom de Dieu, d’après quelques textes talmudiques », in L’intrigue de l’infini, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1994, p. 220-221.
[70]. Pierre Legendre, Dieu au Miroir. Étude sur l’institution des images (Leçons III), Paris, Fayard, 1994, p. 59.
[71]. Pierre Legendre, De la Société comme Texte. Linéaments d’une Anthropologie dogmatique, Paris, Fayard, 2001, p. 130.
[72]. Ce ou presque ouvre une difficile (et abyssale) question quant aux blancs. En effet, comme je l’ai montré, ce défaut – celui qui ne fait pas trou – n’a aucunement besoin du secours de traces perceptibles « en noir » pour se procurer un adossement, de sorte qu’à l’égard d’un tel défaut, les blancs, les vides, etc., ne font que de la figuration et ne peuvent d’aucune manière être regardés comme une sorte de lieu d’hébergement spécialisé consacré à l’accueil d’un tel défaut (« […] il n’y aura jamais de Blanc majuscule ou de théologie du Texte » [LDS 290]), lequel n’est jamais qu’un effet fictionnel résultant d’une interprétation. À cet égard, de tels « blancs » ne devraient-ils pas être considérés, eux aussi, comme [des traces perceptibles] « en noir » ?
[73]. Stéphane Mallarmé, Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard, Préface à l’édition Cosmopolitis, Œuvres complètes, op. cit., p. 191.
[74]. On pourra évoquer ici les espacements dans divers textes de Derrida, les passages de 52 signes incinérés dans La Carte postale (Paris, Flammarion, 1980), les rectangles blancs dans « Parergon » (La vérité en peinture, op. cit., p. 19-168), par exemple, mais aussi, parmi les auteurs cités ici, les espacements dans les textes d’Edmond Jabès et d’André du Bouchet. Concernant l’approche du dessin et de la peinture sous l’angle de la réserve, de l’épargne et du blanc, ainsi que les lacunes dans les dernières œuvres de Cézanne, voir le texte déjà cité de Lucien Massaert « L’impropriété du dessin », ainsi que le texte de Jean Clay, auquel il y est fait référence, « La peinture en charpie » (Macula 3-4, 1978, p. 167-185) : « C’est une réécriture de l’histoire de l’art du XXe siècle que Jean Clay propose en démontrant que la modernité s’énonce “de Cézanne à Ryman, art de transposer dans le champ de la peinture les propriétés du dessin” ».
[75]. Jacques Derrida, Glas, Paris, Galilée, 1974, p. 59.
[76]. Edmond Jabès, Le petit livre de la subversion hors du soupçon, Paris, Gallimard, 1982, p. 41.
[77]. Jacques Derrida, Foi et savoir, Paris, Seuil, 2001 (dorénavant F&S), p. 16.
[78]. Marguerite Duras, L’Homme atlantique, 1981. Film, 45 mn.
[79]. « […] le silence est le désert où fleurit la musique, et la musique, cette fleur du désert, est elle-même une sorte de mystérieux silence », La Musique et l’Ineffable, op. cit., p. 184. Évoquant Pelléas et Mélisande quelques pages avant, Jankélévitch note : « Dieu arrive sur la pointe des pieds, furtivement, pianissimo, ainsi que la mort au cinquième acte » (p. 184).
[80]. « Niemand / zeugt für den / Zeugen », Paul Celan, « Aschenglorie », in Strette, tr. J. Daive, Paris, Mercure de France, 1990.
[81]. Jacques Derrida, « Bâtons rompus », dialogue avec Hélène Cixous, in T. Dutoit et P. Romanski (dir.), Derrida d’ici, Derrida de là, Paris, Galilée, 2009. Sur le caractère childlike de la déconstruction, voir René Major, « L’enfance (sans origine) de la déconstruction », Les Temps Modernes, n° 669-670, 2012/3, p. 202 à 216 (en ligne).
[82]. Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, op. cit., p. 484.
[83]. Martin Heidegger, Was heiβt Denken ? (1954), tr. fr. Qu’appelle-t-on penser ? par G. Granel, Paris, PUF, 1999, p. 118 (traduction modifiée).
[84]. Albert Einstein, Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (1917), Brunswick, Friedrich Vieweg & Sohn, 1920, p. 52. Le texte allemand original est : « Es ist das schönste Los einer physikalischen Theorie, wenn sie selbst zur Aufstellung einer umfassenden Theorie den Weg weist, in welcher sie als Grenzfall weiterlebt ». La traduction de ce passage est celle qui figure dans Gerald Holton, L’imagination scientifique, tr. J.-F. Roberts, Paris, Gallimard, 1981, p. 221.
[85]. Il n’y a pas de raison de limiter la portée de cette remarque fondamentale aux seules théories physiques, ni même scientifiques.
[86]. Je propose une analyse de l’entrelacement qui articule « le plus beau destin », les effets d’insu et l’héritage (comme déconstruction) dans « Relativité de niveau dans les théories », Intentio n° 5, 2024 (en ligne).
[87]. Edmond Jabès, L’ineffaçable L’inaperçu, op. cit., p. 99.
[88]. Les italiques appartiennent au texte original.
[89]. Franz Kafka, Le Procès (1915).
[90]. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Paris, Gallimard, 1946, p. 72.
[91]. Τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι; (to mè dunon pote, pôs an tis lathoi ?) Héraclite, fragment DK 16. Traduction et analyse du fragment : Martin Heidegger, « Alèthéia », in Essais et conférences (1958), tr. A. Préau, coll. Tel, Paris, Gallimard, 1988, p. 311-341.
[92]. « […] cet effacement de la trace doit s’être tracé dans le texte métaphysique […] la présence alors est la trace de la trace, la trace de l’effacement de la trace. » [O&G 76].
[93]. Edmond Jabès, L’ineffaçable L’inaperçu, op. cit., p. 35.
[94]. Paul Cézanne, La montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, 1901-1906 (Rewald W583). Crayon et aquarelle sur vélin, 29.8 x 46.2 cm. Collection Jean Planque, musée Granet, Aix-en-Provence. Photo L. Chessex.
[95]. André du Bouchet, Qui n’est pas tourné vers nous (Sur le foyer des dessins d’Alberto Giacometti), Paris, Mercure de France, 1972, p. 46.
[96]. Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 117 (tout le passage est en italiques dans le texte original).
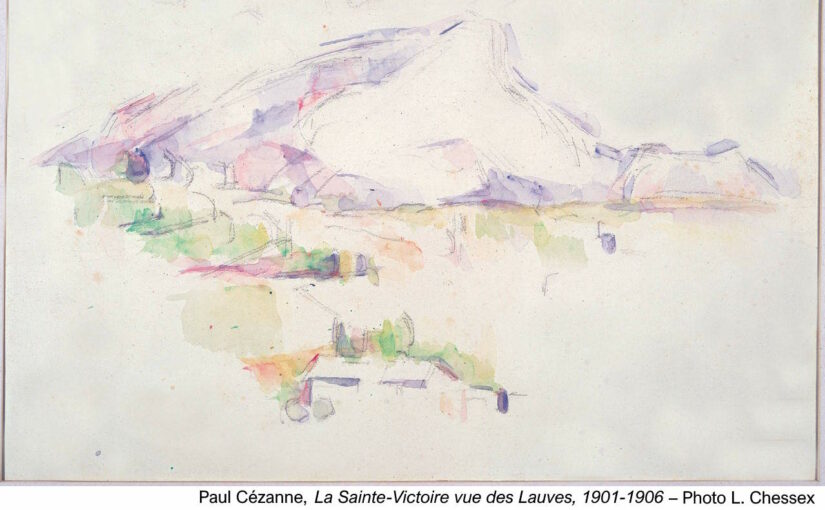
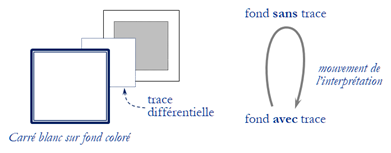
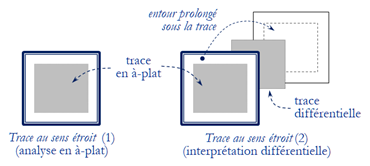



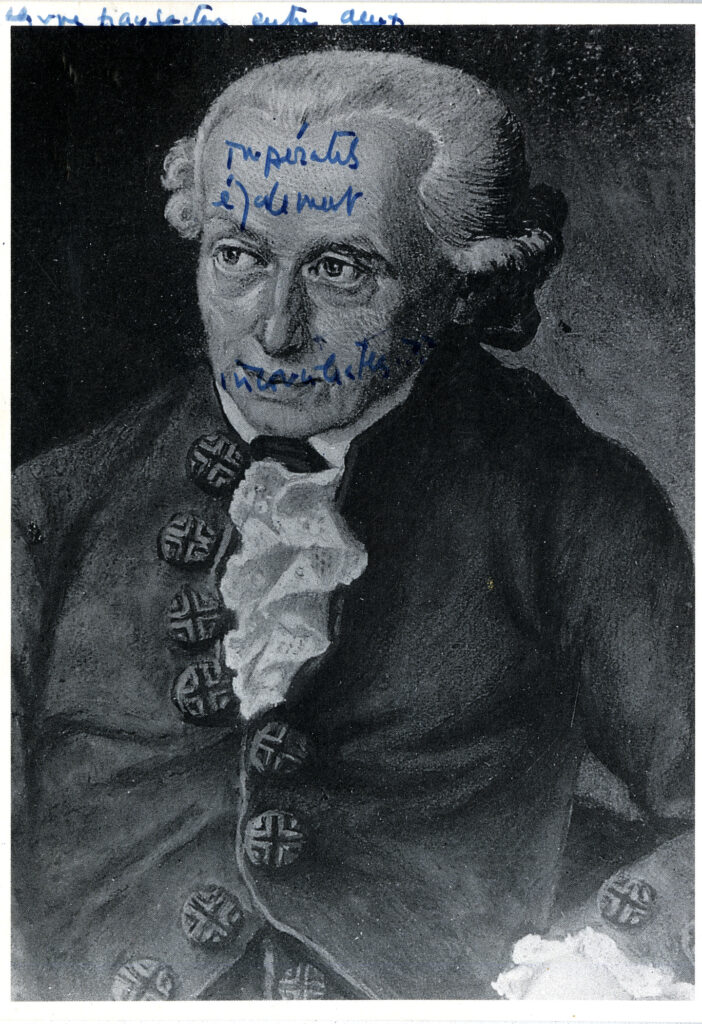

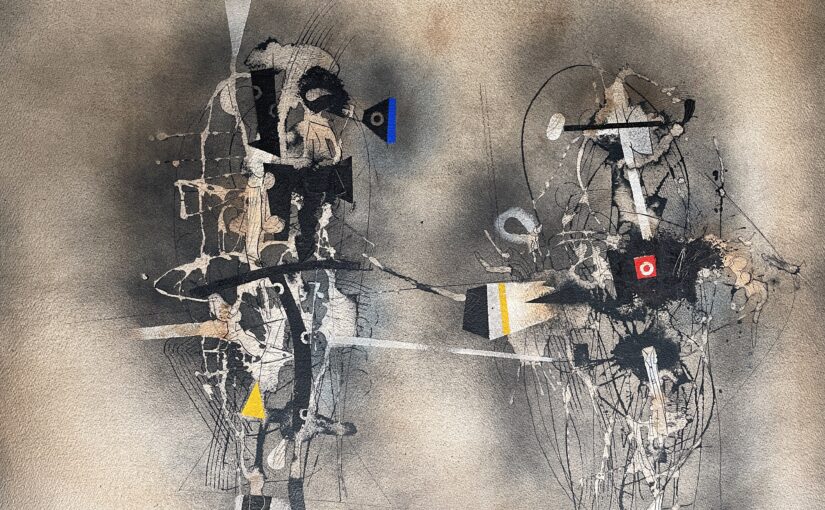

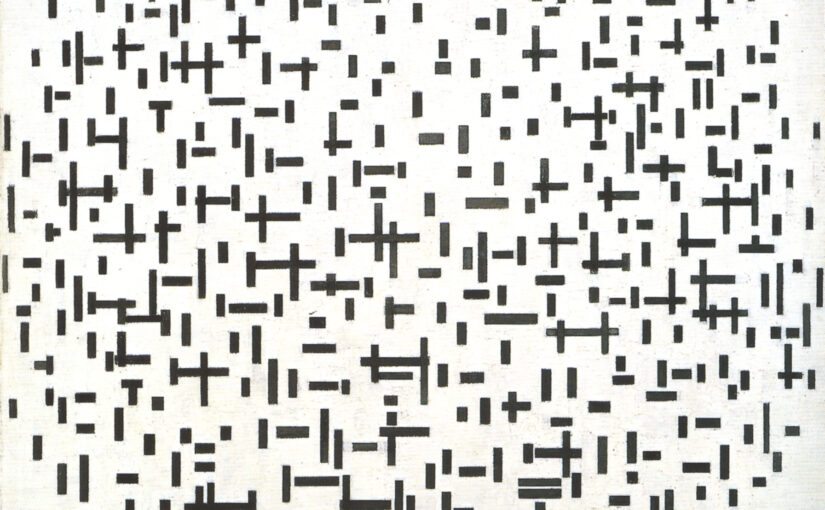
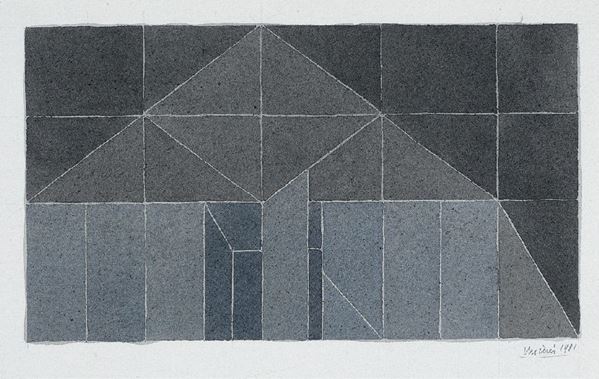
![[Un rinfresco, c’est tout] : Jacques DERRIDA – extrait du séminaire inédit Manger l’autre, présenté par Giustino DE MICHELE](https://revue-iter.org/wp-content/uploads/2024/10/9-cimiterio-825x510.jpg)