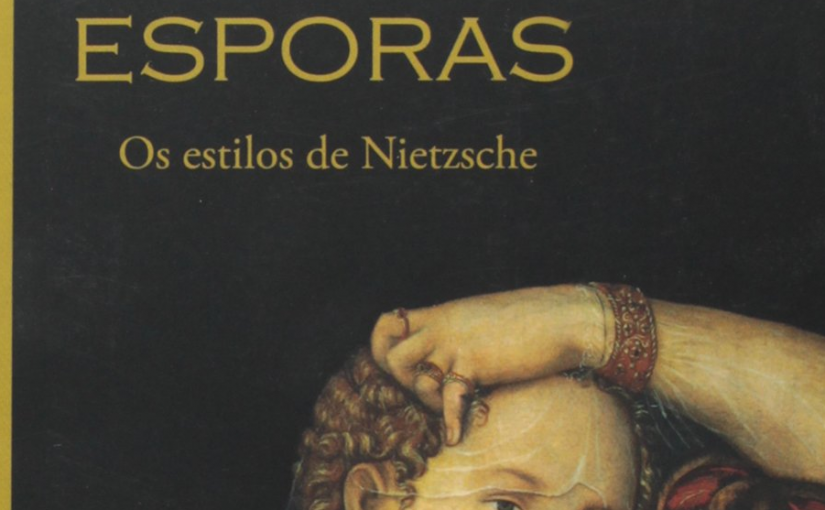Carla RODRIGUES, « Ce qui demeure irréductible dans le travail du deuil et dans la tâche du traducteur », Traduire Derrida aujourd’hui, revue ITER Nº2, 2020.
___________________________
La traduction devient la loi, le devoir et la dette mais de la dette on ne peut plus s’acquitret.
Des tours de Babel, J. Derrida
A tradução torna-se a lei, o dever e a dívida, mas dívida que não se pode mais quitar.
Torres de Babel, J. Derrida
La philosophie de Jacques Derrida n’a été peut-être qu’un travail de deuil : de l’origine, de l’original, du sens, de la présence, du sujet.[1] Les faisceaux avec lesquels il articule la langue, le langage, la traduction et la déconstruction sont plus ou moins inséparables dans sa pensée, résistant à la séparation, comme s’ils pouvaient être présentés comme des objets uniques devant leurs interprètes, traducteurs ou chercheurs. Ce sont plutôt des labyrinthes d’inscriptions[2], des chemins qui offrent autant d’itinéraires que possible à parcourir, des erreurs entre des textes dont les points de contact ou de séparation sont presque indistincts. Dans l’hypothèse où Derrida aurait commencé sa philosophie en nommant la « déconstruction », je peux peut-être proposer que dès l’origine, toute traduction est trahison : le terme déconstruction vient de « Destruktion », que Derrida trouve en Heidegger et transforme, non pas jusqu’au point de perdre l’original, mais suffisamment pour ne pas être qu’une transposition d’une langue à une autre[3]. Dans une certaine mesure, sa pensée s’articulait avec les trois H de la tradition philosophique, à savoir Hegel – ou la réception française de Hegel -, Husserl et Heidegger, circulant entre la phénoménologie, l’existentialisme et le structuralisme. Derrida y ajoute des penseurs comme Nietzsche et Freud, comme s’il construisait sa propre tour de Babel des langages philosophiques.
Si j’avais l’intention de suivre dans ce labyrinthe la voie de l’interprétation de Derrida comme théoricien de la traduction – ce qui serait certainement insuffisant pour le définir –, il faudrait peut-être commencer par reconnaître que, s’agissant du problème de la traduction, sa relation avec Walter Benjamin est inévitable. Lui qui fut aussi un philosophe-traducteur, réfléchit sur sa tâche. Il est un penseur qui compte dans les relations entre la France et l’Allemagne, la philosophie française et l’allemande, leurs malentendus, leurs divergences et leurs désaccords. Les passages de l’allemand au français ont tellement marqué l’œuvre de Benjamin qu’il est difficile de le localiser d’un côté ou de l’autre du Rhin. Parmi les nombreuses questions soulevées dans la discussion que Derrida engage avec Benjamin, j’aimerais en relever deux : (1) l’aporie entre fidélité et liberté de la traduction, la première étant entendue comme restitution du sens, la seconde comme tâche de renommer ; (2) le langage compris comme ce qui ne communique qu’avec soi-même quand il nous fait percevoir qu’« il y a du langage ». Dans Des tours de Babel[4], Derrida établit un lien entre deux textes de Benjamin – « La tâche du traducteur » et « Sur le langage en général et sur le langage humain »[5] – pour aborder la critique de Benjamin de toute conception du langage qui vise à désigner quelque chose en dehors de lui-même[6]. De différentes manières, mais n’en étant jamais trop loin, Derrida serait aussi un critique de la langue comme transmission ou communication du sens. Dans son maniement du langage, Derrida fait de la lecture de sa philosophie la tâche de la traduction. Même en français : « Mon désir est que nous ne pouvons pas, c’est-à-dire aussi, et pour cette raison même que nous devons, me traduire même en français »[7]. Ses interprètes ou commentateurs ont été et sont encore, chacun à leur manière, ses traducteurs, marqués par un mouvement incessant pour tenter de restituer du sens. C’est comme si dans sa pensée il y avait un objet qui, n’étant pas présent, exigeait un effort de plus, une langue de plus, plus d’une langue.
_ _ _
En 1996, lorsque Derrida publie Demeure. Maurice Blanchot, il avoue sa passion pour la littérature[8]. En 1998, dans la conférence « Qu’est-ce qu’une traduction ‘relevante’ ? », il est temps de confesser sa passion pour le mot, pour sa singularité et son irréductibilité :
Qu’il s’agisse de grammaire ou de lexique, le mot – car le mot sera mon sujet –, il ne m’intéresse, je crois pouvoir dire, je ne l’aime, c’est le mot, que dans le corps de sa singularité idiomatique, c’est-à-dire là où une passion de traduction vient le lécher – comme peut lécher une flamme ou une langue amoureuse : en s’approchant d’aussi près que possible pour renoncer au dernier moment à menacer ou à réduire, à consumer ou à consommer, en laissant l’autre corps intact mais non sans avoir, sur le bord même de ce renoncement ou de ce retrait, fait paraître l’autre, non sans avoir éveillé ou animé le désir de l’idiome, du corps original de l’autre, dans la lumière de la flamme ou selon la caresse d’une langue.[9]
Le mot sera le double bind de la présence/absence de l’objet perdu. Sa restitution est une indication de ce qui est irréductible dans la langue, dans toute langue, dans la langue elle-même qui a toujours été perdue. Le mot devient une expérience de perte originelle, dont le travail de deuil sera la tâche du traducteur.
Je propose également d’inclure Le Monolinguisme de l’autre dans une trilogie de déclarations d’amour, cette fois pour la langue française, la reconnaissance de sa passion pour sa propre langue qui vient de l’autre et produit une marque, comme un trait d’union, comme le trait d’union qui, en même temps, unit et sépare le « franco-maghrébin ». Le trait d’union est un élément silencieux de la grammaire qui ne peut être qu’écrit, mais jamais dit, présent dans le silence et le secret qui séparent et unissent la France et l’Algérie, et qui séparent et unissent les Français et les Algériens, les colonisateurs et les colonisés[10]. C’est dans sa langue maternelle que Derrida rencontrera cette aporie de la langue : « Je n’ai qu’une langue, or ce n’est pas la mienne »[11]. Dans cette langue, à la fois la mienne et celle des autres, il produira une homophonie entre la mère et la mer, la mer qui sépare la France de l’Algérie. La langue qui vient de la mer et de la mère, une langue sans laquelle il n’est pas possible d’avoir un pays, une patrie, langue qui surmonte et maintient la séparation avec la mer Méditerranée.
Avoir ou ne pas avoir une langue vous amènera à réfléchir sur votre engagement à être/avoir un bon français, français de France « dont nous arrivaient les paradigmes de la distinction, de la correction, de l’élégance, de la langue littéraire ou oratoire »[12]. Je voudrais ici vous rappeler que la correction de la langue française suppose de savoir l’utiliser dans ses deux formes distinctes : la forme parlée et la forme écrite. Il faut savoir que, dans une expression aussi simple que « les uns et les autres », il faut prononcer la liaison entre le « s » de la fin de « les » et de « uns », tout comme il faut laisser en silence le « s » du pluriel de « autres ». Dans ce petit exemple, je trouve l’indice que la maîtrise de la distinction entre langue écrite et langue parlée façonne la correction de l’usage du français à partir des différences. Il est intrinsèque à la règle de la langue de savoir faire la différence – souvent silencieuse, comme les pluriels – entre bien parler et bien écrire. Être plus ou moins français, plus ou moins algérien, avoir plus ou moins d’appartenance à la France dépend de la maîtrise de la différence entre langue écrite et langue parlée. Le problème apparaît comme une question théorique dans la lecture critique de la linguistique structuraliste de F. Saussure par Derrida, dans laquelle le phonocentrisme saussurien ? apparaît comme une question ; il se performativise dans sa proposition d’une différance avec « a », irréductible à la sonorité, exigeant une référence au texte écrit ; et revient, comme un spectre, dans le texte autobiographique Le Monolinguisme de l’autre, où la condition coloniale est considérée comme spectrale et le colonisé est hanté par ce qu’il n’est pas et ce qu’il ne peut pas être, comme celui dont l’identité est en relève.
Derrida est un philosophe qui a réfléchi à la langue française et s’interroge sur ce que signifie être français. C’est dans son rapport au langage que nous pouvons voir : 1) l’utilisation de certains signifiants de la langue, qu’il modifie à partir d’un glissement de sens, dans une opération de traduction à l’intérieur de la langue, parmi lesquels j’indiquerai l’écriture, la trace, le don, le pardon, l’hospitalité, en accord avec ce que R. Jackobson appelle « la traduction intralinguistique », c’est-à-dire l’interprétation des signes d’une langue dans cette même langue ; 2) les homophones, comme « différance » ou « hantologie », qui accomplissent la performance du problème de la relation entre la parole et l’écriture avec laquelle il inaugure son projet grammatologique et sa critique du phonocentrisme ; 3) les homonymes, comme « demeure » ou « fichus » (voile) et le « fichu » (participe passé du verbe ficher, en ruine, baisé), avec lequel il reprend un des problèmes de la tradition philosophique : celui d’avoir stabilisé les ambivalences linguistiques, comme dans l’exemple du mot grec pharmakon, dont l’ambiguïté entre le sens de poison et celui de remède a été effacée dans la traduction française par remède.
Fichus est le titre du livre dans lequel Derrida publie son Discours de Francfort, prononcé lorsqu’il a remporté le Prix Adorno en 2001. Les points de connexion que Derrida établit comme l’héritage de la pensée de T. Adorno sont explicites dans le texte, mais les voiles – fichus – dissimulent la relation entre Derrida et Benjamin, qui sous-tend toute la dette qu’il reconnaît envers Adorno[13]. Derrida se réfère à Adorno à partir du contenu d’un rêve rapporté par Benjamin, en utilisant deux éléments extérieurs au domaine de la philosophie traditionnel : la forme épistolaire et le langage onirique. Pour en arriver à Adorno, Derrida passe par Benjamin, en citant une lettre écrite à Gretel Adorno, dans laquelle Benjamin anticipait et annonçait sa mort. Il écrit :
(…) Je m’approchais. Ce que je vis était un étoffe qu’était couverte d’images et dont les seuls éléments graphiques que je pus distinguer étaient les parties supérieures de la lettre D dont les longueurs effilées décelaient une aspiration extrême vers la spiritualité. Cette partie de la lettre était au surplus munie d’une petite voile à bordure bleue et la voile se gonflait sur le dessin comme si elle se trouvait sous la brise. C’était là la seule chose que je pus « lire » – le reste offrait des motifs indistincts de vagues et de nuages. La conversation tourna un moment autour de cette écriture. Je ne me souviens pas d’opinions avancées ; en revanche, je sais très bien qu’à un moment donné je disais textuellement ceci : « Il s’agissait de changer en fichu une poésie ».[14]
Il y a des éléments qui m’intéressent dans cet extrait : la transformation à laquelle Benjamin fait référence, que je vais comprendre comme la traduction de la poésie en voile, de la poésie en tissu ou de l’écriture en couverture. Dans ce tissu, il y a une ressource à l’instance de la lettre – si je peux parler comme Lacan – ou le retour à la différance : « Je parlerai, donc, d’une lettre. »[15] Dans le rêve, Benjamin peut percevoir les parties supérieures de la lettre D, pleine de densités : c’est l’initiale du nom Detlef, qu’il a utilisé dans sa correspondance ; c’est aussi la lettre du nom de Dora, son ex-femme ; l’initiale du nom de famille de Derrida, et ce sera la lettre d’où Derrida établit sa liaison avec Benjamin quand il interprète le rêve : « Moi, d, je suis fichu. »[16] D est foutu et anticipe sa mort, comme Benjamin l’avait fait. Derrida traduit le rêve de l’autre dans la langue de l’autre, il rêve d’une philosophie faite dans plus d’une langue, question dont il inaugure le discours : « La langue sera d’ailleurs mon sujet : la langue de l’étranger, voir de l’immigrant, de l’émigré ou de l’exilé. »[17] Benjamin, comme Derrida, chacun à sa manière, a vécu l’exil même chez soi.
_ _ _
Il y a de nombreuses difficultés à traduire Derrida dans n’importe quelle langue. En ce qui concerne l’anglais, certains de ces obstacles sont spécifiquement abordés dans l’introduction écrite par la philosophe Judith Butler pour l’édition du 40e anniversaire de la publication Of Gramatology, traduite en anglais par Gayatri Spivak. Les commentaires de Butler suivent de très près l’argument de Derrida dans « Qu’est-ce qu’une traduction ‘relevante’? ». Butler commence par poser deux questions qui m’intéressent :
La question de savoir si Derrida serait lisible en anglais a été soulevée de deux façons différentes : 1) Pourrait-il être lu, étant donné les défis qu’il a posés aux protocoles de lecture conventionnels ? et 2) Pourrait-il être lu, étant donné que la version anglaise ne saisissait pas dans les moindres détails les principaux termes et transitions du français original.[18]
Ce sont des problèmes avec lesquels Derrida a également provoqué ses traducteurs. Un exemple à suivre est celui de la différance, souvent conservée dans l’original, et d’innombrables autres fois l’objet de tentatives de traduction. De part et d’autre, en maintenant en français ou en essayant de créer une solution dans la langue de traduction, la différance est, dans la pensée de Derrida, l’élément performatif de la provocation à la traduction : « l’irréductibilité intraduisible de l’idiome, certes, tout en appréhendant autrement cette intraductibilité. Ce ne serait plus une limite hermétique, l’opacité d’un écran, mais plutôt une provocation à la traduction. »[19] L’approche de la différance comme intraduisible se retrouve dans l’édition américaine de Of Gramatology, ainsi qu’au Portugal, où la philosophe Fernanda Bernardo a choisi de maintenir la différance dans l’original non seulement dans les nombreuses œuvres de Derrida, mais aussi dans ses propres œuvres, comme la plus récente, Derrida – o dom da différence[20]. Au Brésil, la provocation à la traduction à laquelle se réfère Derrida apparaît dans les innombrables possibilités créées par les traducteurs brésiliens : diferância/diferência, diferante, diferença/diferança, diferência, diferensa, dyferença[21]. Ce sont des tentatives pour exprimer le problème du phonocentrisme que Derrida rend explicite dans l’échange indicible du « e » pour le « a », justement une des fonctions de la différance, qui soulève au moins trois autres questions dans sa philosophie : désigner la différence comme retard et aussi comme être différent ; indiquer le mouvement de la différenciation, et questionner la limite des différences binaires.
Le terme différance a transité dans différents contextes de lecture. Au premier moment des lectures brésiliennes, l’accent mis sur la question du phonocentrisme s’est exprimé dans des créations-traductions qui cherchaient à faire travailler, en portugais, quelque chose de ce que Derrida faisait avec son intervention dans le mot. Aux États-Unis, Spivak et Butler se sont intéressées par la possibilité de différance de
rendre compte de ce qui permet l’articulation, de ce qui est « différent » de la notion binaire de différence contenue dans une unité dialectique, une différence qui différencie les éléments internes qui appartiennent à un ensemble plus grand. Cette invention orthographique marque ce qui ne peut être rassemblé et contenu par des termes binaires, oppositionnels, mais doit rester à l’extérieur, où l’extérieur n’est pas exactement le contraire de l’intérieur.[22]
La perception que la remise en question des oppositions binaires vient de l’échange de « e » contre « a » est valable pour Butler comme une indication que l’intérieur et l’extérieur ne sont plus opposés et que les différences oppositionnelles sont différées, co-pertinentes, ouvrant l’espace à un ensemble de questions éthiques et politiques qui résonnent encore chez Butler.
Le marquage silencieux sur le corps du mot me rappelle une autre marque graphique : le trait d’union du philosophe franco-maghrébien amoureux de la langue française. Je reviens sur la question avec une citation de Derrida : « (…) je ne sais pas où l’on peut trouver des traits internes et structurels pour distinguer rigoureusement entre langue, dialecte et idiome »[23]. Je pense à ce trait non seulement comme une marque de ce qui n’est ni à l’intérieur ni à l’extérieur, mais aussi comme la liaison indiquant qu’il n’était ni un simple algérien ni un français légitime, le « franco » désignant l’algérien colonisé, l’« algérien » désignant le français assimilé, une nationalité sans condition, au sens le plus paradoxal du terme. Immigré de l’ancienne colonie, Derrida est parti étudier en France « comme s’il était » français en marquant – avec ce trait d’union qui unit le franco-algérien et sépare la France de l’Algérie, la distance entre l’Europe et l’Afrique – la conditionnalité de la citoyenneté française. Sa philosophie se meut dans l’aporie de la relation dialectique entre l’intérieur et l’extérieur, forçant la reconnaissance du fait que l’intérieur est impliqué dans l’extérieur et l’extérieur, impliqué dans l’intérieur, tout comme la France l’était en Algérie et vice-versa.
La fin des distinctions rigoureuses a peut-être été le plus grand héritage que Derrida a laissé à la philosophie. À chaque contamination entre des pôles destinés à être opposés ou séparés, quelqu’un le menaçait d’exil dans le département de rhétorique, ou pire, chez les sophistes[24]. Ce n’est que bien longtemps après que Barbara Cassin a écrit Jacques, le sophiste[25] pour identifier un autre Jacques – Lacan – avec l’art de travailler le langage en lui-même, en forçant le langage à se contenir, sans désigner un extérieur, soit comme une représentation de l’objet, soit comme une production de sens. Avec le terme différance, il me semble que Derrida s’est inauguré à lui-même comme un sophiste, produisant son petit objet a, articulant ce qui reste inassimilable dans l’expérience du langage – dont la performance est accomplie dans les expériences de traduction – avec le reste énigmatique de l’expérience d’identification. Et, avec la différance, Derrida demeure irréductible.
Butler identifie des difficultés de traduction vers l’anglais. Pour moi, il me semble également important de signaler un exemple dans lequel Derrida a utilisé une expression singulière de la langue anglaise pour son argumentation. Ce fut le cas lors de la conférence « Force of Law : the Mystical Foundation of Autority », donnée d’abord en anglais, au colloque Deconstruction and the Possibility of Justice, tenu à la Cardoso Law School en 1989[26]. Il y utilise le syntagme « to enforce the law » pour montrer qu’il n’y a pas d’applicabilité de la loi sans force. Le titre de la conférence devient aussi le titre du livre Force de loi – le fondement mystique de l’autorité, dont la première partie – « Du droit à la justice » – correspond avec la première conférence aux États-Unis[27]. L’essentiel de son argumentation repose sur une expression dont la traduction en français, ainsi qu’en portugais, fait disparaître le problème de la force. Dans les deux langues, le syntagme qui correspond à « to enforce the law » est « l’application de la loi » [aplicação da lei], avec laquelle l’aspect le plus important de ce dont Derrida veut discuter est éliminé : la violence inhérente au droit, à la loi, à la justice et à tout ce que nous avons l’habitude d’appeler justice si rapidement. Il y a circulation entre les langues en appliquant la loi de la traduction, la dette qui ne peut s’acquitter.
Dans Spectres de Marx : L’Etat de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale[28], Derrida pense à une homophonie, ontologie/hantologie, avec laquelle il attire, entre autres, l’attention sur le caractère spectral et fantasmagorique de l’ontologie. Le philosophe anglais Mark Fisher a commencé à contester la prémisse du capitalisme comme destin unique utilisant également, mais pas seulement, la notion d’hantologie. Fisher n’a pas eu tant de difficulté à transposer le terme en anglais – même s’il n’y a pas d’homophonie parfaite entre hauntology et ontology – parce qu’il utilise l’existence du mot « haunt » comme synonyme du « hanter » française utilisée par Derrida. En traduisant Spectres de Marx au portugais, Anamaria Skinner se heurte à l’impossibilité de faire fonctionner l’homophonie ontologie/hantologie et choisit obsidiologia :
Un spectre hante l’Europe. Nous précisons que bien que nous traduisions du français, il s’agit de la forme verbale geht suivie du « un » de l’allemand original, qui est traduit en portugais sous la forme ronda, et non par le verbe « hanter ». Nous ne discuterons pas ici les significations possibles de hanter et de hantise, car elles sont en partie le sujet de ce livre. Nous suggérerons simplement que, bien que les dictionnaires franco-portugais distinguent deux significations pour hanter – (1) fréquenter ; (2) obséder, obséder -, il faudrait dire, comme le fera J. Derrida, que « cette distinction est plutôt une co-implication ». Ainsi, nous avons gardé le verbe rondar dans la première phrase du « Manifeste » et nous avons traduit hanter par « obsidiar », hantise par « obsessão » et hantologie par « obsidiologia ».[29]
Parmi les commentateurs du travail de Fisher, il y a eu d’autres tentatives de traduction vers le portugais, comme espectrologia ou assombrologia, et de mon point de vue, aucune ne fonctionne de la même manière que hantologie/hauntology[30]. Le traducteur espagnol de Fisher, Fernando Bruno, utilise hauntología, en accord avec mon point de vue selon lequel, s’agissant d’un néologisme dans la langue dans laquelle il a été d’abord proposé, il peut rester tel quel dans la langue de traduction[31]. Alors, en portugais, j’expérimente l’utilisation de hantologia en suivant la traduction de l’édition argentine, et en maintenant ainsi l’étrangeté du terme, peut-être pour faire comme Derrida lui-même :
Une homonymie ou une homophonie n’est jamais traduisible dans le mot à mot. Il faut ou bien se résigner à en perdre l’effet, l’économie, la stratégie (et cette perte peut être énorme) […] Partout où l’unité du mot est menacée ou mise en question, ce n’est pas seulement l’opération de la traduction qui se trouve compromise, c’est le concept, la définition et l’axiomatique même, l’idée de la traduction qu’il faut reconsidérer.[32]
Si, pour Derrida, rien n’est intraduisible, c’est aussi parce que rien n’est totalement traduisible. Ainsi, à chaque perte, ce qui est irréductible dans le travail de deuil demeure. Comme dans la traduction de l’écriture, comme l’a dit Leyla Perrone-Moisés dans la traduction brésilienne du texte de Roland Barthes Leçon. Elle observe que, pour Barthes, l’écriture est celle de l’écrivain : « Toute écriture est donc un texte écrit ; mais pas tous les textes écrits sont une écriture, au sens barthesien du terme. L’utilisation du mot écriture dans la traduction des textes de Barthes a l’avantage de préciser la particularité de la notion couverte par ce terme. »[33]
Suivant la distinction proposée par Perrone-Moisés, je constate que le terme escritura [écriture] est établi dans les traductions brésiliennes de Derrida, bien que tous les textes écrits ne soient pas des écritures, au sens barthesien ou même au sens derridien. De la rencontre avec l’œuvre de Claudia Moraes Rego[34] – et donc déjà dans le contexte de la réception de Derrida dans la théorie psychanalytique, malgré toutes les résistances – j’ai plaidé pour l’utilisation de « escrita » plutôt que d’ « escritura »[35]. Mon choix gagne en cohérence dans l’articulation entre l’écrit de Freud et l’écrit de Derrida, ici comprise comme un trait de Derrida en Freud ou comme une trace de Freud en Derrida. C’est par le trait, observe-t-il, que Freud fait la transition d’un modèle neurologique à un modèle psychique de la mémoire, qui cesse d’être un retour à son origine et devient une pure répétition. C’est à partir de la lecture de Freud que Derrida se rend compte du fait que c’est l’idée de la première fois elle-même qui devient énigmatique, ouvrant la possibilité de penser une autre forme de temporalité qui nous léguera la perception de la différance comme différer, rupture avec la possibilité chronologique de connecter linéairement passé, présent et futur. En mettant en doute la traduction brésilienne d’« écriture », je constate que l’utilisation du terme « écrit » permet de faire référence à Freud comme un auteur qui ouvre à Derrida la porte par laquelle, depuis sa discussion de Husserl, la langue avait été le moyen d’affronter les présuppositions de la philosophie transcendantale[36]. Il y a encore beaucoup à dire sur les relations que Derrida établit entre Freud et l’écrit : c’est avec Freud que le philosophe questionnera l’autorité de la conscience, déplaçant le concept de l’écrit au concept de l’écrit psychique et recourant aux concepts de trace [Spur] et de frayage [Bahnung] pour penser la différence, qui sera aussi différance. L’écrit psychique, compris comme la circulation de l’énergie entre le conscient et l’inconscient, indique la contamination entre la présence et l’absence que la différence oppositionnelle voulait soutenir. Ces relations entre la trace et l’écrit dans la psychanalyse de Freud se perdent dans la stabilisation de la traduction par « écriture ». Il y aurait donc un travail de deuil pour la perte de la réduction de l’écriture à escritura, qui effacerait l’immense branche du sens entre trace, trait et écrit[37].
La déstabilisation des possibilités de traduction nous plonge dans l’expérience de l’irréductibilité de la langue, de ce qui appelle à la traduction et en même temps y résiste. La tâche du traducteur s’articule alors avec le travail du deuil proposé par Freud : en perte, le sujet assimile quelque chose de l’objet perdu, faisant du deuil une expérience de la présence de ce qui reste, mais pas complètement, et de l’absence de ce qui a été perdu, mais pas complètement, laissant une trace d’écriture psychique chez celui qui subit la perte. Le sujet de la perte devient ainsi porteur d’un secret qui reste indéchiffrable dans la traduction entre ce qui a été perdu et ce qui, de l’objet, demeure irréductible. C’est le secret de ce qui demeure irréductible dans le passage d’une langue à l’autre[38].
_ _ _
Derrida était un philosophe-traducteur, fier de beaucoup de ses créations. Son doctorat est la version française de L’origine de la géométrie de E. Husserl[39], précédée d’une longue introduction. Ensemble, les textes ont abouti à la publication de son premier livre[40]. En tant que traducteur de Husserl, il a proposé le syntagme « vouloir-dire » pour traduire « Bedeutung »[41]. Le problème de la traduction apparaît dans son commentaire du texte de Husserl à la recherche d’un langage pour la science qui éliminerait l’équivocité du langage commun. Derrida suit de près les traces de Husserl jusqu’à souligner ce qu’il considère comme un problème dans la relation entre le langage et l’origine (de la géométrie comme une science idéale) : il observe que Husserl n’a jamais cessé de faire appel à l’impératif de l’univocité, reprenant une fois encore la distinction entre plurivocité contingente et essentielle qui était déjà à l’œuvre dans les Recherches Logiques. Derrida est attentif au désir de Husserl qui souhaite que la science et la philosophie dépassent leur plurivocité essentielle, afin « d’assurer l’exactitude de la traduction et la pureté de la tradition »[42]. L’impossibilité de la pureté de la traduction ne manquera pas de faire écho chez Derrida. Au même moment, Derrida s’intéresse à la problématique de l’équivocité de la langue, dans une comparaison entre la littérature de James Joyce et les propositions de Husserl. Derrida propose de distinguer deux conceptions de l’équivocité du langage :
L’une ressemblait à celle de J. Joyce : répéter et reprendre en charge la totalité de l’équivoque elle-même, en un langage qui fasse affleurer à la plus grande synchronie possible la plus grande puissance des intentions enfouies, accumulées et entremêlées dans l’âme de chaque atome linguistique, de chaque vocable, de chaque mot, de chaque proposition simple, par la totalité des cultures mondaines, dans la plus grande génialité de leurs formes (mythologie, religion, sciences, arts, littérature, politique, philosophie, etc.) ; faire apparaître l’unité structurale de la culture empirique totale dans l’équivoque généralisée d’une écriture qui ne traduit plus une langue dans l’autre à partir de noyaux de sens communs, mais circule à travers toutes les langues à la fois, accumule leurs énergies, actualise leurs consonances les plus secrètes, décèle leurs plus lointains horizons communs, cultive les synthèses associatives au lieu de les fuir et retrouve la valeur poétique de la passivité ; bref, une écriture que, au lieu de le mettre hors-jeu par des guillemets, au lieu de ‘réduire’, s’installe résolument dans le champ labyrinthique de la culture ‘enchaînée’ par ses équivoques, afin de parcourir et de reconnaître le plus actuellement possible la plus profonde distance historique possible.[43]
Husserl s’oppose à cette conception. Selon lui, l’équivocité du langage est traitée comme une aberration philosophique et devrait être éliminée. Derrida révèlera une contradiction irréductible dans la proposition husserlienne qui a l’intention de :
réduire ou appauvrir méthodiquement la langue empirique jusqu’à la transparence actuelle de ses éléments univoques et traductibles, afin de ressaisir à sa source pure une historicité ou une traditionnalité qu’aucune totalité historique de fait ne me livrera d’elle-même et qui est toujours déjà présupposée par toute répétition odysséene de type joycien, comme par toute philosophie de l’histoire – au sens courant – et par toute phénoménologie de l’esprit.[44]
Derrida conclut : « cette première hypothèse d’une langue univoque et naturelle est donc absurde et contradictoire. »[45] Tout se passe alors comme si son engagement dans le débat philosophique sur le langage devenait une version philosophique de ce qu’il perçoit dans l’œuvre de Joyce : « dans l’équivoque généralisée d’une écriture que ne traduit plus une langue dans l’autre à partir de noyaux de sens communs, mais circule à travers toutes les langues à la fois. »[46]
Je voudrais alors suggérer que le meilleur exemple de cette circulation à travers toutes les langues à la fois se trouve dans l’idée de choisir « relever » comme traduction française à l’Aufhebung. Derrida écrit : « Ce mot dont l’appartenance au français ou à l’anglais n’est pas très assurée, ni décidable (…) voilà qu’il vient à une place doublement éminente et exposée ».[47] Je voudrais vous rappeler que c’est à cause d’une difficulté de traduction que Derrida admet le plus explicitement sa dette envers Hegel. Dans la conférence où il présente le « a » de différance, Derrida revient sur « Hegel à Iéna » pour s’arrêter sur un problème rencontré par le traducteur A. Koyré : comment traduire de l’allemand au français l’expression « different Beziehung ». Ce mot allemand – « différent » – a une racine latine et est inhabituellement utilisé non seulement en allemand, mais aussi dans le vocabulaire de Hegel, qui donne la préférence à des termes tels que verschieden, ungleich, ou Unterschied, Verschiedenheit et leurs variations quantitatives. Dans une note de traduction sur l’utilisation de l’expression « different Beziehung », Koyré note que « different » est le terme utilisé par Hegel pour désigner une sorte de différence « au sens actif ». C’est à partir de ce constat de Koyrè que Derrida lie ce qui est irréductible dans la différence au sens actif à la différance : « Écrire ‘différant’ ou ‘différance’ (avec un a) pourrait déjà avoir l’utilité de rendre possible, sans autre note ou précision, la traduction de Hegel en ce point particulier qui est aussi un point absolument décisif de son discours. »[48]
Le terme différance avait déjà été utilisé plusieurs fois par Derrida avant d’être présenté à la conférence « La différance » (1968), qui commence par une annonce : « Je parlerai, donc, d’une lettre. »[49] Derrida explique que la différance est le résultat d’un « faisceau » provenant de chemins différents : « le mot faisceau paraît plus propre à marquer que le rassemblement proposé à la structure d’une intrication, d’un tissage, d’un croisement que laissera repartir les différents fils et le différentes lignes de sens – ou de force – et tout comme il sera prêt à en nouer des autres. »[50] Parmi ces différentes lignes de force se trouve l’accueil français de Hegel, dont Derrida fait également partie. Pour essayer de faire fonctionner la liaison entre différance et Aufhebung, il faudrait d’abord se rappeler que l’Aufhebung hégélienne contient deux mouvements – conservation et dépassement, surmontant celui-ci où le nouvel élément contient ce qui a été dépassé. À chaque étape, l’Aufhebung se stabilise, même si elle doit être ensuite surmontée. Voilà la différence « minimale et radicale » que l’on attribue à Derrida par rapport à Hegel, puisque la différance pointe vers un mouvement dans lequel la conservation et le dépassement se produisent simultanément, sans le moment de la stabilisation. Sur le chemin de faire la différence une différenciation – ici une traduction possible pour la différence active que Derrida veut récupérer dans Hegel de la traduction de Koyré –, Derrida établit
[un] rapport entre une différance qui retrouve son compte et une différance qui manque à retrouver son compte, la mise de la présence pure et sans perte se confondant avec celle de la perte absolue, de la mort. Par cette mise en rapport de l’économie restreinte et de l’économie générale on déplace et on réinscrit le projet même de la philosophie, sous l’espèce privilégiée du hégélianisme. On plie l’Aufhebung – la relève – à s’écrire autrement. Peut-être, tout simplement, à s’écrire. Mieux, à tenir compte de sa consommation d’écriture.[51]
Dans ce passage, Derrida réécrit l’Aufhebung comme une différance et, de plus, force cette consommation d’écriture dans le cadre d’un projet philosophique consistant à confondre la voix et la présence. Dans « Le puits et la pyramide »[52] – un exposé du séminaire de Jean Hyppolite au Collège de France le 16 janvier 1968, 15 jours avant la conférence « La différance » à la Société française de philosophie –, il propose de traduire Aufhebung par « relève » et le verbe aufheben par « relever ».
La suggestion derridienne de traduire Aufhebung par relève n’a pas été consensuelle. Elle visait à remplacer le néologisme créé par Yvon Gauthier « sursumer », qui s’opposait au verbe « subsumer », utilisé dans la traduction française de la Critique de la raison pure de Kant[53]. Le traducteur français du cours de Heidegger sur la phénoménologie de l’Esprit a proposé de la traduire par « assomption », en rejetant ainsi les deux solutions précédentes[54]. Derrida avait justifié son choix du verbe relever par référence au « le double motif de l’élévation et du remplacement qui conserve ce qu’il nie ou détruit, gardant ce qu’il fait disparaître »[55]. Dans l’entrée consacrée à l’Aufhebung dans le Vocabulaire européen des philosophies[56], le terme apparaît marqué par l’oscillation entre positivité et négativité. Cette oscillation se reflète aussi dans les difficultés de traduction, en soulignant parfois l’aspect le plus positif, parfois le plus négatif. Relever serait donc la tentative derridienne d’osciller dans cette double injonction : suspendre, par la négativité ; mettre en évidence, par la positivité, rendre le terme oscillant, intrinsèquement irréductible à un sens unique.
Ce n’est donc pas par hasard que j’ai l’intention de conclure ce petit raisonnement[57] en ce point : au lieu où l’irréductibilité de Hegel rencontre l’irréductibilité de Derrida. Soutenir sans dépasser ce jeu d’oscillation est l’une des manières dont je peux comprendre la proposition du philosophe Peter Sloterdijk de nommer Derrida « le Hegel du 20ème siècle » : « sa trajectoire a été définie par le soin vigilant de ne pas se laisser fixer dans une identité déterminée. »[58] Inévitable comme Hegel l’était en son temps, Derrida trouve dans la différance la plus grande proximité et la plus grande distance avec l’Aufhebung. Derrida est devenu un philosophe-traducteur qui, comme le décrit et le souligne Anamaria Skinner, « est un sujet redevable, à la merci d’un devoir, un héritier »[59]. La tâche du Derrida traducteur de Hegel suit les mêmes étapes que le travail de deuil fait par le XXe siècle après la perte de la totalité, cet objet toujours perdu, perdu dans la langue de l’autre, perdu dans plus d’une langue.
___________________________
[1] Cet article est dédié à Anamaria Skinner et à Fernanda Bernardo, qui nous ont précédés. Cette recherche s’inscrit dans le cadre du projet Jovens Cientistas do Nosso Estado (Faperj-2018/2020). J’ai établi une économie de traduction pour les références bibliographiques. En plus de l’indication des textes de Derrida en français, j’ai eu recours, dans la mesure du possible, à des traductions en portugais, dans des éditions brésilienne ou portugaise, respectivement indiquées comme « éd. bras. » et « éd. port. ». J’ai choisi de conserver les références à la traduction en notes en bas de page. C’est une manière de mentionner et, pourquoi pas, de louer, tous ceux qui, à un moment donné, ont eu à traduire Derrida. J’indique également quand la traduction est de moi.
[2] Je me réfère au titre du livre de R. Haddock-Lobo, Labirinto de inscrições (Porto Alegre : Editora Zouk, 2008). C’est avec Rafael que j’ai inauguré la traduction en brésilien d’Éperons – les styles de Nietzsche (Paris : Flammarion, 1973) [Esporas – les styles de Nietzsche, traduction de Rafael Haddock-Lobo et Carla Rodrigues. Rio de Janeiro : NAU Editora, 2013].
[3] Toujours par rapport à Heidegger, la philosophie de Derrida pose aussi le problème de la traduction française de Dasein par « réalité humaine ». Elle s’aligne ainsi avec la critique de l’humanisme d’après-guerre : « Il s’agit là, comme on sait, d’une traduction du Dasein heideggerien. Traduction monstrueuse à tant d’égards, mais d’autant plus significative. Que cette traduction proposée par Corbin ait alors été adoptée, qu’elle ait régnée à travers l’autorité de Sartre, cela donne beaucoup à penser quant à la lecture ou à la non-lecture de Heidegger à cette époque, et quant à l’intérêt qu’il y avait alors à le lire ou à ne pas le lire de la sorte » (J. Derrida, « Les fins de l’homme », dans Marges de la philosophie, p. 136, Paris : Les Éditions de Minuit, 1972). J’indique que ce passage n’est qu’un des problèmes de traduction que je n’aborderai pas dans le court espace de cet article. [« Tradução monstruosa em múltiplos aspectos, mas, por isso, tanto mais significativa. Que essa tradução proposta por Corbin tenha então sido adotada, que tenha reinado através da autoridade de Sartre, eis o que dá muito que pensar quanto à leitura ou à não-leitura de Heidegger nessa época e quanto ao interesse que havia então em lê-lo ou em não o ler dessa forma. » (J. Derrida, « Os fins do homem », dans Margens da filosofia, traduction de Joaquim Torres Costa et António M. Magalhães, Campinas (SP) : Editora Papirus, 1991, p. 153)]
[4] J. Derrida, « Des tours de Babel », dans Psyché – l’invention de l’autre, vol. 1, Paris : Galilée, 1987 [Torres de Babel, traduction de Junia Barreto, Belo Horizonte : Editora UFMG, 2006].
[5] W. Benjamin, « La tâche du traducteur ; Sur le langage en général et sur le langage humain », traduction de l’allemand par Maurice Gandillac dans Oeuvres, I, Paris : Gallimard, 2000 [« A tarefa do tradutor ; Sobre a linguagem geral e sobre a linguagem do homem », traduction de Susana Kampff Lages e Ernani Chaves, dans Escritos sobre mito e linguagem, São Paulo : Editora 34, 2011].
[6] Au sujet du langage, permettez-moi de faire référence à I. Pinho. »Tagarelar (Schwätzen) – itinerários entre linguagem e feminino ». Thèse de doctorat (philosophie). Conseillers d’orientation Carla Rodrigues et Cláudio Oliveira. Rio de Janeiro, IFCS/UFRJ : 2019.
[7] J. Derrida, « Fidélité à plus d’un. Mériter d’hériter où la généalogie fait défaut », dans Rencontre de Rabat avec Jacques Derrida. Idiomes, Nationalités, Déconstructions, Paris/Casablanca : Cahiers Intersignes/Éditions Toubkal, p. 221-226. [« Meu desejo é o de que não se possa, isto é, também, e por isso mesmo que se deve, me traduzir mesmo em francês », Fidelidade a mais de um – merecer herdar onde a genealogia falta, traduction de Paulo Ottoni dans Ottoni, Tradução manifesta, São Paulo, Ed. Unicamp/Edusp : 2005, p. 183].
[8] J. Derrida, Demeure. Maurice Banchot, Paris : Galilée, 1998. L’expression de ma gratitude à Flavia Trocoli sera toujours insuffisante par rapport à la délicatesse et au travail de deuil partagés dans cette tâche de traduction. [Demorar. Maurice Blanchot, traduction de Flavia Trocoli e Carla Rodrigues, Florianópolis : Editora da UFSC, 2015.]
[9] J. Derrida. « Qu’est-ce qu’une traduction ‘relevante’? », Cahier de l’Herne, p. 561. [ « Quer se trate da gramática ou do léxico, a palavra – pois a palavra será meu tema – não me interessa, creio poder dizê-lo, eu não a amo, é essa a palavra, senão no corpo de sua singularidade idiomática, quer dizer, lá onde uma paixão de tradução vem lambê-la – como pode lamber uma chama ou uma língua amorosa : aproximando-se tão perto quanto possível para renunciar, no último momento, a ameaçar ou a reduzir,a consumir ou a consumar, deixando o outro corpo intacto, mas não sem antes, à beira dessa renúncia ou dessa retirada, fazer aparecer o outro, despertado ou animado o desejo do idioma, do corpo original do outro, na luz da chama ou segundo a carícia de uma língua », p. 14 éd. bras. ]
[10] Je considère comme un fait biographique important que, lorsque Derrida a émigré d’Algérie en France, il a traduit son nom de baptême en français. Du « Jackie » d’origine choisi par son père, il passe à Jacques, ce qui peut avoir de nombreuses interprétations, le besoin d’assimilation à la culture française en étant la plus évidente. Cf. B. Peeters, Derrida, Paris : Flammarion, 2010 [B. Peeters, Derrida, traduction d’André Telles, Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2013].
[11] J. Derrida, Le monoliguisme de l’autre ou la prothèse d’origine, Paris : Galilée, 1996, p. 15 [« Eu não tenho senão uma língua, e ela não é minha, », O monolinguismo do outro ou a protése de origem, traduction de Fernanda Bernardo, Porto : Editora Campo da Letras, 2001. p. 13 ; Belo Horizonte : Editora Chão da Feira, 2016].
[12] Ibid., p. 73. [« (…) de onde nos chegavam os paradigmas da distinção, da correcção, da elegância, da lingua literária ou oratória », p. 59 éd. port.]
[13] Pour en savoir plus sur la relation entre Derrida et Adorno, cf. F. Durão, « Adorno e Derrida : uma tentativa de aproximação », dans R. Haddock-Lobo, C. Rodrigues et autres (éds.), Heranças de Derrida – da linguagem à estética, vol. 2, Rio de Janeiro : NAU Editora, 2014. Pour une hypothèse de lecture du Discours de Francfort comme critique de Derrida sur l’avenir de l’école de Francfort à travers les chemins habermasiens, voir J. P. Deranty, « Adorno’s Other Son : Derrida and the Future of Critical Theory », dans Social Semiotics, v. 16, n. 3, sept. 2006.
[14] W. Benjamin, Correspondence avec Gretel Adorno (1930-1940), Paris : Gallimard, 2007, p. 374 [« Eu me aproximava. Isso que eu via era um tecido que estava coberto de imagens e cujos únicos elementos gráficos que eu podia distinguir eram as partes superiores da letra D, nos quais as linhas afiladas assinalavam uma extrema aspiração em direção à espiritualidade. Essa parte da letra estava coberta por um pequeno véu bordado que se inflava sobre o desenho como se estivesse ventando. Era a única coisa que eu podia ‘ler’ – o resto oferecia motivos indistintos de ondas e nuances. A conversa se volta um momento em torno dessa escritura. Não me lembro de opiniões específicas, mas em contrapartida, sei muito bem em que dado momento eu dizia textualmente : ‘tratava-se de transformar uma poesia em fichu’ », ma traduction]. Une partie de ce rêve est citée dans J. Derrida, Fichus, Paris : Galilée, 2002, p. 37.
[15] J. Derrida, « La différance », dans Marges de la philosophie, Paris : Les Éditions de Minuit, 1972, p. 135-136 [« Falarei, pois, de uma letra » (« A diferença », dans Margens da filosofia, trad. Joaquim Torres Costa e António M. Magalhães, Campinas (SP) : Editora Papirus, 1991, p. 33)].
[16] J. Derrida, Fichus, p. 41.
[17] J. Derrida, Fichus, p. 9 [« A língua será aliás meu sujeito : a língua do outro, a língua do hóspede, a língua do estrangeiro, quer dizer, do imigrante, do emigrado ou do exilado », ma traduction].
[18] Ma traduction de l’anglais : « There were at least two different ways that the question of whether or not Derrida would be readable in English came to the fore : 1) Could he be read, given the challenges he delivered to conventional protocols of readings?, and 2) Could he be read, given that English version failed to capture in every detail the key terms and transitions of the original French. » J. Butler, « Introduction », dans J. Derrida, Of Grammatology, traduction de Gayatri Spivak, J. Hopkins University Press, 2016, p. vii.
[19] J. Derrida. “Fidélité à plus d’un. Mériter d’hériter où la généalogie fait défaut”. In. Rencontre de Rabat avec Jacques Derrida. Idiomes, Nationalités, Déconstructions. Cahiers Intersignes (Paris) e Éditions Toubkal (Casablanca), p. 221-26. [ « irredutibilidade intraduzível do idioma, certamente, mas ao mesmo tempo, apreender de outro modo essa intraduzibilidade. Isso não seria um limite hermenêutico, a opacidade impenetrável de um anteparo, mas, ao contrário, uma provocação à tradução ». Fidelidade a mais de um – merecer herdar onde a genealogia falta. Tradução Paulo Ottoni. IN : P. Ottoni. Tradução manifesta. São Paulo, Ed. Unicamp/Edusp : 2005. p. 171.]
[20] F. Bernardo, Derrida – o dom da différance, Coimbra : Palimage, 2019.
[21] Pour en savoir plus sur le riche débat sur la traduction de la différance, je me réfère à Ottoni, P, « A tradução da différance : dupla tradução e double bind », Alfa, 44, 2000, pp. 45-58.
[22] Ma traduction de l’anglais : « As a term, it seeks to account for what permits articulation, for whatever is ‘different from’ the binary notion of difference contained by a dialectical unity, a difference that differentiates internal elements that belong to a greater whole. This orthographic invention marks what cannot be gathered up and contained by binary, oppositional terms, but must remain outside, where the outside is not exactly the opposite of the inside ». Butler, ibid., p. xi.
[23] J. Derrida, Le monolinguisme de l’autre, p. 23, parenthèses de l’auteur [« Não sei onde se pode encontrar os traços internos e estruturais para distinguir rigorosamente entre língua, dialeto e idioma », p. 21 ed. port].
[24] Il me semble pertinent de transcrire ici cette prétendue menace qu’il a énoncée : « Ce que vous dites n’est pas vrai puisque vous questionnez la vérité, allons, vous êtes un sceptique, un relativiste, um nihiliste, vous n’êtes pas un philosophe sérieux! Si vous continuez, on vous mettra dans un département de rhétorique ou de littérature. La condamnation ou l’exil pourraient être plus graves si vous insistez, on vous enfermerait dans le département de sophistique. » (J. Derrida, Le monolinguisme de l’autre, p. 18. [« O que dizeis não é verdade, uma vez que questionais a verdade : sois um céptico, um relativista, um nihilista, não sois um filósofo sério! Se insistirdes, colocar-vos-ão num departamento de retórica ou de literatura. A condenação ou o exílio poderão ser ainda mais graves se insistirdes, fechar-vos-ão no departamento de sofística », p. 17 éd. port., p. 28 éd. bras.)] D’ailleurs, Butler est professeur au département de rhétorique de l’université de Berkeley.
[25] B. Cassin, Jacques, le sophiste, Paris : Epel, 2012. [B. Cassin, Jacques, o sofista, traduction de Yolanda Vilela, Belo Horizonte: Autêntica, 2017.]
[26] D. Cornell, M. Rosenfeld, D. Carlson (éds.), Deconstruction and the Possibility of Justice, New York, Londres : Routledge, 1992.
[27] J. Derrida, Force de loi – le fondement mystique de l’autorité, Paris : Galilée, 1994 [Força de lei – o fundamento místico da autoridade, traduction de Leyla Perrone-Mosés, São Paulo : Martins Fontes, 2007].
[28] Il est pertinent d’indiquer que ce livre ait été traduit par tant de femmes. Anamaria Skinner pour le portugais, Peggy Kamuf pour l’anglais, Suzanne Lüdemann pour l’allemand et Farid Zahi pour l’arabe. Cf. J. Derrida, « Fidélité à plus d’un », p. 179-180.
[29] A. Skinner dans J. Derrida, Espectros de Marx, Rio de Janeiro : Relume-Dumará, 1994, p. 18, n. 1.
[30] Parmi les lecteurs de Fisher au Brésil, il n’y a pas de consensus sur la traduction de l’hantologie/hauntology, comme on peut le voir dans les présentations faites au Colóquio Mark Fisher – realismo espectral. <http ://bit.ly/2J93VZl>.
[31] M. Fisher, Los fantasmas de mi vida – Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos, traduction de Fernando Bruno, Buenos Aires : Caja Negra, 2018 [M. Fisher, Ghosts of My Life : Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester, Washington : Zero Books, 2014].
[32] J. Derrida, « Qu’est-ce qu’une traduction ‘relevante’? », Cahier de l’Herne, p. 565 [« Uma homonimía ou uma homofonia nunca é traduzível no palavra a palavra. É preciso ou se resignar a perder seu efeito, sua economia, sua estratégia (e essa perda é enorme) (…) Em todos os lugares em que a unidade da palavra é ameaçada, ou colocada em questão, não é somente a operação da tradução que se encontra comprometida, é o conceito, a definição e a própria axiomática, a ideia de tradução que é preciso reconsiderar », p. 22 éd. bras.].
[33] R. Barthes, Leçon. Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie, Paris : Seuil, 1978 [Aula, traduction de Leyla Perrone-Moisés, São Paulo : Cultrix, 2008]. Je remercie à Anamaria Skinner de m’avoir indiqué la référence et pour les généreuses contributions de sa lecture.
[34] C. Moraes Rego, Traço, letra, escrita – Freud, Derrida, Lacan, Rio de Janeiro : 7Letras, 2006.
[35] Je remercie les interlocuteurs qui, dans leurs recherches au Brésil et en dialogue avec les formulations que j’ai proposées, ont utilisé ce problème de traduction dans leurs recherches. À savoir, D. Dardeau, « Das aporias da responsabilidade à ‘Fábula do Sujeito’ : a gênese conjunta da subjetividade e da responsabilidade segundo Derrida », thèse de doctorat (philosophie) dirigée par Rafael Haddock-Lobo e Fernanda Bernardo, UFRJ/Un, Coimbra, 2018 ; F. Castelo Branco, « Ética nos rastros da modernidade : entre desconstrução e pragmática universal », thèse de doctorat (philosophie), dirigée par Paulo Cesar Duque-Estrada, PUC-Rio, 2017 ; et K. Fidélis, « A carta/letra entre Derrida e Lacan », mémoire de maîtrise dirigé par Angela Vorcaro et Alice Serra, PUC-MG, 2018.
[36] Dans cet argument, j’utilise le rapprochement que Vladimir Safatle fait entre Derrida et Husserl pour établir son dialogue avec Freud. Voir V. Safatle, « Être juste avec Freud : la psychanalyse dans l’antichambre de De la grammatologie », dans P. Maniglier (éd.), Le moment philosophique des années 1960 en France, Paris : PUF, 2011 [V. Safatle, « Fazer justiça a Freud : a psicanálise na antessala da gramatologia », traduction d’Ana Luiza Fay, dans R. Haddock-Lobo, C. Rodrigues et autres (éds), Heranças de Derrida – da linguagem à estética, vol. 2].
[37] Pour en savoir plus sur le thème de l’écriture chez Freud, je voudrais faire référence à C. Rodrigues, « Memorar, memorando, me-morando : do transcendental ao quasi-transcendantal », https ://www.sudeste2015.historiaoral.org.br/resources/anais/9/1436979283_ARQUIVO_abho.pdf
[38] Au sujet de l’articulation entre la traduction et le travail de deuil, je me réfère à A. Skinner, « A ética da palavra e o trabalho do luto », dans E. Nascimento (éd.), Jacques Derrida : pensar a desconstrução, São Paulo : Estação Liberdade, 2005.
[39] [En vérité, L’origine de la géométrie a été le premier livre publié par Derrida, même si l’auteur principal est Husserl ; son doctorat d’État a été soutenu à Nanterre en 1980, sous le titre “L’inscription de la philosophie : Recherches sur l’interprétation de l’écriture” (Note des éditeurs)]
[40] J. Derrida. « Introduction à L’Origine de la géométrie », dans E. Husserl, L órigine de la géométrie, traduction de l’allemand par J. Derrida, Paris : PUF, 1962.
[41] M. Siscar, « Jacques Derrida, o intraduzível », Alfa, 44, 2000, pp. 59-69.
[42] J. Derrida, « Introduction à L’Origine de la géométrie », p. 103 [« Ela garante a exatitude da tradução e a pureza da tradição », p. 70 éd. bras.]. Toutes les traductions de l’« Introduction à L’Origine de la géométrie » sont miennes. Elles ont été publiées dans le dossier « Derrida e as ciências », Revista em construção, Uerj, 2018,
https ://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/emconstrucao/article/view/34349/24264.
[43] Ibid, p. 104 [« Uma pareceria com a de J. Joyce : repetir e retomar o controle da totalidade da equivocidade ela mesma, em uma linguagem que faz aflorar na maior sincronia possível a maior potência das intenções ocultas, acumuladas e entremeadas na alma de cada átomo linguístico, da cada vocábulo, de cada palavra, de cada proposição simples, pela totalidade das culturas mundanas, na maior genialidade de suas formas (mitologia, religião, ciência, artes, literatura, política, filosofia, etc) ; fazer aparecer a unidade estrutural da cultura empírica total no equívoco generalizado de uma escrita que não traduz mais uma língua na outra a partir de núcleos de sentidos comuns, mas circula através de todas as línguas de uma só vez, acumula suas energias, atualiza suas consonâncias mais secretas, descobre seus horizontes comuns mais distantes, cultiva as sínteses associativas ao invés de fugir delas, encontra o valor poético da passividade ; em resumo, uma escrita que, em lugar de se colocar fora do jogo pelas aspas, em lugar de ‘reduzi-la’, se instala resolutamente no campo labiríntico da cultura ‘concatenada’ por seus equívocos, a fim de percorrer e de conhecer de modo mais atual possível a mais profunda distância histórica possível », p. 70 éd. bras.].
[44] Ibid, p. 105 [« Reduzir ou empobrecer metodicamente a língua empírica até a transparência atual de seus elementos unívocos e traduzíveis, a fim de recapturar em sua fonte pura uma historicidade ou uma tradicionalidade que nenhuma totalidade histórica não me entregará, de fato, ela mesma, e que sempre já pressupõe toda repetição de uma odisseia do tipo da de Joyce, como por toda filosofia da história – no sentido corrente – e por toda fenomenologia do espírito », p. 70 éd. bras.].
[45] Ibid, p. 106 [« Essa primeira hipótese, de uma língua unívoca e natural é, portanto, absurda e contraditória », p. 71 éd. bras.].
[46] Ibid, p. 106 [« No equívoco generalizado de uma escrita que não traduz mais uma língua na outra a partir de núcleos de sentidos comuns, mas circula por todas as línguas de uma só vez », p. 70 éd. bras.].
[47] J. Derrida, « Qu’est-ce qu’une traduction ‘relevante’? », Cahier de l’Herne, p. 565 [« Essa palavra cuja pertença ao francês ou ao inglês não está bem assegurada nem decidida (…) eis que ela chega a um lugar duplamente eminente e exposto », p. 22 éd. bras.].
[48] J. Derrida. « La différance ». p. 15 [Escrever ‘différant’ ou ‘différance’ (com a) poderia já ter a utilidade de tornar possível, sem outra observação ou definição, a tradução de Hegel nesse ponto particular que é também um ponto absolutamente decisivo de seu discurso. p. 46 éd. bras.]
[49] Idem, p. 3. [« Falarei, pois, de uma letra ». p. 33 éd. bras.]
[50] Idem, p. 4. [ A palavra « feixe parece mais apropriada a marcar a semelhança proposta com a estrutura de uma imbricação, de um tecido, um cruzamento que poderá ser repartido em diferentes fios e diferentes linhas de sentido – ou de força – assim como está próximo de enredar outros. p. 34 éd. bras. ]
[51] Ibid, p. 21 [« (…) relação entre uma diferança que reencontra o seu proveito, e uma diferança que falha em encontrar o seu proveito, confundindo-se a posição de uma presença pura e sem perda com a da presença absoluta, da morte. Por esse relacionamento da economia restrita e da economia geral desloca-se e reinscreve-se o próprio projeto da filosofia, sob a espécie privilegiada do hegelianismo. Obrigamos a Aufhebung – a superação – a escrever-se de outro modo. Talvez, simplesmente, a escrever-se. Melhor, a ter em conta a sua consumação da escrita », p. 53 éd. bras.].
[52] J. Derrida, « Le puits et la pyramide », dans Marges de la philosophie, Paris : Les Éditions de Minuit, 1972, pp. 81-127 [« O poço e a pirâmide », dans Margens da filosofia, traduction de Joaquim Torres Costa e António M. Magalhães, Campinas (SP) : Editora Papirus, 1991].
[53] Y. Gauthier, « Logique hégélienne et formalisation », p. 152, n. 5, cité par Emmanuel Martineu dans M. Heidegger, La ‘phénoménologie de l’esprit’ de Hegel, traduction d’allemand par Emmanuel Martineau, Paris : Gallimard, 1984, p. 17.
[54] M. Heidegger, La ‘phénoménologie de l’esprit’ de Hegel, ibid.
[55] J. Derrida, « Qu’est-ce qu’une traduction ‘relevante’? », Cahiers de l’Herne, p. 573 [« O duplo motivo da elevação e da substituição que conserva o que é negado e destruído, guardando aquilo que faz desaparecer », p. 39 éd. bras.].
[56] B. Cassin, Vocabulaire Européen des Philosophies, Paris : Seuil, Le Robert : 2004. L’entrée « Aufheben ; Aufhebung » a été écrite par Philipe Büttgen, pp. 152-155.
[57] Je voudrais justifier ici l’usage de l’expression « raisonnement » pour faire référence à la formule « une raison doit se laisser raisonner », avec laquelle Derrida retrouve l’idée d’effacement dans son texte « Le ‘monde’ des Lumières à venir », dont l’importance a été décisive dans ma recherche sur les liaisons possibles entre Derrida et Benjamin. Cf. J. Derrida, Voyous, Paris : Galilée, 2003, p. 217 [« Uma razão deve deixar-se razoar », dans Vadios, traduction de Fernanda Bernardo. Coimbra : Palimage, 2009, p. 277]. Pour plus d’informations sur ce débat, cf. « Derrida, um filósofo maltrapilho », dans R. Haddock-Lobo, C. Rodrigues et autres (éds), Heranças de Derrida – da filosofia ao direito, vol. 1.
[58] P. Sloterdijk, Derrida, um egício, traduction d’Evando Nascimento, São Paulo : Estação Liberdade, 2009, p. 11 [Derrida, un egyptien, traduction de l’allemeand par Olivier Mannoni, Paris : Libella Maren Sell, 2006].
[59] A. Skinner, « Arquivos da tradução », dans E. Ferreira et P. Ottoni, Traduzir Derrida – políticas e desconstruções, Campinas, SP : 2006, p. 75.