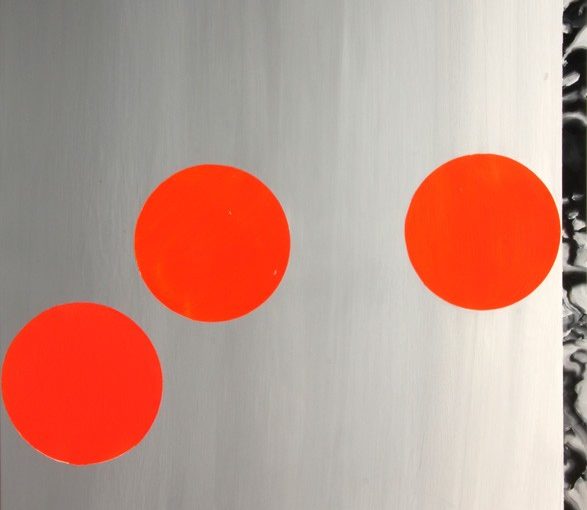Natalia S. AVTONOMOVA, « Déconstruction et traduction : sur la réception de Derrida en Russie » , traduit du russe par G. Fondu, Traduire Derrida aujourd’hui, revue ITER Nº2, 2020.
___________________________
Natalia S. Avtonomova travaille à l’Institut de philosophie de l’Académie de sciences de Russie, à Moscou.
Il faut saluer l’initiative de la revue ITER : organiser un échange d’expériences entre les traducteurs de Derrida des différents pays. Au cours de mon travail de traduction de De la grammatologie – qui dura quelques années[1] – j’ai souvent regretté ne pouvoir être épaulée par mes camarades, les traducteurs de Derrida dans d’autres langues, de ne pas savoir à quelles difficultés ils faisaient face, comment ils en venaient à bout, s’ils parlaient de tout cela à leurs lecteurs, etc. Chaque sphère culturelle et linguistique réserve un accueil spécifique aux textes de Derrida, selon son expérience historique, conceptuelle et de traduction. Il faut en outre prendre en compte les potentiels décalages temporels entre l’époque de la rédaction des textes originaux et l’époque de leur réception dans une autre culture. Par exemple, entre l’époque de la rédaction de la célèbre triade publiée par Derrida en 1967[2] et leur publication en russe, trente ans, à peu près, se sont écoulés[3]. Sans une étude des différences entre ces lieux et ces époques, les malentendus, voire les aberrations sont inévitables.
Or, dans le cas de la réception de Derrida en Russie – et plus généralement de tous les philosophes occidentaux contemporains –, les décalages sont particulièrement importants et complexes. J’ai déjà eu l’occasion de dire qu’à l’époque soviétique, pendant des décennies, la philosophie occidentale contemporaine, à de rares exceptions près, était tout simplement absente de la sphère du travail intellectuel : les textes n’étaient pratiquement pas traduits et n’étaient discutés que par les rares spécialistes qui s’occupaient de la « critique de la philosophie bourgeoise contemporaine » (et qui avaient souvent plus de tendresse pour leur objet que ne le laisse penser l’intitulé de leur spécialité) ; la rupture, positive, d’avec cette situation de déficit intellectuel qui impacta la traduction n’arriva qu’au début de l’ère post-soviétique[4]. Dans les années 1990, un flot de traductions, sans aucun souci de logique ou de chronologie, déferla sur la scène intellectuelle et engendra un chaos qui laissa les lecteurs tout à fait désorientés. À cette époque, lorsque les passerelles menant à la philosophie occidentale contemporaine s’ouvrirent, l’expérience de la philosophie française contemporaine connut un sort tout particulier. Manifestement, pour toute une série de raisons, la philosophie française contemporaine des années 1960-1980 répondait davantage que d’autres philosophies européennes aux besoins du lectorat russe de cette époque de transition – avec sa nouvelle langue, émancipée, avec son style brillant, elle engendra des réactions esthétiques tout aussi brillantes, basées sur le mimétisme, le jeu et la plongée dans des expérimentations littéraires qui se faisaient parfois au détriment du travail de la pensée. Mais ici, les processus « postmodernistes » se firent jour dans un espace social non dénué de traits « protomodernes », et la lassitude française à l’égard de l’académisme rigide, qui avait disposé les philosophes français aux expérimentations formelles, fut transposée dans un contexte culturel où la formation d’une communauté philosophique professionnelle avait été longtemps entravée par le règne imposé d’un marxisme dogmatique.
Dans un premier temps, Derrida, qui fut peut-être le représentant le plus brillant de la pensée française contemporaine, entra sur la scène intellectuelle russe en compagnie de Foucault, Deleuze, Lacan, Lyotard et – un peu plus tard – de Badiou, Rancière, etc., . Malgré cela, on ne peut pas dire que la réception russe de Derrida fût globalement favorable. Lors de la première apparition de Derrida dans l’espace culturel russe, son nom fut associé à celui d’une figure « pop » brillante, morcelée en « slogans » et offrant le prétexte à toutes sortes de jeux de mots (les sonorités de son nom n’y étaient pas pour rien) et de tchastouchki[5], qui le transformèrent finalement en « marque », sans qu’on ait une idée très claire de la marchandise qu’il y avait sous cette marque, selon l’expression d’un critique. Ni Foucault ni Deleuze n’eurent droit à une telle réception « pop », si massive et si étincelante. Encore au milieu des années 2000, après le décès de Derrida, les sites internet qui lui étaient dédiés témoignaient par exemple du fait que le terme « déconstruction » – qui réfère à une procédure analytique déterminée – était perçu avant tout sur un plan émotionnel. On peut synthétiser les autres exemples qu’offrait le net par les deux phrases suivantes, elles-mêmes tirées d’internet : « c’est le chaos et la déconstruction qui arrivent, en langage simple : le mal » et « ‘déconstruction’ ne se traduit pas en russe ». Alors qui est Derrida ? Une star populaire ou un savant sérieux ? Qu’est-ce qu’il achève ? Qu’est-ce qu’il inaugure ? Qu’est-ce qu’il défend ? Qu’est-ce qu’il renverse ?
La première apparition de Derrida sur le sol russe fut la traduction d’Éperons : les styles de Nietzsche[6], texte difficile et expérimental, à un moment où ses textes classiques plus anciens n’existaient pas pour le lecteur russe puisqu’ils ne parurent que plus tard. Cela produisit une polarisation des réactions émotionnelles – l’agacement ou l’adoration – et un affrontement passionné peu propice au travail conceptuel. Ainsi, la réception de Derrida ne fut pas soutenue par des communautés ou des groupes, comme ce fut le cas de la psychanalyse lacanienne ou de la philosophie de Foucault, des historiens en assurant la réception malgré les désaccords quant aux concepts employés ou l’interprétation des données empiriques. Deleuze fut sans doute durant une bonne dizaine d’années, et il le reste en partie, le « plus aimé » des philosophes français contemporains, peut-être parce qu’il y a chez lui quelque chose de « romantique » et de suggestif, de fascinant et d’« attirant » ; malgré la communauté apparente de certains de ses concepts avec ceux de Derrida, ce dernier maintient toujours avec son lecteur une certaine mise à distance culturelle et critique.
Cette fracture culturelle et idéologique engendre nécessairement la question suivante : comment traduire Derrida ? Comment l’introduire dans la culture russe ? Comment traduire en général ? Je considère que l’issue à la situation de crise générée par l’afflux excessif de nouveaux contenus et le déficit de moyens conceptuels pour les saisir et les élaborer est à chercher dans un travail de traduction qui tente d’en finir avec la spontanéité incontrôlée et de mettre au point une tactique et une stratégie sémantique. Dans ce cadre, je prends pour point de départ une sorte de contre-hypothèse Sapir-Whorf : certes, la langue nous façonne mais nous pouvons aussi, dans une certaine mesure, façonner notre langue, du moins à certaines périodes de son développement lorsqu’elle ne parvient plus à faire face à la pression de nouveaux contenus qu’il est nécessaire d’articuler. La traduction de la philosophie occidentale est d’une grande aide dans ce projet. C’est pourquoi l’une des tâches intellectuelles les plus importantes de l’époque post-soviétique m’a semblé être de façonner – notamment dans et par un processus de traduction – une langue philosophique russe, de créer une terminologie russophone là où elle n’existait pas ou alors avait existé à l’état d’ébauche, certes féconde (comme cela avait été le cas avec la psychanalyse et la phénoménologie dans les premières décennies du xxe siècle), mais néanmoins rejetée de la sphère du travail intellectuel et pratique en même temps que ses objets[7]. Tous les traducteurs ne seront pas d’accord quant à l’importance de cette tâche : pour certains, lorsqu’on traduit des textes étrangers, il est plus important de donner libre cours à son intuition ou de se prêter à de subtils jeux de mots que de faire preuve de réflexivité. Ainsi, certains de mes collègues préfèrent, lorsqu’ils traduisent Derrida, mettre en œuvre ou bien des stratégies ludiques, mimétiques et « non sérieuses » (ainsi de D. Kraletchkine dans sa traduction et son commentaire de L’Écriture et la différence[8]), ou bien, pour employer un vocabulaire technique, un type intuitiviste de traduction (ainsi de V. Bibikhine dans sa traduction des Positions[9] : il traduit les termes à l’instinct, selon la situation, et même les concepts fondamentaux sont rendus de diverses manières, sans que le lecteur puisse les identifier). C’est pourquoi, dans cette situation, j’ai pensé qu’il était indispensable de mettre en avant le facteur conscient, « anti-intuitiviste » du processus de traduction. Comment ai-je procédé concrètement ?
Même s’il ne s’agit pas, bien entendu, de dire que l’intuition est absente, ou peu importante, dans le travail de traduction, j’ai adopté une position qui a exigé de moi une réflexion argumentée sur les termes que j’ai choisis ainsi que leur explicitation pour les lecteurs. Dans ma traduction de De la grammatologie (j’ai déjà traité de cela dans des textes parus en français[10] mais je ne peux pas ne pas le rappeler ici), j’ai ainsi sélectionné une vingtaine de termes fondamentaux que je me suis efforcée de maintenir tout au long du livre tout en expliquant, dans ma préface, les raisons historiques, théoriques et linguistiques de mes choix de traduction. Je mentionnerai ici simplement quelques-uns de ces concepts : « écriture » (pismo) ; « différence », « différAnce » (razlitchié, razlitchAnié) ; « espacement » (razbivka) ; « présence » (nalitchié) ; « supplément, supplémentarité » (vospolnenié, vospolnitelnost’), etc. Dans chacun des cas, il a fallu étudier les autres variantes possibles et, en les comparant, expliquer les critères historiques, culturels et linguistiques qui ont présidé à mes choix : traduire, par exemple, « pis’mo » (et non « pismennost’ »), « razbivka » (et non « spatsializatsïia »), « vospolnenié » (et non « pribavka », « prilojenié » ou tout simplement « soupplement », en translittération russe ou même latine), etc. Aujourd’hui, on me demande parfois si et comment les traductions que j’ai proposées sont entrées dans la langue russe ou du moins dans le discours sur Derrida, ou si elles sont demeurées des inventions ponctuelles. Pour autant que je puisse en juger, un accord progressif s’est dessiné autour de certains termes. Il me semble que le terme « différAnce » est désormais majoritairement traduit par « razlitchAnié », ce que j’avais proposé (même si on trouve parfois « razlitchenié »), alors que je ne connais pas de cas où il soit traduit, comme chez Bibikhine, par « raznost’-raznesenié » (de même que par « ottiajka », « ottiaguivanié » ou tout simplement par la translittération « differans »[11]) ou bien, comme chez Zenkine, par « otlitchié » ou « otlitchenié ». Par ailleurs, le débat que nous avons eu, lui et moi, sur la manière dont il fallait traduire Derrida a suscité un vif intérêt chez de nombreux lecteurs[12].
Dans les dernières décennies, le travail de traduction des principaux travaux de Derrida s’est poursuivi en Russie : on a publié des traductions de La Dissémination, de Spectres de Marx, Marx & sons et de Marges de la philosophie[13]. Parmi les publications de plus petite échelle, je mentionnerai les traductions d’Apprendre à vivre enfin[14], La Bête et le souverain[15] et de fragments de Voyous[16]. On peine pour le moment en Russie à traduire les volumes des « Séminaires » de Derrida mais les discussions de Derrida avec Élisabeth Roudinesco[17] ont paru récemment, ainsi que la remarquable biographie de Derrida écrite par Benoît Peeters[18]. Il y a très peu de livres consacrés à Derrida en Russie et c’est là un contraste énorme avec la véritable « industrie » éditoriale Derrida qui existe aux États-Unis. Des quelques livres parus en Russie au xxie siècle, je mentionnerai surtout le livre du philosophe et psychanalyste Victor Mazine sur la spécificité de l’idée de sujet chez Freud et chez Derrida[19], le livre du philosophe Denis Goloborod’ko sur les conceptions foucaldiennes et derridéennes de la raison[20], et les passages consacrés à la réception et aux traductions de Derrida dans mon propre ouvrage Poznanie i perevod. Opyty filosofii ïazyka [Connaissance et traduction. Expériences de philosophie de la langue] (2008 ; 2016)[21]. Une tendance relativement nouvelle mérite également notre attention, celle qui consiste à confronter Derrida à la culture russe et soviétique et à faire usage de ses concepts pour mieux comprendre ce qu’est l’expérience spirituelle russe et soviétique. Ainsi, Elena Gourko a entrepris de lier certains motifs de la philosophie de la langue de Derrida aux traditions onomatodoxique et symboliste russes[22]. Dans ce cadre, le terme « différAnce » n’est tout simplement pas traduit : l’auteure l’écrit en français et le traite comme un élément d’une langue sacramentelle. V. G. Arslanov, quant à lui, relie l’expérience cognitive de Derrida à certaines tendances de la culture et de l’art soviétiques[23] : par opposition à Derrida, pour qui le monde est clivé par des oppositions qu’il est impossible ni d’accepter ni de synthétiser, il défend la possibilité d’une issue à cette situation. Elle se trouve dans le croisement des différentes traditions culturelles et représente l’alternative proprement russe au postmodernisme. Ces deux lignes visant à connecter Derrida et la culture russe ou soviétique peuvent tout à fait être poursuivies. On peut supposer que les tendances fondamentales, à l’avenir, consisteront à essayer d’appliquer les idées et les pratiques de Derrida aux arts visuels, à l’éthique, à la pensée politique et, bien entendu, à toute la sphère de discussions concernant Marx et le marxisme, qui s’élargit peu à peu.
Une autre voie me semble prometteuse, celle de l’analyse épistémologique des textes de Derrida[24]. En particulier, il serait intéressant de s’en servir pour étudier les objets des sciences humaines, dont le statut gnoséologique est inhabituel et pour lesquels on manque de procédures permettant de les fixer et de les décrire. Parallèlement à cela, on étudiera sans doute la place de Derrida dans l’histoire de la philosophie, notamment la place spécifique qu’il occupe dans la tradition phénoménologique ainsi que l’histoire de ses polémiques avec les représentants d’autres courants. Cela étant, je pense que l’analyse en termes d’histoire de la philosophie exige qu’on lise Derrida dans le texte, alors qu’en Russie, comme dans certains autres pays, on le lit – du fait de l’absence de telle ou telle traduction – en anglais, c’est-à-dire dans une tout autre structure idiomatique.
Ces dernières décennies, on a pu observer une certaine diminution du degré d’émotivité lié à Derrida, et donc un ton plus mesuré dans les discussions. Peut-être cela est-il lié notamment au fait que les passions de la période d’accumulation primitive des valeurs de la philosophie occidentale se sont un peu apaisées, et avec elles les querelles entre ceux qui souhaitaient prendre la tête du mouvement. J’ai, en ce qui me concerne, deux points de repère pour juger de cela : les réceptions de deux de mes travaux, écrits à une décennie d’intervalle. Ainsi, mon dernier grand ouvrage sur Derrida – Filosofskiï ïazyk Jaka Derrida[25] [La langue philosophique de Jacques Derrida] – a donné lieu à des recensions bien plus amicales et apaisées que cela n’avait été le cas, au tournant du siècle, pour ma très longue introduction à De la grammatologie. Les discussions du livre, par exemple à la librairie de Moscou « Kentavr » [Le Centaure], furent en général bienveillantes et même des adversaires endurcis de Derrida et des « postmodernismes en tous genres » ont dit qu’après avoir lu mon livre, ils allaient désormais lire Derrida lui-même. Inversement, les cent pages de mon introduction à De la Grammatologie, dans lesquelles j’essayais d’expliciter et de corriger les décalages historiques, culturels et conceptuels liés à la réception russe de Derrida (cf. supra), avaient perturbé certains critiques par leur pesanteur archaïque tout « soviétique » et leur style peu en adéquation avec les expérimentations conceptuelles de Derrida.
Il est vrai que cette comparaison n’est pas très robuste, dans la mesure où l’esthétique conceptuelle de mes deux textes sur Derrida est tout à fait différente. J’ai écrit la préface à De la grammatologie (dans une lettre, Derrida m’écrivit que Marguerite lui avait lu des fragments de ma préface) de manière tout à fait objective et indifférente, comme si je n’avais jamais rencontré l’auteur ni discuté avec lui et le jugeais simplement d’après ses textes (c’est là, selon Derrida, la démarche spécifique que lui-même adopte envers Rousseau dans De la grammatologie). En revanche, dans Filosofskiï ïazyk Jaka Derrida, j’ai partagé avec les lecteurs quelques moments d’amitié, quelques événements qui me sont chers et pas seulement les résultats de mes recherches. Le premier de ces événements, ce fut lorsque je reçus de Derrida, en 1979, des livres qu’il m’envoya à Moscou (auparavant, je ne pouvais lire ses ouvrages qu’en bibliothèque) ; et le dernier, la séance consacrée aux vingt ans du Collège International de Philosophie, à Paris, au cours de laquelle, sur proposition de Derrida, j’intervins en qualité de modératrice du dialogue entre Derrida et Jean-Luc Nancy ainsi que dans la discussion qu’il eut avec la salle[26]. C’était l’époque où Derrida était déjà très malade.
J’espère avoir réussi, dans mon livre, à mettre le doigt sur le nerf existentiel des conceptions de Derrida, qui constitue son fil rouge sémantique et traverse l’intégralité de son œuvre, sous les formes les plus diverses. Cette question de la langue est à la fois théorique et existentielle : elle est devenue la question principale de sa vie et de sa philosophie. Derrida disait : la langue dans laquelle je vis et que je cultive n’est pas mienne. Le projet de déconstruction est une manière de laisser une trace dans la langue française, adorée mais « étrangère » ; c’est la forme conceptuelle de la résolution d’une épreuve existentielle. Au sein de ce programme, il y eut différentes étapes, et le dispositif s’est modifié plusieurs fois. Le jeune Derrida déconstructionniste et en même temps plus académique, en tout cas dans ses travaux des années 1960, est plus tranchant et catégorique dans les différentes formulations de son programme de lutte contre la métaphysique d’Europe occidentale. Mais avec le temps, en élargissant la déconstruction à d’autres domaines, notamment l’éthique, il inclina de plus en plus vers l’aspect positif, « affirmatif » de la déconstruction ; et dans ses élaborations plus tardives, celles consacrées en particulier à la problématique politico-juridique, il interprète déjà la déconstruction comme la condition positive d’une compréhension des rapports, des actes, des phénomènes et des conditions humaines (en particulier l’hospitalité, la justice, le don, etc.).
Au cours de ces différentes transformations, la question de la langue est demeurée cruciale et, avec elle, la question de la traduction. La possibilité et l’impossibilité de la traduction sont sans doute l’un des exemples les plus frappants d’aporie sans laquelle la pensée humaine, selon Derrida, ne vit pas : l’épreuve des apories constitue le fondement de tout ce qui arrive à l’homme, de toutes les décisions qu’il prend, de toutes les responsabilités dont il se charge. Et ces apories nous conduisent à la nécessité de repenser non seulement l’histoire de la métaphysique européenne mais également les conditions fondamentales de la conceptualité en tant que telle, la pensée conceptuelle elle-même, sur la base de laquelle, d’une manière ou d’une autre, sont nées et se sont développées la science et la culture européennes. L’une des principales apories de l’appareil conceptuel de Derrida, c’est l’aporie de la traduction en tant qu’elle est à la fois « nécessaire et impossible[27] ». La traduction est omniprésente puisque personne ne vit dans une seule langue. Et c’est aussi le cas pour la philosophie : elle est polyglotte et elle est en même temps traductrice, puisque tous les textes philosophiques sont entrelacés d’autres textes. Dans les langues, il n’y a pas de « propriété », rien n’est jamais accaparé par un seul.
C’est pourquoi le thème de mon livre Filosofskiï ïazyk Jaka Derrida [La langue philosophique de Jacques Derrida] n’est pas un hasard. On peut considérer la philosophie de Derrida comme l’un des phénomènes les plus frappants de la tendance au tournant langagier de la deuxième moitié du xxe siècle. On sait depuis longtemps déjà que la philosophie n’existe pas seulement au niveau des idées mais également au niveau de la lettre. C’est une idée familière, en particulier, aux philosophes enclins à travailler sur le signifiant, lorsque, au cours de leur travail, les mots interviennent non pas comme les appuis des concepts mais plutôt comme des obstacles contre lesquels ils se heurtent ou des pièges dans lesquels ils tombent. C’est mon expérience philologique qui m’a poussée à travailler sur la langue philosophique de Derrida, et en particulier au repérage, puis à l’analyse des registres lexico-sémantiques et lexico-syntaxiques de sa langue conceptuelle[28] : cela était nécessaire pour comprendre le fonctionnement de son « système » langagier singulier et les moyens par lesquels il détruit toute systématicité intellectuelle tout en en façonnant une nouvelle, la sienne. Je considère ce travail comme une première étape vers un futur dictionnaire de la langue conceptuelle de Derrida, qui devrait, dans l’idéal, prendre en considération l’expérience de sa traduction dans différentes langues. Bien que le processus de signification soit pratiquement infini et « glissant » chez Derrida, il demeure impossible de saisir le sens de ses concepts si l’on passe à côté de l’analyse des moyens linguistiques qu’il emploie, qu’il s’agisse des termes habituels ou des divers néologismes auxquels il a recours. Pourtant, parmi mes collègues, il y en a peu qui s’intéressent au détail de la langue de Derrida : cela est peut-être dû à la thèse, largement répandue dans les cercles intellectuels russes, du caractère « fasciste » de la langue, empruntée à Barthes, et à l’exhortation, qui va de pair avec elle, à « lutter contre la langue » ou à l’ignorer tout simplement. Pour autant que je puisse en juger, le travail derridien sur la langue, parfois pesant et parfois virtuose, n’est jamais complètement délié du processus d’engendrement et de métamorphose de la pensée, et c’est là sa qualité inestimable.
Comme on le sait, Derrida a fait preuve de beaucoup d’attention, et même d’une certaine piété, pour le travail des traducteurs, en considérant qu’ils étaient « les seuls qui sachent lire et écrire ». Cependant, lors d’une discussion, il me dit une fois qu’il craignait les traducteurs, car ils passent leur temps à relire les textes alors que lui aimerait les modifier, les reprendre, les amender. Mais il était lui-même un traducteur des plus minutieux, de même qu’un théoricien de la traduction. On se rappellera que Derrida, en plein milieu d’une discussion complexe – que ce soit dans ses conférences ou dans ses livres – prend souvent la peine d’ouvrir plusieurs dictionnaires, et de comparer plusieurs traductions de textes philosophiques, de Platon à Heidegger, et se met alors à expliquer qui traduit comment, et pour quelles raisons, tel ou tel passage difficile. Qu’on le comprenne bien ; il ne vérifiait et ne revérifiait pas simplement pour lui-même mais forçait également son lecteur à réfléchir, le contraignant à avoir le souci de la langue et de la précision dans l’expression de la pensée.
En ce qui me concerne, quoique je ne sois pas derridienne et n’utilise pas ses concepts dans mes propres travaux, Derrida est pour moi le plus actuel de tous les penseurs contemporains parce qu’il articule comme personne l’expérience cruciale et douloureuse de la non-identité à soi, c’est-à-dire l’épreuve et la prise en charge des apories en tant que conditions du « sur-vivre ». Je regrette que le tableau de sa réception russe demeure si lacunaire. Pour ce qui est des matériaux pédagogiques concernant sa réception, il me semble, de manière générale, qu’on peut et qu’on doit écrire sur Derrida de différentes manières, et pour des auditoires différents ; pour le faire découvrir au « profane », de petits ouvrages illustrés peuvent s’avérer utiles. Pour aller un peu plus loin, on a besoin de livres destinés à un lectorat large. Quant aux « spécialistes », ils débattront toujours de la bonne manière d’écrire sur Derrida et de la nécessité d’écrire sur Derrida comme lui-même écrivait ou si le temps est venu d’écrire sur lui comme sur n’importe quel autre « classique[29] ». Dans les dernières décennies, il me semble que, sur internet, les émotions ont laissé place à des informations plus utiles. Pour ce qui est du Derrida pop, on publie sur « Wikiquote » toute une série de citations authentiques (quoique parfois apocryphes) de Derrida ; sur les forums ainsi que sur certains sites, on peut voir différentes interventions publiques consacrées à tel ou tel aspect des conceptions de Derrida (les conférences de V. Mazine, d’A. Markov, etc.) ; le service public encyclopédique de Russie met à disposition des utilisateurs quinze définitions de la déconstruction empruntées aux travaux d’auteurs connus ayant écrit sur Derrida, parmi lesquels N. B. Man’kovskaïa, T. K. Kerimov, A. A. Gornykh, M. Maïatski, l’auteure de ces lignes, etc. (https://terme.ru/termin/dekonstrukcija.html) ; le site http://derrida.sitecity.ru/ propose, pour mieux s’orienter, la liste des traducteurs de Derrida ainsi qu’un index de leurs traductions (il s’agit d’Alexeï Garadja, d’Elena Gourko, de Dmitri Kraletchkine, de Victor Lapitski, de Dmitri Ol’chanski, de Mikhaïl Rykline, de Nikolaï Souslov, de Sergueï Fokine, de Natalia Chmatko, etc.)
Pour ce qui est des discussions, il y en a peu. Bien moins que ce qui serait souhaitable. L’une des plus intéressantes concernant la réception de Derrida en Russie demeure la table ronde « Nach Derrida ? » [Notre Derrida ?] (avec le point d’interrogation), organisée par le sociologue A. Magun dans la revue Novoié literatournoié obozrenié [Nouvelle revue littéraire][30]. Il s’agit à l’origine d’un hommage au défunt, qui fut marqué par l’émotion de la perte et des adieux. Cela étant, les positions et avis exprimés lors de la séance conservent leur actualité pour la situation contemporaine. Un groupe de jeunes chercheurs en sciences sociales, parmi lesquels on comptait des philosophes, des sociologues et des historiens (Alexandre Dmitriev, Artiom Magun, Alexandre Skidane, Ilia Koukouline, Denis Goloborodko, Keti Tchoukhrov, etc.) engagèrent un débat sur l’héritage derridien dans le contexte de la pensée russe. Quelle est l’importance de Derrida pour le lecteur russe ? Il a renouvelé « l’horizon théorique », il a « modifié la perspective du savoir contemporain sur l’homme et la culture ». En même temps, les participants à la discussion reconnaissaient que Derrida reste comme absent, et n’est « pas lu ». Pourquoi ? Chacun l’interprète différemment : serait-ce parce qu’aucun accord n’a encore émergé parmi les traducteurs ? Parce qu’on a sottement vu chez lui un « apôtre du relativisme total, qu’on trouve cela positif ou négatif[31] » ? Parce qu’« en Russie la déconstruction de la métaphysique est pratiquement impossible puisque la reconstruction de la métaphysique n’a pas encore eu lieu et qu’on ne sait pas quand elle aura lieu » (Tchoukhrov réfère ici à l’avis de M. Rykline) ?, etc. L’opinion a également été émise que les philosophes et autres chercheurs en sciences humaines considèrent parfois avec méfiance et circonspection sa critique de la métaphysique et des fondements métaphysiques des sciences humaines, car elle compromettrait les fondements de leur discipline. De manière générale, on peut dire que les participants de la discussion étaient prêts à prendre sur eux la responsabilité de la réception à venir de Derrida. C’est désormais leur affaire, leur mission, puisque le bilan de leurs prédécesseurs est si mitigé. Cependant, depuis cette époque, du temps a passé et désormais, en cette fin de la deuxième décennie du xxie siècle, on pourrait demander à ces « jeunes gens » qui sont maintenant « adultes » le bilan qu’ils sont prêts à nous présenter. On ne recevrait sans doute pas de réponse concluante.
Le travail de Derrida, tel que je me le représente, consiste en l’approbation risquée de nouvelles formes d’existence de la philosophie dans toute la multiplicité de ses découvertes langagières. Il a montré, comme aucun autre philosophe, sur la base d’un énorme matériau culturel, tout ce que signifiait la matière langagière et, par conséquent, la traduction pour l’édification de la pensée philosophique. Ainsi, dans l’un de ses derniers livres, on trouve une phrase importante sur le rôle de la traduction pour sauver l’honneur de la raison en Europe et dans le monde. Voici un petit fragment de cette phrase complexe dont l’interprétation mériterait un article entier : l’expérience de la traduction, dit Derrida « prend en charge tout le destin de la raison, c’est-à-dire de l’universalité mondiale à venir […][32] ». Il est question ici du Bassin méditerranéen et du latin, de son « expérience de la traduction », mais ce qui est dit ici vaut pour toutes les régions. L’opiniâtreté du travail de traduction, pour lequel « l’intraductibilité » signifie avant tout la nécessité de traduire et de retraduire encore, permet d’espérer que, malgré toutes les catastrophes, les rapports entre les hommes, les cultures et les philosophies puissent encore être l’occasion de nombre d’événements nouveaux, inattendus et enrichissants. Mais il importe de ne pas oublier que « l’expérience de la traduction » dans son interprétation derridienne – comme aporétique, à la fois « nécessaire et impossible » – demeure l’une des principales conditions de la réalisation du « destin de la raison » dans la vie humaine, et que le traducteur, « fidèle dans son infidélité », est un compagnon, un interlocuteur et un passeur dans ce travail culturel.
___________________________
[1] Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с франц. и вст. ст. Н.С.Автономовой М.: Ad Marginem, 2000.
[2] Derrida, J., De la grammatologie. Paris, Minuit, 1967 ; Derrida, J., L’Écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967 ; La Voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967.
[3] Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с франц. под ред. В.Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000 ; То же / Пер. с франц. Д. Кралечкина. М.: Академический проект, 2000 ; Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля / Пер. с франц. С.Г.Кашиной, Н.В.Суслова. СПб.: Алетейя, 1999.
[4] Avtonomova N., « Derrida en russe », Revue philosophique de la France et de l’étranger, Paris, 2002, n°1, p . 85-92. Cet article a été réédité, avec quelques modifications, dans le volume des Cahiers de l’Herne consacré à Derrida : Avtonomova N., « Paradoxes de la réception de Derrida en Russie (remarques du traducteur) », Cahiers de L’Herne, (Spécial) Derrida, 2004. Cf. également Avtonomova N., « Traduction et création d’une langue conceptuelle russe », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2005, n°4, p. 547-555.
[5] [NdT] Les tchastouchki sont de petits poèmes satiriques, parfois chantés, très souvent vulgaires.
[6] Деррида Ж. Шпоры. Стили Ницше / Пер. А. Гараджи // Философские науки. 1991. № 3-4.
[7] J’avais intitulé mon programme de recherche au Collège International de Philosophie (Paris, 1998-2004) : « La langue russe à l’épreuve de la pensée contemporaine occidentale ».
[8] Je remarque avec plaisir que depuis cette époque, Dmitri Kraletchkine a fait du chemin et réalisé des traductions sérieuses et de haut niveau scientifique de La Dissémination (2007) et des Marges de la philosophie (2012).
[9] Деррида Ж. Позиции / Пер. В. Бибихина. 2 изд. М.: Академический проект, 2007 (1 изд: Киев, 1996).
[10] Cf. notamment Avtonomova N., « Derrida en russe », Revue philosophique de la France et de l’étranger, Paris, 2002, n°1, p .85-92.
[11] Деррида Ж. Позиции / Пер. В. Бибихина. 2007, p. 16 sqq.
[12] « Как переводить Деррида? Философско-филологический спор » [Comment traduire Derrida ? Débat philosophico-philologique] (avec la participation de S. N. Zenkine et de N. S. Avtonomova) // Вопросы философии. 2001. № 7. С. 158-169. Cf. notamment dans le volume: Зенкин С.Н. « Наличие и отличие » [Présence et altérité], p. 158-163 et Автономова Н.С. « Приставка как философская категория » [Le préfixe comme catégorie philosophique], p. 163-169).
[13] Деррида Ж. Призраки Маркса / Пер. с франц. Б.Скуратова под ред. Новикова. М.: Logos-altera, Ecce homo, 2006 ; Деррида Ж. Маркс и сыновья / Пер. с франц. Д. Новикова. М.:Logos-altera, Ecce homo, 2006 ; Деррида Ж. Диссеминация / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007 ; Деррида Ж. Поля – философии / Пер. с франц. Д.Ю.Кралечкина. М.: Академический проект, 2012.
[14] Деррида Ж. Наконец-то научиться жить. Беседа c Ж. Бирнбомом / Пер. с франц. прим. и послесл. Н.Автономовой // Вопросы философии. 2005. n°4, p. 133-144. Cette traduction a été publiée en annexe de ma nécrologie de Derrida.
[15] Деррида Ж. Тварь и суверен / Пер. с франц. А. Гараджи // Синий диван. Философско-теоретический журнал. М.: Три квадрата. 2008, n°12, 13 et 2010, n° 15.
[16] Деррида Ж. Разбойники / Пер. Д.Калугина под ред. А. Магуна // Новое литературное обозрение. 2005, № 72 (2). p. 31-60.
[17] Деррида Ж., Рудинеско Э. Чего завтра… Диалог / Пер. В. Б. Феркель. Челябинск: Цицеро. 2010.
[18] Петерс Б. Деррида / Пер. Кралечкина. М.: Издательский дом «Дело». J’ai eu l’occasion de participer à une table ronde consacrée à la publication de ce livre. On peut se faire une idée de l’intérêt de la discussion grâce à sa retranscription : https://syg.ma/@shaninka/dierrida-rasshifrovka-diskussii-i-priezientatsii-knighi-bienua-pietiersa .
[19] Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида [Le sujet de Freud et de Derrida]. СПб.: Алетейя, 2010.
[20] Голобородько Д. Концепции разума в современной французской философии: Фуко и Деррида [Conceptions de la raison dans la philosophie française contemporaine : Foucault et Derrida]. М.: ИФ РАН, 2011.
[21] Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка [Connaissance et traduction. Expériences de philosophie de la langue]. 2 изд. испр. и доп. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. С.152-221; 397-453. ( 1 изд. М.: РОССПЭН, 2008).
[22] Гурко Е. Божественная ономатология. Именование Бога в имяславии, символизме и деконструкции [L’Onomatologie divine. Le Nom de Dieu dans l’onomatodoxie, le symbolisme et la déconstruction]. Минск: Экономпресс, 2006.
[23] Арсланов В.Г. Постмодернизм и русский « третий путь » [Le Postmodernisme et la « troisième voie » russe]. М.: Культурная революция, 2007.
[24] Parmi les ouvrages dans lesquels on trouve des traces de cette lecture épistémologique, cf. Керимов Т.Х. Неразрешимости [L’Indécidabilité]. М.: Академический проект, 2007.
[25] Автономова Н. Философский язык Жака Деррида. М,: РОССПЭН, 2011. En annexe du livre, j’ai publié une traduction du chapitre sept de l’ouvrage de Derrida, Le monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996. Ce chapitre est en effet spécialement consacré à l’expérience que constituent la langue maternelle et les langues étrangères chez F. Rosenzweig, E. Levinas, H.Arendt et chez d’autres auteurs importants pour Derrida.
[26] On trouvera la trace écrite de tout cela dans : Coll., Les 20 ans du Collège international de philosophie, Rue Descartes, 45/46, 2004/3. Cf. notamment : Jacques Derrida & Jean-Luc Nancy, « Ouverture. Discussion avec la salle », p. 26-55.
[27] Derrida, J., « Des tours de Babel » in Derrida, J., Psyche. Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, р. 207-208.
[28] Cf. la troisième section de l’ouvrage, « Как возможна реконструкция деконструкции ? » [Comment peut-on reconstruire la déconstruction], ainsi que les matériaux rassemblés en vue d’un dictionnaire conceptuel de Derrida : Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. p. 320-433.
[29] Pour ce qui est des différentes traductions d’une seule et même œuvre, nous avons déjà une petite expérience en Russie. Ainsi, en 2000, sont parues coup sur coup deux traductions différentes de L’Écriture et la différence (cf. note 3 du présent article), ce qui s’explique manifestement par les règles fantasques concernant les droits d’auteur à l’ère post-soviétique. Je préfère, en ce qui me concerne, l’édition moscovite réalisée sous la direction de V. Lapitski. Pour une analyse comparée de la terminologie employée dans ces deux livres, je renvoie aux très belles recensions de V. Mazine et A. Ïampol’skaïa: Мазин В.А. Рец. на: «О грамматологии». «Письмо и различие» Жака Деррида»//Новая русская книга, №6 (7), 2001. p. 30-32 ; Анна Ямпольская. Свобода (от) вопроса. Рец. на: Жак Деррида. Письмо и различие. Перевод Д.Ю.Кралечкина. М.: «Академический проект» Москва 2000.
Cf. : :http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_5_6/16.htm. Cela fait malheureusement bien longtemps maintenant que je n’ai pas eu l’occasion de lire des analyses aussi brillantes des traductions de Derrida.
[30] Наш Деррида ? (Анализ рецепции и стратегии перечтения) [Notre Derrida ? (Analyse de la réception et stratégies de relecture] // Новое литературное обозрение. 2005. №72. p. 61-97. À la demande des organisateurs de la table ronde, j’ai rédigé une réponse à la discussion, publiée dans le même numéro de la revue : Автономова Н.С. «Урок письма» // Новое литературное обозрение. 2005. №72. p. 98-102.
[31] Cf. Автономова Н.С. « От языковых экспериментов к анализу апорийных ситуаций (о так называемом ’’постмодернистском релятивизме’’ в концепции Жака Деррида) » [Des expériences langagières à l’analyse des situations aporétiques (sur le prétendu ’’relativisme postmoderniste’’ des conceptions de Jacques Derrida] // Релятивизм как болезнь современной философии [Le relativisme comme maladie de la philosophie contemporaine]. М., 2015. С. 265–298.
[32] Derrida, J., Voyous, Deux essais sur la raison, Paris, Galilée, 2003, p. 168.