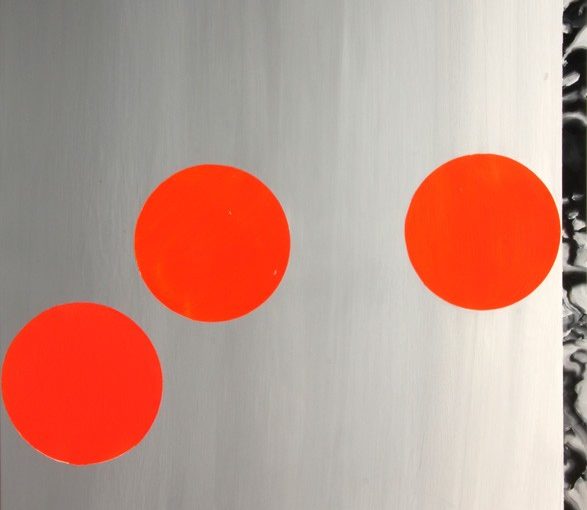Marta HERNANDEZ ALONSO, « Khôra sans foi ni loi », L’à venir de la religion, revue ITER Nº1, 2018.
___________________________
« Même dans un particularisme religieux, il faut ouvrir à l’inconnu, que cet inconnu entre et gêne. Il faut ouvrir la loi et la laisser ouverte pour que quelque chose entre et trouble le jeu habituel de la liberté. »
Marguerite Duras, La vie matérielle
Au-delà de toutes les catégories langagières permettant de la signifier et de la dire, le discours de Platon sur khôra[1] défie, selon Derrida, toutes les alternatives traditionnellement acquises, et confronte la pensée à l’impossibilité de nommer proprement l’archi-origine inconnue et rebelle à l’anamnèse dont elle hérite et porte la trace. « Radicalement anhumaine et athéologique »[2], « radicalement anhistorique »[3], khôra résiste à toute réappropriation ou réarticulation logique, ontologique ou généalogique, et se laisse seulement approcher par un raisonnement ou un discours sans père légitime et ouvert à l’hybridation et à la bâtardise[4]. Hanté par l’impropriété des mots et les apories du sens, le discours de Platon sur khôra n’obéirait pas au commandement de bien parler[5], c’est-à-dire de parler comme il faut ou, plus dévotement et en espagnol : de parler como Dios manda[6].
Or le religieux, avant qu’on puisse le déterminer comme appartenant à telle ou telle religion au sens restreint du mot, n’est-il pas déjà impliqué dans le parler même et davantage dans une certaine manière de parler qui se voudrait propre dans le double sens signalé par Derrida de la « propriété » et de la « propreté » ? Ainsi, dans Foi et Savoir[7], tout en mettant à mal la possibilité de définir, limiter et situer la religion dans un ici et maintenant, Derrida invite à penser la religion à partir de ses effets dans la langue : des effets du religieux qui, à travers la langue, reviendraient sans cesse en s’efforçant à reconstituer « la pureté intacte, l’intégrité saine et sauve, une propreté et une propriété non lésées »[8]. Le re– de la reconstitution, souligné par Derrida en italiques dans le texte, indiquant qu’il s’agit bien d’une répétition, d’un retour ou d’un recommencement potentiellement infinis et d’une certaine manière compulsifs, cherchant à réparer par la parole disciplinée et soumise – tout comme par le silence obéissant et docile devant la loi humaine ou divine – une irréparable faute ou un manquement originaire à la règle. Parole cherchant à détacher, sinon à nettoyer – parole messagère et, si l’on ose dire, ménagère divine – la trace d’une origine impure, hybride, bâtarde ou illégitime à l’égard tout aussi bien de la logique que de la généalogie du sens.
La question du sens propre et du propre en général n’est certainement pas accessoire dans l’analyse de la religion que Derrida propose dans Foi et savoir. Bien au contraire, elle s’y retrouve à plusieurs niveaux, dont celui qui délimite la religion comme « pulsion » ou « expérience » de l’indemne[9], c’est-à-dire du pur, de l’intact, du sain et sauf, du non contaminé, de « ce qui reste allergique à la contamination »[10], ou, encore, du propre. Dès le début du texte, la bonne trentaine de pages en « Italiques »[11] – typographie inclinée souvent utilisée, par opposition à la police romaine[12], pour indiquer, entre autres, le sens particulier qu’un auteur associe à un terme, ou pour souligner des mots ou expressions en langue étrangère – marquerait, d’entrée de jeu, qu’un discours sur le religieux qui ne se contenterait pas simplement de le reproduire machinalement, doit abandonner la prétention d’en parler proprement et droitement, comme s’il pouvait remonter à la source de la religion pour nous révéler l’essence ou la vérité universelle de la chose religieuse. D’où ces premières questions – une même question démultipliée – qui, au tout début de Foi et savoir[13], inaugurent le texte en interrogeant la religion non seulement comme objet de réflexion, thème ou problème, mais aussi – telle la toute première question – la religion comme langue. Comme si la religion était, avant tout, une manière de parler, de communiquer, d’identifier et de signifier les choses au sein de la communauté qui la parle : « Comment « parler religion » ? de la religion ? Singulièrement de la religion, aujourd’hui ? »[14].
Comme lorsqu’on parle français, anglais ou espagnol, savoir « parler religion » supposerait de connaître au moins la syntaxe, la grammaire et le sens des mots à travers lesquels la religion s’exprimerait, et parlerait des choses et d’elle-même. Par définition, la langue religieuse devrait pouvoir se distinguer d’une langue non religieuse, voire d’une langue qui, sans être forcément athée ou antireligieuse, se voudrait neutre à l’égard de la religion, pure de religiosité : laïque, si l’on peut dire. Rappelons l’étymologie grecque, et ensuite latine, du mot « laïque », qui signifie ce qui est du peuple ou appartient au peuple, et ensuite ce qui est commun – au peuple – et non privatif ou exclusif d’une fraction de la société ou d’un groupe d’élus. Par opposition aux laikoi, les klêrikoi, adjectif dérivé de klêros – d’où « clerc » – qui signifie le lot, seraient ceux qui forment le « bon lot »[15], ceux qui ont été choisis, élus, mis à part et à l’écart de la masse indifférenciée du peuple en général dont ils se distinguent, se détachent, se découpent et s’élèvent… A supposer, ce qui ne va pas de soi, qu’il y ait du peuple en général et que la production ou la constitution d’un peuple – d’un genos, d’un ethnos d’une race, souche ou nation – n’ait, elle aussi, rien à voir avec une communauté d’élus ou de privilégiés dont, commentant le Timée, Derrida nous dit dans Khôra que la sélection « ne va pas sans tirage au sort (kléros, 18 d-e) »[16]. Une autre manière de dire qu’il n’y a pas de commun ou de communauté qui n’implique, dans sa fondation même, une sélection quelque peu aléatoire ou contingente, qui ne ressortirait pas à la pure nécessité naturelle, logique ou historique, mais relèverait plutôt d’un certain axiome, à savoir que « la loi du meilleur se croise avec un certain hasard »[17].
Ainsi, le mot « privilège » pourrait souligner ce qui nous semble être l’une des déconstructions les plus importantes à l’œuvre dans Foi et savoir, et qui concerne l’opposition entre le propre et le commun. Comme Derrida le suggère à propos de la « mondialatinisation », il n’y a pas de communauté ni de commun qui ne soit fondée sur quelque loi privée[18] – particulière, limitée ou propre à un groupe restreint – dont la généralisation, sinon la mondialisation, suppose l’abstraction, voire même la dénégation, des conditions contextuelles toujours un peu aléatoires ou contingentes (des conditions plus matérielles que spirituelles ou formelles, si l’on s’en tient à l’opposition classique) dont toute communauté est issue. Tel serait le non-fondement du propre – sa maladie congénitale, si l’on peut dire – qui entraverait la justesse et entamerait la pureté que sa définition réclame. D’après Derrida, il n’y aurait pas de propriété (de bénéfice ou de droit, de monopole ou de pouvoir) qui ne logerait, dans sa constitution même et comme dans son for le plus intime, une impropriété d’origine faisant place au hasard, au coup de chance ou à l’aléa : à l’incalculable en fin de compte qui rend inépuisable l’analyse du contexte dans lequel un événement a lieu.
Car il se pourrait que la langue religieuse, bien au-delà de l’opposition entre le religieux et le laïque – le scientifique, le moderne ou l’antireligieux – soit celle qui, en vue de recréer ou de mimer quelque essentialité ou propriété communautaire, se voue à masquer les conditions dues au hasard dont même les meilleurs et les plus purs éléments d’une communauté sont aussi les héritiers. Et comment porter cet héritage impur, impropre et, à y regarder de plus près, difficilement idéalisable autrement qu’en le masquant, en le dissimulant ou en en faisant toujours abstraction ? Comme par exemple, le fait d’être né à tel endroit plutôt qu’à tel autre, à tel moment plutôt qu’à un autre ; le fait de se rendre ou pas à tel événement, de participer ou pas à telle rencontre, de se trouver ou pas à tel ou tel moment ou situation de l’histoire, avec tel corps, telle voix ou tel sexe… bref, des déterminations innombrables, pas toujours connues par celle ou celui qui les porte et impossibles à résorber, à ressaisir ou à attribuer à une seule Cause au nom de laquelle, en vue de laquelle, grâce à laquelle, suite à laquelle, tout le reste découlerait naturellement, historiquement ou logiquement comme d’une source limpide, propre et transparente à elle-même. En ce sens, tout discours voué à reconstituer « la pureté intacte », voire « l’intégrité saine et sauve », n’est-il pas, toujours déjà, religieux ? C’est en tout cas l’une des questions que pose Foi et savoir, où Derrida, sans céder un pouce sur la supériorité morale de la modernité occidentale, ne manque pas de signaler comment, face aux crimes les plus spectaculaires et les plus barbares des « intégrismes » religieux, « Les guerres ou les “interventions militaires” conduites par l’Occident judéo-chrétien au nom des meilleures causes (du droit international, de la démocratie, de la souveraineté des peuples, des nations ou des États, voire des impératifs humanitaires) », sont-elles aussi, de quelque manière, des « guerres de religion »[19]. Car la pulsion de l’indemne, quelles que soient les oppositions, la stratégie et la langue qu’elle emprunte selon l’occasion, pourrait-elle conduire à autre chose qu’à la guerre ? Le religieux étant inséparable du carno-phallogocentrisme et de ce que Derrida appelle ailleurs la « métaphysique du propre »[20], ledit « retour du religieux »[21] ne répondrait en somme qu’à la tentative inlassable, monotone, répétitive et toujours infructueuse, de retourner vers un point zéro de non-contamination où le hasard ne serait pris en compte que comme une extériorité accessoire et superflue à l’égard d’une essence présumée immuable.
Ce n’est donc pas par un simple souci de propriété ou d’érudition philosophique que tout au long de Foi et savoir Derrida insiste sur l’impossibilité de parler proprement de la religion. Il s’agit pour Derrida d’opérer à la limite du religieux, en inscrivant, dans le déroulement idéalement linéaire du discours, l’impossibilité radicale de la parole – impossibilité puisant à la racine même, à l’origine ou à la source du parler – à dire la cause qui la fait parler, la source dont elle dérive où l’origine dont elle est née. Au point que, s’il y a un lien – un fil conducteur ou un trait d’union – reliant ou assemblant, de quelque manière, la suite d’aphorismes de ce « court traité » sur la religion[22], ce serait justement le retour vers cette impossibilité de traiter la religion elle-même, voire de dévoiler ou de révéler religieusement le comme tel de la religion[23]. La « forme quasi-aphoristique » étant, selon Derrida, « la moins mauvaise machine à traiter de la religion »[24], en ceci qu’elle se placerait d’emblée dans l’impossibilité de dire le tout pour affirmer, ou contresigner, ce qui, à la limite du discours, et dans l’interruption même du savoir, provoque la pensée à tisser d’autres liens pour approcher l’étrangeté de la chose qu’il s’agit de penser.
Si religieuse est la parole qui révèle et commande le quoi et le comment de ce qu’il faut dire et de ce qu’il faut faire pour bien parler et se tenir droitement, une toute autre injonction, un tout autre devoir ou une toute autre pulsion que celle de l’indemne thématisée par Derrida dans Foi et savoir, dicterait, interpellerait ou pousserait Platon à sortir, fut-ce momentanément, des limites du discours vrai ou vraisemblable[25]. Et cela pour parler de khôra et témoigner ainsi, avec un « autre langage »[26] travaillé par des apories et des interruptions du sens, d’une dimension de la réalité ou de la vie dont la seule propriété consisterait à n’avoir rien en propre ni de propre et à rester ainsi – et à jamais, comme l’écrit Platon lui-même dans le Timée – informe ou sans forme (amorphon)[27] : « singulière impropriété »[28] qui, écrit Derrida au futur, « ne sera jamais entrée en religion et ne se laissera jamais sacraliser »[29].
Il n’y aura pas, il ne pourra pas y avoir de religion de khôra, qui serait toute divine ou tout le contraire. Associée par Platon à la « nécessité »[30] et à la « cause errante »[31], faut-il néanmoins rappeler que la tradition philosophique postérieure assimilera khôra, sans beaucoup de précautions à l’égard du texte de Platon, à la matière aristotélicienne. A une matière qui, opposée à l’intelligible – aux paradigmes idéaux, aux idées, voire à tout ce que la tradition philosophique identifiera ensuite à la Raison ou à l’Esprit – doit se laisser maîtriser, persuader, modeler, subordonner, signifier, relever « comme un espace vierge, homogène et négatif, laissant son dehors dehors, sans marque, sans opposition, sans détermination »[32]. Et bien que pour Derrida khôra ne soit pas la matière ni rien qu’on puisse ériger comme une différence plus fondamentale que les autres, autour de laquelle une religion serait toujours possible, il convient de souligner qu’à la fin de Spectres de Marx, Derrida propose justement de repenser le matérialisme à partir de khôra : un « matérialisme sans substance », dit-il, ou un « matérialisme de la khôra »[33], devant, au moins, nous rappeler que la construction et l’appartenance à telle ou telle communauté religieuse, nationale, sociale, politique, institutionnelle, sexuelle, intellectuelle, linguistique, etc., ne va pas sans hasard ou, comme l’écrit Derrida paraphrasant Platon, « ne vas pas sans tirage au sort ». Une autre manière de dire qu’il n’y a pas de lot ni de destin – de loti ni de destinée – sans cette décision de l’autre qu’on ne fera jamais la sienne, qu’on ne rendra jamais propre et dont on ne pourra jamais parler proprement ni rendre proprement raison : décision d’ «un tout autre sans visage»[34], d’un tout autre irréductible à une quelconque élection rationnelle ou divine qui, entrecoupant les liens qui nous relient à notre Cause (propre ou commune), ouvrent la loi du propre à la loterie de la vie comme à la plus inconcevable et à « la plus désertique des abstractions »[35].
Comment dès lors « parler religion » ? Ou, plutôt, comment ne pas parler religion ? Comment parler un peu moins religion ? Comment parler autrement que religion ?
___________________________
[1] Cf. Platon, « Timée », dans Œuvres complètes (Tome X), Paris, Les belles lettres, 2011, 47e-53b.
[2] Jacques Derrida, « Comment ne pas parler. Dénégations », dans Psychè. Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, p. 568.
[3] Ibid., p. 569.
[4] Jacques Derrida, Khôra, Paris, Galilée, 1993, pp. 92 et 94.
[5] Cf. Jacques Derrida, « Comment ne pas parler. Dénégations », dans Psychè. Inventions de l’autre,op.cit., pp. 560 et 567-568.
[6] En français, on dirait « comme il se doit », mais la traduction littérale serait « comme Dieu le commande ».
[7] Jacques Derrida, Foi et Savoir (suivi de Le Siècle et le Pardon), Éditions du Seuil, 2000.
[8] Ibid., p. 38, note 12.
[9] Ibid., pp. 38 et 42.
[10] Ibid., p. 42.
[11] Ibid., pp. 9-37.
[12] Cf. ibid., p. 13.
[13] Cf. Jacques Derrida, « Hors livre », dans La dissémination, Paris, Éditions du Seuil, 1972, pp. 9-76.
[14] Ibid., p. 9.
[15] Cf. Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1934. Alain Rey (dir.) Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1992. Alfred Ernout et Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris, Klincksieck, 2001.
[16] Jacques Derrida, Khôra, op.cit., p. 51.
[17] Ibid.
[18] De privus (privé, particulier) et lex (loi). Cf. Dictionnaire historique de la langue française, Tome 2, op.cit.
[19] Jacques Derrida, Foi et savoir, op.cit., p. 42.
[20] Par exemple, dans De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967, p. 40.
[21] Cf. Jacques Derrida, Foi et savoir, op.cit., pp. 10, 14, 65 et 69.
[22] Ibid., p. 10.
[23] Cf. ibid., pp. 42, 48-49, 56, 60 et 100.
[24] Ibid., p. 62.
[25] Cf. Jacques Derrida, Khôra, op.cit., pp. 68 et 76.
[26] Jacques Derrida, « Comment ne pas parler. Dénégations », dans Psychè. Inventions de l’autre, op.cit., p. 567.
[27] Platon, « Timée », dans Œuvres complètes, op.cit., 51a. Cf. Jacques Derrida, Khôra, op.cit., pp. 28 et 33.
[28] Jacques Derrida, Khôra, op. cit., p. 33.
[29] Jacques Derrida, Foi et savoir, op. cit., p. 34.
[30] Platon, «Timée », dans Œuvres complètes, op.cit., 47e-48a.
[31] Ibid., 48b.
[32] Jacques Derrida « Tympan », dans Marges de la philosophie, Paris, Éditions de Minuit, 1972, p. XXIV.
[33] Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993, p. 267.
[34] Jacques Derrida, Foi et savoir, op.cit., p. 35.
[35] Ibid., p. 9.
___________________________
Source photo : Benoît Géhanne, à commencer par eux, huile et acrylique sur aluminium, 65 x 55 cm, 2012