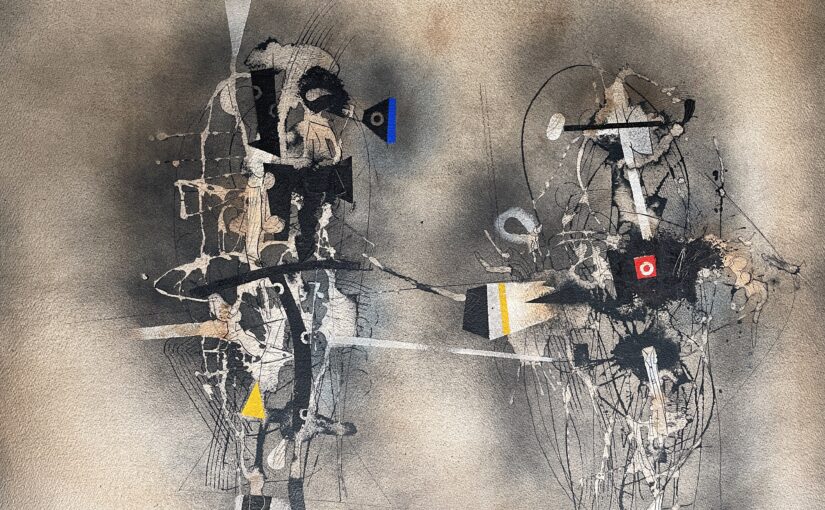Santiago CANEDA LOWRY, Glôture de la métaphysique IV : Comme si tout était entre guillemets, revue ITER Nº3, 2024.
Si l’ailleurs était ailleurs, ce ne serait pas un ailleurs.
D’ailleurs, Derrida
Comment peut-on encore penser et écrire, quand nous savons que les mots sont vieux, inexacts, violents, injustes, etc. ? Telle est la difficulté qui inspire mon texte.Chaque mot « présent », autrement dit, chaque mot qui est « là », dans le texte, est insuffisant. Il trahit cela même que nous tentons de dire ou de relever. C’est alors que nous avons recours aux guillemets (entre maints autres procédés, comme les ratures ou les mots cochés, les italiques, les avertissements aux lecteurs, etc.). Nous savons très bien qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’employer dans un texte philosophique, par exemple, le mot « présent » sans guillemets, sans ces petits gardiens qui sont, à la fois, une façon de dire « comme si » (« comme si c’était possible que quelque chose, n’importe quoi, soit présent, ici et maintenant »), et aussi une façon de marquer ou de pré-marquer le contexte dans lequel nous nous trouvons, en renvoyant ce mot à son propre contexte. Ce petit geste dans le texte, ces quatre marques qui flottent en l’air et veillent sur le mot, ce signe de la main, non seulement décramponne, comme dit Derrida, mais semble aussi citer un texte impossible, localisé ailleurs, dans une sorte de postérité métaphysique où son sens sera enfin libéré de tout ce qui nous oblige à entourer ce mot de guillemets.
Nous devrions tout écrire entre guillemets, déplacer complètement l’événement qui a lieu dans le texte, le rendre absolument indécidable. Ou bien accepter que tout ce qui a lieu dans le texte, chaque mot, chaque lettre, se trouve déjà entre guillemets, mais nous nous serions lassés de les mettre au fur et à mesure. Lire et penser à l’époque de la clôture consisterait, donc, à couvrir chaque mot de guillemets pour les (re-)dé-couvrir. Mais il y a tellement de mots que le travail serait interminable. Nous pourrions, par conséquent, choisir de commencer « quelque part où nous sommes »[1].
Pour autant, le mot qui est « présent » dans le texte, quel qu’il soit, n’y suffit pas. Dire cela n’implique aucune nouveauté, mais nous persévérons dans ce désir, celui de dire des choses originales, voire révolutionnaires, avec des mots qui, d’après nous, sont périmés. Il ne s’agit pas seulement, ici, d’un « comment ne pas parler/écrire ». Au contraire, ce qui m’intéresse, c’est justement : comment parler ? Comment parlons-nous et comment écrivons-nous « malgré » tout ? Quelle est la langue d’une époque, celle de la clôture de la métaphysique, à partir de laquelle nous croyons distinguer, au-delà de l’horizon, des images que nous sommes pourtant incapables de décrire sans faire appel aux vieux mots que nous déplaçons ? Les guillemets ont cet effet (entre autres) : ils déplacent notre texte, comme si ce que nous cherchions à dire était écrit ailleurs. Or, ceci n’a-t-il pas lieu sans arrêt ?
Derrida s’est toujours montré très attentif aux guillemets, s’il y a quelque chose comme une « question des guillemets ». Depuis De l’esprit à Le toucher, Jean-Luc Nancy, mais aussi dans certains entretiens ou dans des textes moins connus, cette lecture attentive de Derrida pourrait constituer une sorte de « théorie » des guillemets, de leur usage en philosophie et de leurs effets. Mon but, ici, consiste à ébaucher, ne serait-ce que sommairement, cette problématique qui pourrait nous aider à mieux comprendre comment nous parlons à l’époque de la clôture de la métaphysique, mais aussi, comment nous nous y prenons avec la « difficulté », voire même l’incapacité, de nous libérer des mots-de-la-tradition. C’est cette même « difficulté » qui nous amène à chercher une façon de parler, de penser, d’écrire qui puisse nous sortir de la métaphysique, malgré l’inéluctable réappropriation qu’elle opère, quels que soient nos efforts, condamnés que nous sommes à vivre sous son signe. Comment parler, penser, écrire sans nous lasser de vivre cette défaite, ce « malgré tout » que nous assumons dès l’origine de notre projet ? Ajouté à ces questions, j’espère que mes développements permettront également d’exposer les usages et les significations des guillemets dans les textes de Derrida, sa façon de « mettre entre guillemets » dans les lectures et réflexions qu’il mène au sujet de la clôture et de ses frontières.
Cramponnement
Le plus souvent, pour Derrida, les guillemets sont synonyme de précaution : c’est un geste de prévoyance et d’isolement face à la contamination toujours possible d’un mot. Ces guillemets de précaution jouent un double rôle. D’une part, l’isolement implique une distance historico-théorique par rapport à ce mot : nous le mentionnons, mais nous ne l’utilisons pas (c’est ce que Derrida emprunte à la speech act theory avec sa différenciation entre les notions de mention et use). D’autre part, ce geste implique déjà une dénonciation, une dénaturalisation du contexte, lequel se met à l’abri en isolant le mot sous la protection immunitaire des guillemets, ce qui n’est pas sans nous rappeler l’épochè husserlienne : « En général les guillemets opèrent comme des pincettes ou des pinces à linge destinées à tenir à distance […] [ils] signifient un geste de méfiance à l’égard d’un concept pur de toute contamination »[2]. Précisons que, même si nous les séparons ici eu égard à une certaine contrainte pour ainsi dire pédagogique en vue de les mettre à nu, ces deux cas se co-impliquent. Derrida explicite cette séparation entre mention et usage, par exemple, dans La Bête et le souverain : « Quand nous mentionnons ou citons un mot entre guillemets, nous en suspendons l’usage. Notre référent est le mot lui-même et non la chose qu’il est supposé désigner »[3].
Lorsque nous mettons des guillemets, nous passons le texte au crible[4]. Le mot reste ainsi enfermé, confiné, telle une bête que l’on peut dès lors exposer sans risque à la vue du public. Ensuite vient l’exercice paléonymique propre à chacun selon ses cheminements, lors duquel nous parcourons l’histoire et les significations du mot en question, ce que celui-ci cherchait à dire à un moment donné, mais aussi par lequel nous allons clarifier la consistance logique ou hiérarchique de l’un de ses usages précis. N’oublions pas, cependant, que s’il nous faut prendre ces précautions, c’est parce que nous ne disposons pas d’un autre mot qui puisse dire la même chose de la « même » façon, et que nous ne pouvons pas laisser loin derrière nous l’usage désuet de ce mot que nous avons capturé. Or, cette façon de nous servir d’un mot, de garder, de conserver le vocabulaire traditionnel, préserve en même temps le contexte que pourtant nous dénonçons par nos précautions. C’est ainsi que Derrida l’explique lors d’un entretien, en mettant en pratique la force performative des guillemets : « Les noms de “femme” ou d’“homme”, au sens courant qui garde son autorité entre les guillemets, continuent de désigner tout ce que commande le “destin anatomique”. »[5]
Cette distinction entre mention et usage déplace déjà le lecteur qui, par conséquent, peut constater que c’est justement l’usage de ces mots qui devient problématique. Il s’agit, en somme, d’une stratégie qui déstabilise le sens « traditionnel » d’un mot (tout ce qui pourrait se ranger sous cette notion d’« usage ») qu’elle fixe et cramponne à la fois, moyennant cette distinction que les guillemets mettent en œuvre. C’est ainsi que Derrida l’expose dans De l’esprit, qu’il consacre ‒ c’est bien connu ‒ à une révision approfondie de l’usage des guillemets qui apparaissent et disparaissent d’un texte à l’autre de Heidegger[6]. Il montre de la sorte que celui-ci « assume [le mot « esprit »] ainsi sans l’assumer, [qu’]il l’évite en ne l’évitant plus. »[7]
Attrapé dans ce double bind, le mot serait, donc, sous contrôle. Et en décrivant comment Heidegger use des guillemets avec le mot « esprit », Derrida semble esquisser une démarche qui libérerait le mot « esprit » de son fardeau, de sa contamination par la métaphysique. Comme si, de lui-même et après un séjour entre guillemets, l’esprit pouvait revenir propre, voire déconstruit. C’est en suivant la trace de ces guillemets qu’il trouve également la stratégie permettant de faire la distinction entre mention et use, encore que, en 1926-1927, Heidegger continue à laisser l’esprit entre guillemets :
« L’hospitalité offerte [au mot « esprit »], en tout cas, ne va pas sans réserve. Même quand on l’accueille, le mot se trouve contenu sur le pas de la porte ou retenu à la frontière, flanqué de signes discriminants, tenu à distance par la procédure des guillemets. »[8]
Je pense, néanmoins, que c’est là que se trouve l’une des clés les plus intéressantes de toute cette question, puisque, du moment qu’il est entre guillemets, le mot est capable de faire ‒ ou d’être ‒ deux choses à la fois, aussi contradictoires qu’elles soient : « À travers ces artifices d’écriture, c’est le même mot, certes, mais aussi un autre »[9]. Vient ensuite une description de la « loi des guillemets ». Avant de poursuivre, je me permets de citer en détail le parcours de Heidegger que Derrida retrace, car je considère que c’est un excellent exemple des démarches ou des procédures que nous entreprenons lorsque nous essayons de parler, de penser, et d’écrire à l’époque de la clôture :
« Heidegger a commencé par utiliser le mot “esprit”. Plus précisément, il l’a d’abord utilisé négativement, il l’a mentionné comme ce mot dont il ne fallait plus se servir. Il a mentionné son usage possible comme ce qu’il fallait exclure. Puis, deuxième temps, il s’en est servi à son compte mais avec des guillemets, comme s’il mentionnait encore le discours de l’autre, comme s’il citait ou empruntait un mot dont il tenait à faire un autre usage. Ce qui compte le plus, c’est la phrase dans laquelle s’opère cet entrelacement subtil, en vérité inextricable, d’“usage” et de “mention”. La phrase transforme et déplace le concept. De ses guillemets, comme du contexte discursif qui les détermine, elle appelle un autre mot, une autre appellation, à moins qu’elle n’altère le même mot, la même appellation, et ne rappelle à l’autre sous le même. »[10]
Dans cet emploi des guillemets, en tant que précaution ou mesure de sauvegarde face à la contamination d’un mot, afin que l’usage « vulgaire » de celui-ci n’infecte pas ce que nous cherchons à dire, on peut distinguer, au moins, deux étapes : une première étape au cours de laquelle nous dénonçons, nous criblons le contexte qui se rapporte à cet « usage » dans le but ‒ deuxième étape ‒ de conserver le même mot pour qu’il devienne un autre mot qui, tout en étant le « même », se mette à dire autre chose. Par conséquent, dénonciation et conservation se co-impliquent. Ou mieux encore, on pourrait dire que le fait même de conserver le mot entre guillemets provoque la dénonciation du contexte, et par cet exercice, le mot, tout en étant le même, en va à se comporter autrement. Dans le cas de Heidegger lu par Derrida, ces marques laissent des traces, et c’est pourquoi l’« esprit » revient, et revient même déchaîné dans le Discours du rectorat. Mais il s’agit là d’une autre histoire qu’on peut suivre dans le texte de Derrida auquel je renvoie, pour revenir, quant à moi, à l’énoncé qui définirait la loi des guillemets :
« C’est la loi des guillemets. Deux par deux ils montent la garde : à la frontière ou devant la porte, préposés au seuil en tout cas et ces lieux sont toujours dramatiques. Le dispositif se prête à la théâtralisation, à l’hallucination aussi d’une scène et de sa machinerie : deux paires de pinces tiennent en suspension une sorte de tenture, un voile ou un rideau. Non pas fermé, légèrement entrouvert. »[11]
Toujours entrouvert, pourrions-nous dire, au-delà du rideau de l’amphithéâtre heideggérien. En tout cas, la précaution consistant à mettre entre guillemets, surtout si l’on tient compte de l’exemple de l’« esprit » chez Heidegger, montre qu’une fois le mot enfermé, il n’est pas pour autant maîtrisable : les significations que nous voulions éviter à l’aide des guillemets sont toujours possibles, contaminantes et inexorables ; les mots de la tradition ne peuvent être purifiés, ni domestiqués. Ils appartiennent, en effet, à la tradition métaphysique. Bien entendu, nous pouvons dénaturaliser les notions qui se réfèrent à leur emploi traditionnel, mais nous ne pouvons pas éviter la hantise de leurs différents sens, pas plus que leur invasion. On aura beau retrancher des sens à l’« esprit», celui-ci pourra toujours re-devenir une fois de plus ce qu’il était auparavant.
Mais les guillemets retranchent-ils ou rajoutent-ils ? Seraient-ils une technique de conservation d’un reste ? Nous ne ferions que simplifier si nous proposions ici un parallélisme ou une identification avec la description que fait Derrida du « X sans X » blanchotien, bien que les résonances semblent nous inviter à le faire :
« Le même mot et la même chose paraissent enlevés à eux-mêmes, soustraits à leur référence et à leur identité, tout en continuant de se laisser traverser, dans leur vieux corps, vers un tout autre en eux dissimulé. »[12]
Le « X sans X » partage avec les guillemets de précaution ce désir de « purification » (mais, bien entendu, comment écrire aujourd’hui ce mot si ce n’est entre guillemets ?) et fait, comme on dit, de nécessité vertu, en cherchant à ôter à un mot ce qui le cloue à la tradition tout en le conservant, malgré tout, en tant que vieux mot. C’est ce « malgré tout » qui m’intéresse ici, car c’est lui qui, du même, va tirer autre chose :
« Il remarque le même X (X sans X), sans l’annuler, du tout autre qui l’écarte de lui-même. Absolument, jusqu’à lui faire perdre toute mémoire de soi, tout rapport à soi […] [et il] laisse tout intact (sauf, indemne) en apparence, la langue, le discours, la conscience, le corps, etc., à l’instant même où il a laissé s’opérer en silence un ravage absolu, un rapt, une rature instantanée. »[13]
Ce « malgré tout » continue à habiter ces mots sans leur nuire, sans aller à leur encontre, « toujours écrit pour eux, mais sans eux, au-delà d’eux »[14], de façon à ce que le mot soit deux choses à la fois, comme si c’était possible.
Ce qui intéresse ici Derrida, c’est cette paléonymie instantanée que produit le sans blanchotien. Mais comment savoir ce que ce sans va retirer au mot, et jusqu’où peut-on le savoir ? Voici deux réponses provisoires.
D’une part, le « X sans X » ressemble plutôt à un point d’arrivée, au moment où il n’est plus possible de poursuivre l’« analyse », quand nous croyons avoir dépouillé le mot de toute sa vieillesse et nous le (re)présentons à côté de son double purifié dont la seule garantie est le sans servant de médiation entre lui et ce double. D’autre part, au moment où nous mettons en pratique un savoir et, plus précisément, un savoir limitatif, douanier, nous rentrons et retombons dans le jeu de la tradition (métaphysique). Bien entendu, lorsque je parle ici du « X sans X », il n’est pas dans mes intentions d’avoir raison de lui en lui opposant une soi-disant meilleure stratégie qui serait celle des guillemets. Il ne s’agit surtout pas de simplifier les choses. Au moment de réfléchir à ce « comment parler à l’époque de la clôture de la métaphysique », nous constatons que les guillemets ne se comportent pas de la même façon dans le texte, surtout dans le texte derridien dans lequel ils finiront par avoir de tout autres « effets ».
Dans ce cas, c’est en suspendant l’usage d’un mot que celui-ci va commencer à dire autre chose. Quelque chose de différent, et en différée, bien qu’il soit toujours le même. Il serait tentant ici de mettre au même niveau les effets des guillemets et la stratégie de la différance (un texte peuplé de guillemets) mais, dans ce cas, c’est justement parce que les mots qui sont « là » ne peuvent plus nous aider. Quand un mot considéré comme « originaire » se trouve entre guillemets dans un texte, il fait déjà beaucoup plus que montrer son insuffisance ou son débordement : il met également en question tout ce qui lui sert de support de sens. Les guillemets peuvent provoquer ce double effet, sans pour autant s’identifier à la différance comme telle, ni au « concept » de différance qu’ils mettent aussi en suspens. Surtout parce que nous ne pouvons plus parler de l’« être » sans les ajouter ; pour pouvoir en parler à l’époque de la clôture, il faut faire comme si tout était entre guillemets, comme si tout « être » était entre guillemets. Les guillemets sont, en ce sens, une trace de plus, une autre façon de mettre en œuvre la stratégie de déstabilisation que Derrida nous décrit lorsqu’il parle de la différance :
« [C]’est ce qui fait que le mouvement de la signification n’est possible que si chaque élément dit “présent”, apparaissant sur la scène de la présence, se rapporte à autre chose que lui-même, gardant en lui la marque de l’élément passé et se laissant déjà creuser par la marque de son rapport à l’élément futur, la trace ne se rapportant pas moins à ce qu’on appelle le futur qu’à ce qu’on appelle le passé, et constituant ce qu’on appelle le présent par ce rapport même à ce qui n’est pas lui : absolument pas lui, c’est-à-dire pas même un passé ou un futur comme présents modifiés. »[15]
Les guillemets constitueraient donc, dans le texte derridien, une sorte d’intervalle, de temporalisation et d’espacement qui suspendraient momentanément le temps continu de la métaphysique. La précaution des guillemets devient, par conséquent, autre chose. On pourrait dire : se maintenir entre guillemets fait que tout change. D’une part, le mot reste cramponné à notre texte, certes, indemne et intouchable, mais, d’autre part, c’est grâce à ce cramponnement, que nous déplaçons et faisons glisser, ne serait-ce qu’un instant, le sens du mot hors de sa continuité « naturelle » et de son usage. Il n’est plus question du mot en tant que tel (des mots en tant que tels), mais du déplacement du sens en général que son cramponnement provoque par l’usage des guillemets.
La tâche du cramponnement ne cesse jamais, et c’est au moment où nous croyons que nous en avons fini, que l’animal enfermé a été domestiqué, que le mot revient en portant avec lui tout ce que nous avions cherché à supprimer pour le purifier. C’est ce que Derrida décrit, en somme, au sujet de l’« esprit » heideggérien : « La métaphysique revient toujours »[16]. Ce qui est inscrit à même le mot, rien ne peut l’effacer de façon définitive.
Que se passe-t-il lorsque nous mettons un mot entre guillemets ? « Ça décramponne. Comme des crampons qui décramponnent. […] Mais les crochets d’écriture – les tirets, les “parenthèses” (les guillemets) – cramponnent aussi[17]. Une écriture double, redoublée par ce petit geste des guillemets qui, à la fois, lâche et cramponne le mot. C’est par précaution qu’on veut cramponner le mot en se limitant à le mentionner pour que son usage ne contamine pas le texte, et c’est cette précaution qui produit son double : l’un hante l’autre, et réciproquement. Une relation qui n’en finit pas et, lors de laquelle, rien ne reste à sa place. Les mots sont problématiques et, évidemment, il faut les changer, les éviter ou les abandonner. Ce que les guillemets de précaution nous montrent, c’est que les mots ne constituent pas plus le problème comme tel que sa solution. Ces guillemets sont bien plutôt le signe du processus interminable de réappropriation de la métaphysique.
Nous misons tout sur les mots, nous leur faisons confiance, afin qu’ils en finissent une fois pour toutes avec cette clôture interminable, comme si les mots pouvaient perdre, ou effacer, leur mémoire. On peut toujours rêver d’un vocabulaire entièrement neuf, inventé ou réinventé, capable de faire dire aux mots autre chose. Derrida parle d’inventer un nouveau langage afin qu’un mot puisse nous affecter tout autrement, et aussi afin de rendre possible cette perte de mémoire. Permettez-moi de spoiler : c’est la méfiance qui l’emportera. Mais, pour le moment, revenons à ce glissement qui a lieu au moment même du cramponnement.
Glissement
« Mais il faut parler ». C’est ainsi que commence l’une des sections de l’article « De l’économie restreinte à l’économie générale » dans laquelle surgit cette question de l’inadéquation des mots, selon Bataille, mais aussi de la possibilité et de la façon de dire cette inadéquation, ainsi que d’un certain devoir de la dire. Le silence, dire le silence, se manifeste comme le paradoxe qui donne à voir ladite inadéquation. Car, en effet, il faut parler, il faut employer le langage même pour lui faire dire son insuffisance, son reste. Ici, Derrida va encore ébaucher la formulation de ce qui pourrait être notre rapport à ces vieux mots, ainsi que notre crainte quant au risque de leur contamination inévitable : « Nécessité de l’impossible : dire dans le langage – de la servilité – ce qui n’est pas servile »[18]. Le mot silence serait capable d’une telle impossibilité : il dit que le sens fait défaut mais, en faisant taire le sens, « il glisse et s’efface lui-même »[19]. Un double geste, encore, sinon capable de mettre le sens en échec, de faire, du moins, la preuve d’une certaine stratégie afin que le langage dise sa propre indigence, et qu’à la fois, il devienne lui-même le lieu de sa présence aussi bien que de son absence. Derrida décrit cette opération comme un glissement, qui est risqué, précise-t-il, puisqu’elle met en jeu le sens tout en s’exposant à le perdre. Mais aussi parce que ce risque peut également fournir, donner un sens à cette opération. Donner raison à la raison. Et Derrida mise cette fois sur ce risque :
« Pour courir ce risque dans le langage, pour sauver ce qui ne veut pas être sauvé – la possibilité du jeu et du risque absolus – il faut redoubler le langage, recourir aux ruses, aux stratagèmes, aux simulacres. »[20]
Ce qui nous intéresse avec les guillemets, c’est cette conjonction du glissement et du risque, compte tenu, justement, du rapport qu’ils entretiennent avec l’impossibilité de lâcher les vieux mots, malgré le penchant de ces mots à retourner à la métaphysique : ce glissement qui produit la répétition du même. Ce n’est que maintenant que nous comprenons les risques qui accompagnent l’usage des guillemets. Un risque, d’ailleurs, affirmé, qui caractérise parfaitement le travail de Derrida. Nous avons également noté ci-dessus que ce qui a « le plus de prix » dans cette stratégie n’est pas tant le changement qui se produit dans le mot lui-même, lequel peut devenir un autre tout en restant le même, mais bien plutôt la restance et la résistance du mot. Une autre façon de dire le risque. À savoir, nous pouvons faire dire au mot tout autre chose, moyennant nos précautions, ratures, guillemets, mais ledit mot ne cessera pas pour autant de dire ce qu’il dit. On peut toujours le mettre en suspens, mais on ne pourra jamais l’effacer. C’est, donc, ce stratagème, son « effet » qui met tout sens dessus dessous : d’un côté, en suspendant la continuité de l’usage d’un mot pour lui faire dire autre chose, voire pour lui faire dire au plus juste l’impossible (lequel n’est pas nécessairement son contraire absolu, comme s’il s’agissait là d’une somme sans reste) ; de l’autre côté, en greffant le mot autre part et à un autre moment, autrement dit, en greffant l’altérité à même le mot. En dénonçant le contexte qui explicite l’usage d’un mot, on le dénaturalise sans doute, mais la précaution nous conduit encore plus loin, en un point où le « cramponnement » du mot finira par signifier aussi « glissement » :
« Comme il s’agit […] d’un certain glissement, ce qu’il faut bien trouver, c’est, non moins que le mot, le point, le lieu dans un tracé où un mot puisé dans la vielle langue, se mettra, d’être mis là et de recevoir telle motion, à glisser et à faire glisser tout le discours. Il faudra imprimer au langage un certain tour stratégique qui, d’un mouvement violent et glissant, furtif, en infléchisse le vieux corps pour en rapporter la syntaxe et le lexique au silence majeur. »[21]
Ce sont les guillemets qui fixent ce mot-point, par leur aptitude à cramponner le vieux mot, à le transformer en tout autre chose, à déplacer son sens et, de la sorte, à le faire glisser. Sans, pour autant, ôter à ce mot quoi que ce soit.
Si le cas de Heidegger dont nous avons parlé plus haut nous a montré que le cramponnement prudent des guillemets était incapable de domestiquer l’« esprit », nous allons suivre maintenant l’exemple du « toucher ». Dans sa lecture de Jean-Luc Nancy, Derrida signale un certain manque de précaution dans l’insistance nancyenne du toucher. Précaution de Derrida accompagnée d’un scepticisme (que Nancy qualifiera de rabbinique dans sa réponse au livre de son ami), doute derridien quant à ce que ce « toucher » puisse être différent de tout autre toucher le précédant. Que ce toucher soit, par exemple, capable de se libérer de ce « mégalovirus » du toucher où tout se touche, et de dire cette libération avec les mots d’aujourd’hui. Pour exprimer ce doute ou cette suspicion, Derrida commence par pointer dans le livre de Nancy certains guillemets qui touchent sans trop toucher au mot « toucher », et qui, à un autre moment, constituent aussi une (solli)citation de ce mot, « peut-être parce que ladite chose ne répondait pas généralement ni proprement (apte) à son nom commun. »[22] L’inadéquation que provoque le toucher est telle qu’« il fallait changer tout le langage, tout récrire, tout ex-crire, pour qu’on pût proprement (apte) parler et penser le toucher »[23]. Double jeu, encore, d’une précaution qui finit par en ébranler le sens. Il fallait changer le langage, c’est entendu, pour que ce toucher rende touchable la liberté, comme dans le texte de Nancy. Mais aussi pour que ce toucher touche sans « trop » y toucher, ce « trop » ne signifiant, en vérité, que le fait de toucher sans y toucher. Il semble que les guillemets sont toujours là quand un mot cherche à faire l’impossible.
Au fil de l’ouvrage, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Derrida relève les guillemets qui, tous, disent justement cette inadéquation. Par exemple, chez Didier Franck, qui parle d’un temps qui « précède » le temps[24], ou chez Husserl où l’on retrouve une « Leibhaften » qui ne signifie pas proprement « incarnée »[25]. Derrida a lui-même recours aux guillemets, aux italiques, au « comme si », dès qu’il s’agit de plonger dans une question minée, bourrée de pièges et qui, par conséquent, fait constamment courir le risque d’une contamination. Il avance à tâtons pour savoir de quelle façon s’y prendre avec le toucher, le sens et ses sens, afin d’éviter que tout cela se retourne contre lui, cherchant à toucher avec tact, sans trop y toucher. Derrida manque en quelque sorte de compréhension à l’égard de cette insistance de son ami au sujet de ce mot, « toucher », voire d’un toucher sans guillemets. Il se méfie que ce mot puisse faire autre chose que ce qu’il a toujours fait, de sorte que le toucher ne touche pas d’une seule manière. Pour qu’il n’y ait donc pas « le » toucher, il faudrait que le tact, geste par excellence de la (ré)appropriation, n’y touche pas trop. La commotion est telle que le corps lui-même ne nous permet plus d’imaginer, de soigner ou de penser cet autre tact.
Le toucher… serait aussi une représentation de cette façon de laisser en suspens le toucher. Une sorte d’intuition conduit Derrida à se demander s’il n’est pas en train de courir à son tour le risque de trop y toucher, de conditionner quelque arrivant caché dans ce Corpus ébauché par Nancy, et que lui s’efforce de « toucher mais ne pas toucher, surtout pas, toucher sans toucher, toucher mais en veillant à éviter le contact. […] [C]e toucher qui touche à peine, ce n’est pas un toucher comme un autre, là même où il ne touche qu’à l’autre »[26]. Surtout, ne pas « toucher » le toucher. Le livre finira par esquisser ce que l’on pourrait appeler une hapstinence, un tact qui se risque à toucher sans toucher. Cette difficulté requiert « un langage aussi paradoxal, plus que contradictoire et hyperdialectique (x sans x, x=non-x, x=conjonction et/ou disjonction de x + et-x, etc.) »[27].
Nancy ne prend même pas cette précaution avec le mot, avec le toucher. Il sait parfaitement que c’est un des mots les plus contaminants et contaminés, un mot indomptable en ce qui concerne aussi bien son inévitable réappropriation métaphysique que son pouvoir de commotionner tout ce qui y « touche ». Quoique le corps et le tact font pour ainsi dire partie du patrimoine de ce qui est naturel, l’un comme l’autre finissent toujours par échapper à leur naturalisation ou à leur dénaturalisation. Ils échappent surtout à leur unification, à leur mise en unité : s’il y a tact ou s’il y a corps, tous les deux doivent toujours être pluriels. C’est alors une nouvelle manière d’écrire en pleine clôture, et les guillemets en font partie. C’est pourquoi Nancy dira qu’il n’y a pas « le » tact ou « le » corps, mettant en suspens leur usage habituel. Il dépouille même le tact de l’une de ses plus fortes racines, à savoir, qu’il y aurait une certaine unité de ce qu’il est, comme une certaine originarité. Les guillemets suspendent l’unité du tact. C’est ce que Derrida entend comme le geste déconstructif de Nancy, un geste dangereux qui « risquerait de le priver de toute détermination conceptuelle et à la limite de tout discours – ou de livrer celui-ci à l’empirisme le plus irresponsable »[28]. Ici, à cette toute petite place, Derrida va souligner la différence entre son écriture et celle de Nancy : à partir de la formule d’un « s’il y en a », quoiqu’il n’enlève rien à ce qu’il y a et qu’il ne dise pas ce qu’il n’y a pas. Et si Derrida la préfère, c’est parce qu’« il n’y a là rien qui puisse donner lieu à une preuve, à un savoir, à une détermination constative ou théorique »[29]. Il s’agit d’une autre manière de décliner, sous la forme d’un conditionnel plutôt que d’une négation, ce « le » (du) toucher qu’il n’y a pas, de même que cette unicité ou cette originarité du tact, du corps ou de « la » « déconstruction ».
Bien que nous ayons signalé les effets potentiels de la répétition du même, ce n’est pas ici le cas. Derrida marque donc la différence entre ces deux gestes : « Ce n’est pas la même [forme de décliner le « le »], justement, et voilà deux gestes “déconstructifs” irréductiblement différents. Il reste que cette multiplicité s’annonce comme “déconstructive” »[30]. Ici, c’est Derrida qui met ou qui ôte les guillemets pour laisser en suspens tout savoir, toute conceptualisation de ce qui serait « déconstructif ». Surtout ne pas mettre la main sur la déconstruction, ni lui forcer la main. Éviter, à tout prix, cet humainisme, cette conceptualisation (Begrifflichkeit) qui porte à son tour le signe de la main.
Suivons ce mouvement des guillemets. D’abord, Derrida met entre guillemets le terme « déconstructifs » pour caractériser ces deux gestes, le sien comme celui de Nancy. Cela a un sens, car qualifier ces gestes sans plus pourrait les faire passer pour une méthodologie, un savoir théorique, ou leur donner une définition indubitable, là où il est justement question, lorsqu’il s’agit de déconstruction, d’effacer toute condition à son arrivée. Il répètera ces guillemets plus tard pour qualifier cette « multiplicité déconstructive », c’est-à-dire, en insistant sur le fait que, s’il y a déconstruction, ce sera toujours au pluriel, toujours des déconstructions. Dans la phrase suivante les guillemets ont disparu de façon à insister de nouveau sur le fait que chaque fois que nous disons « la » déconstruction, il nous faut l’entendre au pluriel. Dans Le toucher…, les guillemets sont une sorte d’avertissement au lecteur pour indiquer à celui-ci à quel moment Derrida entreprend un discours « affirmatif » sur la déconstruction[31] ; ou à quel moment il en sort, comme s’il était possible d’en parler depuis un lieu que j’appellerai, faute de mieux, méta-déconstructif. Même sans guillemets, quelle que soit l’affirmation, au sens fort, que nous pouvons attendre ici de Derrida concernant ces deux gestes déconstructifs, celle-ci reste suspendue dans un chiasme : « Sûrement pas, pas sûrement »[32]. Reste ainsi ouverte une discussion que j’ai l’intention de reprendre ici en partie en cherchant à penser comment écrire à l’époque de la clôture. Au-delà des nombreuses occasions au cours desquelles Derrida aura traité la question de la clôture – ce travail de deuil interminable –, dans Le toucher…,nous allons le suivre se mesurer aux défis que lance Nancy par son travail écrit sur le bord même de la métaphysique.
Le geste n’est donc pas si minuscule s’il est capable de marquer une différence qualifiée d’irréductible. Je voudrais reprendre ici cette différence tout en y introduisant une autre distinction, toute petite, elle aussi, entre deux positions, l’une « conditionnelle », celle de Derrida, et l’autre, « négative », de Nancy. J’assume, donc, le risque de simplifier, de m’écarter un instant de ce que Michel Lisse appelle des « règles douces », afin de mieux comprendre comment écrire, penser et parler à l’époque de la clôture. Cette petite distinction consisterait, donc, ou bien à maintenir entre guillemets un vieux mot, ou bien à traiter avec lui directement, quitte également à ne pas le marquer dans le texte[33]. Cette distinction s’avère, pour autant, impossible : même si ces deux positions, « négative » et « conditionnelle », sont irréductibles entre elles, elles se co-impliquent de façon toute aussi implacable ; toutes deux sont « déconstructives ». Ce postulat impossible ne pourrait se donner, à proprement parler, que dans le cadre, le parergon, de la clôture de la métaphysique, parce que, si leurs différences sont tout simplement irréductibles, une solution toute simple n’y suffira pas. C’est pourquoi nous avons recours à cette notion de co-implication ou co-appartenance, à ce postulat qui relève d’un double bind. Tout cela explique d’autant mieux que « la » déconstruction est plurielle, qu’elle ne peut pas être associée de façon privilégiée à une signature. Ce que Derrida montre dans Le toucher…, c’est aussi qu’il n’y va plus de signatures quand on parle de déconstruction.
Quelle différence entre garder un vieux mot avec ou sans guillemets ? Finalement, nous cherchons à préserver la mémoire de ce mot, même s’il continue à contaminer le texte, exposé aussi à ce glissement déjà évoqué. En suivant cette voie, on pourrait dire que les guillemets, dans l’approche « conditionnelle », vont manifester cette suspension, tandis que la voie « négative » coupe court à l’unicité ou à l’originarité qu’un mot peut évoquer. Par conséquent, cette seconde voie est moins problématique que la première ou, du moins, elle se débarrasse de son élément problématique moyennant la négation du mot déterminé. Dans quelle mesure sommes-nous capables de faire la différence entre, par exemple, écrire « toucher » et « il n’y a pas “le” toucher » ? Est-ce la même chose ? Les implications sont-elles les mêmes ? Sommes-nous capables de répondre à ces questions sans transformer les déconstructions en méthodologies disponibles ou programmables ? Il est important de comprendre qu’il n’y a pas de « degré », ni d’intensité mesurable, lorsqu’il s’agit de « déconstruction ». C’est pourquoi nous ne pouvons pas dire non plus qu’une position est plus ou moins « déconstructive » que l’autre, ou que l’une est meilleure ou plus originaire que l’autre. C’est peut-être aussi pourquoi, chaque fois que nous écrivons « ça, c’est une déconstruction » ou bien « cette lecture déconstruit telle chose », nous finissons par l’écrire entre guillemets, car nous savons parfaitement que quel que soit l’énoncé susceptible de conditionner l’avenir de ce qui, peut-être, « a lieu », « arrive » lors de la déconstruction ou des déconstructions, ledit énoncé « doit » rester en suspens. Question qui se situe doublement à la limite : à la clôture de la métaphysique, mais aussi à la limite de la déconstruction et sur la manière dont on l’entend. Est-il possible d’affirmer quelque chose de la déconstruction ? Ici, nous ne pouvons ‒ et c’est encore ce qu’il y a de plus juste ‒ que prendre des risques.
À mon tour de courir un risque en reprenant la question de Derrida au sujet de cette « différence irréductible » : dans quelle mesure ce geste négatif et, paradoxalement, affirmatif de tout ce qu’il ne nie pas explicitement, n’imposerait-il pas de conditions à l’avenir ? Par exemple, en donnant lieu à une sorte de différenciation ou de sélection qui conserverait l’empreinte d’un intérêt bien déterminé ? Il serait facile de répondre que nier une certaine caractéristique associée à un mot, par exemple, son unicité ou son originarité, ne dit rien sur ce qu’il en serait de ce mot sans cette caractéristique. De même que nous ne lui ajoutons rien du tout. Et, pourtant, l’unicité, l’originarité, par exemple, du tact, font partie de celui-ci. Bien entendu, nous pouvons, et même nous devons problématiser ces questions, mais nous ne pouvons pas les soustraire à ce mot du toucher, comme s’il lui était possible de s’en défaire. Comme si nous dévoilions une toute nouvelle histoire du tact au cours de laquelle il y aurait quelque originarité tout autre, « antérieure » à la vieille ou traditionnelle originarité, et lors de laquelle le tact n’aurait jamais eu ces caractéristiques essentielles, à savoir, l’unicité ou l’originarité. Le fait de mettre le tact en question nous oblige ‒ c’est incontestable ‒ à solliciter ces composantes. Mais si nous les éliminons ou si nous les nions, nous ferons du tact autre chose, plutôt l’expression d’un désir ‒ peut-être le plus juste ‒ qu’une commotion, qu’un glissement effectif.
J’insiste une fois de plus. Il est « légitime », voire désirable, qu’il n’y ait pas un seul tact, que le tact puisse être, ou devenir multiple, mais il doit à la fois aussi être unique. Ce qui nous conduit à la limite. Il faudrait dire ici que la seule chance pour que le tact soit multiple consisterait à laisser en suspens ce qu’il pourrait être si, parmi tout ce qu’il « fait », il y avait une chose en mesure de répondre à ce nom, à ce mot, vieux ou neuf. Voilà la « seule », l’« unique » façon de le faire[34].
À la limite de cette question ouverte, Derrida va formuler un paradoxe entre la déconstruction en général et la déconstruction du christianisme en particulier, ainsi que sur les possibles effets de l’une et l’autre manière d’écrire ces questions.
« Bien des conséquences de la discussion ainsi esquissée restent à tirer, par exemple si, pour toutes ces raisons, on disait : “oui, mais il n’y a pas la déconstruction du christianisme” parce qu’il n’y a pas et il n’y aura jamais “la” déconstruction et parce qu’il n’y aura pas et il n’y a jamais eu “le” christianisme. »[35]
Risque de trop y toucher, de dépasser les bornes, que Derrida va assumer avec ce paradoxe qu’il laissera en suspens, sans vouloir y toucher davantage. À tel point qu’il sautera à une autre question à l’aide d’une petite phrase, puis encore à une autre question, à la façon de quelqu’un qui zappe devant sa télé[36]. Au bord de ce paradoxe, Derrida semble marquer les limitations de la position « négative », visant directement Nancy dans son projet de déconstruction du christianisme, « cette folie de perdition », comme l’appelle Derrida lorsque, à la fin de Le toucher…, il affirme : « Nous ne sommes pas “chrétiens” ou “non chrétiens”, entre guillemets, de la même façon »[37]. En tout cas, s’il y a une explication pour que Derrida table sur cette position « conditionnelle », ce serait, justement, qu’il ne nie pas la possibilité du singulier, et si celle-ci l’intéresse c’est, précisément, parce que c’est là qu’il y a du risque : « Sans savoir qui tienne, il faut peut-être essayer, voilà la singularité du singulier. Mais le singulier n’est pas et ne doit pas être plus assuré. Il doit être couru comme une chance ou un risque. »[38]
Mon texte a déjà trop glissé, peut-être en cherchant à côtoyer la limite. La limite de l’écriture, de la parole ou de la pensée à l’époque de la clôture. Nous venons de quitter un livre sur les limites pour essayer de mieux comprendre comment nous nous y prenons pour demeurer au sein de cette clôture, tout en évitant surtout de s’y enfermer. Quel paradoxe que de développer justement à cette époque, une pensée sur une ouverture si « grande » que même le mot d’« ouverture » semble déjà conditionner, voire beaucoup trop limiter, cet imprévisible avenir. À la limite de cette partie de mon texte se confrontent deux façons d’écrire à la limite : l’une n’en comporte aucune, et dans l’autre, en revanche, la limite est toujours « présente », bien qu’on ne puisse plus l’affirmer avec la même conviction. Cette « présence » découlerait d’un geste d’écriture qui nous rappelle toujours que, pour déstabiliser la limite, il faut tenir compte de la limitation, voire, il faut l’aimer. Finalement, tout cela revient à un conditionnel qui, loin d’hésiter, se veut le geste d’une ouverture inconditionnelle sur l’avenir. Reprenons, une fois de plus, et entretenons de ce petit geste d’écriture. L’invention fera le reste.
Écrire la clôture
Comment parler des « déconstructions » ? Comment en parler surtout si cela échappe à tout savoir ? Comment dire quoi que ce soit à leur sujet sans commencer à marquer des limites, des méthodologies, des analyses ? Voici le soin avec lequel Michal Ben-Naftali pose les termes de son dialogue avec Derrida en 2004, quelques mois avant sa mort :
« La déconstruction des “concepts” est double : à la fois thématique et performative. […] Ces “concepts” se voient ainsi rigoureusement “thématisés” et donc définis. […] Et, en même temps, ces mêmes “concepts” constituent des “thématiques” qui ne cessent de produire de puissantes “dynamiques affectives” toujours déjà animées par leur écriture même. »[39]
Moyennant tout ce soin, Ben-Naftali sait parfaitement qu’il y a des mots qui, du moment qu’il s’agit de la déconstruction, « appellent » les guillemets. Mais combien d’autres encore aurions-nous pu ajouter ? À commencer autour du mot « déconstruction », puis de « produire », d’« animées » et, bien entendu, d’« écriture ». Je ne vais pas citer ‒ ce serait trop long ‒ le reste de la question par laquelle Ben-Naftali pose les termes de son dialogue avec Derrida qui devait porter sur le thème « Droit et amour ». Pourtant, la réponse de celui-ci contient, peut-être, l’une des meilleures et des plus claires explications de la « paléonymie », de même qu’elle nous fournit quelques indices sur la façon dont il s’y prend pour écrire, penser et parler à la limite de la clôture :
« [V]ous avez raison de rappeler que la démarche déconstructrice, telle du moins que j’essaie de la pratiquer, est un traitement thématique, c’est-à-dire l’étude de certains “objets”, de certains “concepts” […]. [C]ette analyse, donc, théorique de type constatif s’accompagne, fait un et un même corps avec ce que vous avez appelé fort justement une “écriture performative”, c’est-à-dire qu’en analysant […] je fais quelque chose, je fais des gestes à travers l’écriture, des gestes d’écriture, qui sont eux-mêmes performatifs, qui posent et transforment les “concepts” en question. […] Et il est évident qu’en parlant d’“amour” ou d’“amitié” en mon nom, je présuppose leur déconstruction déjà engagée de telle sorte que ce n’est plus la même – disons, c’est le même mot mais ce n’est plus le même mot. […] comme s’ils étaient homonymes sans être synonymiques. C’est ce que j’ai appelé la “paléonymie”. […] c’est le fait de se servir d’un vieux mot – un paléo, un mot très ancien –, de conserver un vieux mot, là où la signification de ce même mot s’est éveillée ou réveillée à autre chose. […] Et écrire de cette façon, avec des performatifs transformateurs, c’est aussi accepter ou réaffirmer l’héritage d’une langue. »[40]
Écrire en acceptant l’héritage d’une langue et, à la fois, à l’aide de celle-ci, tâcher de transformer ses mots. Un geste d’écriture qui fait que le même mot puisse signifier autre chose. Cela pourrait être une réponse à notre question quant à la façon d’écrire à l’époque de la clôture. Si les guillemets sont capables de nous aider à parler à cette époque, c’est parce qu’ils ne sont pas définitifs et qu’ils laissent en suspens la décision ; c’est aussi pourquoi ils sont dangereux, comme n’importe quel supplément. Le « projet », si quelque chose de tel existe, consisterait donc à essayer de préserver un certain nombre de « conditions »[41] pour l’avenir. Pour un avenir dans lequel l’invention de l’autre, cet impossible, « est » possible. Mais cet « autre » ne peut signifier « autre que la métaphysique », comme s’il s’agissait tout simplement d’un remplaçant, d’un substitut. Continuer à parler de « clôture », même si l’on entend que rien n’a été fermé, classé d’une fois pour toutes, c’est, peut-être, un geste, un performatif ‒ ou un perverformatif ‒ de plus à l’aide duquel on cherche à réaffirmer un héritage[42].
À quel point serions-nous prêts, d’autre part, à rejeter, voire à laisser tomber définitivement certains mots[43] ? Quels seraient ces mots et les raisons pour le faire ? Quels en seraient les effets à l’intérieur de la clôture ? C’est-à-dire, à quel point voulons-nous nous risquer à un minimum de fermeture, de décision et d’institution ? Au nom de quelle « éthique » le ferions-nous ? C’est peut-être l’urgence qui nous fait éprouver une sensation de facilité au moment de préciser les raisons pour lesquelles nous évitons, rejetons ou changeons certains mots ‒ raisons que, sans doute, nous pouvons regrouper sous un désir de justice, de non-violence, etc. Les guillemets ‒ c’est ce que j’ai essayé de montrer ‒ pourraient nous aider, même si nous cédons à l’appel de l’urgence de justice, à ne pas perdre trop rapidement notre mémoire, voire à prendre notre temps, un peu plus de temps, avant de décider d’une quelconque fermeture. Les guillemets, surtout, en tant que geste transitoire.
À quel moment mettre les guillemets ? Je me permets de citer ici une réponse de Derrida alors qu’il se demande, à l’occasion du Colloque The States of « Theory », pourquoi « theory » devait rester entre guillemets: « [L]es guillemets s’imposent à un moment où le rapport à tous les langages, à tous les codes de la tradition est à ce point déconstruit, comme totalité et dans sa totalité »[44]. Il entreprend ensuite d’énumérer les façons de justifier les guillemets ainsi que leurs paradoxes. D’une part, il va dire qu’« il n’est plus possible d’utiliser sérieusement les mots de la tradition – on ne les utilise jamais, on les mentionne seulement »[45], ce qui nous force à montrer d’une façon plus ou moins visible, dans l’écriture, que nous ne nous servons pas de ces mots, que nous ne faisons que les mentionner. Ce qui, par conséquent, provoque la déstabilisation de l’opposition entre usage et mention, déstabilisation qui finira par solliciter tout le système de valeurs et, finalement, la « philosophie » qu’on laisse entre guillemets, pour ainsi dire. Si toutefois cela indique qu’on la laisse en suspens, l’usage de la « philosophie » serait en suspens. D’autre part, l’usage généralisé des guillemets serait la seule position « théorique » possible ou, du moins, la seule relation conforme au langage, une fois que la déconstruction (où « ça se déconstruit ») a eu lieu. Les guillemets seraient, donc, « la conscience et la pratique mentionnantes de la totalité organisée de notre lexique et de notre syntaxe »[46]. C’est aussi pourquoi Derrida signale « au moins » trois paradoxes :
Premièrement, cette généralisation va provoquer une « sorte d’inversion du propre et du non-propre » en conformité avec les guillemets du mot « esprit » chez Heidegger. Autrement dit, un mot enfermé entre guillemets pendant un certain temps pourrait devenir propre. Or, c’est précisément la méfiance que ce geste implique qui va également finir par mettre entre guillemets « le sens propre de la propriété ». Il n’y a pas moyen de nettoyer, à proprement parler, un mot, de bien le nettoyer de son passé et de ses possibilités de réappropriation. Il n’y a pas moyen de domestiquer un mot.
Deuxièmement, l’encadrement d’un mot par des guillemets, loin d’être une neutralisation du cours de l’histoire, serait le geste d’une attention démesurée à celle-ci, en particulier à l’histoire des concepts. C’est-à-dire, même si ces guillemets sont le geste d’une suspension, pour le faire, encore faut-il bien connaître l’histoire du mot en question, tenir compte de l’histoire que nous laissons en suspens. Je me permets de simplifier un peu : on pourrait dire que ce deuxième paradoxe ressemble à ce cramponnement dont j’ai déjà parlé. Les guillemets cramponnent l’histoire d’un mot.
Troisièmement, le glissement généralisé. Les guillemets ne sollicitent pas seulement un mot ou un concept, « Ils rappellent la citationnalité générale, ils citent à comparaître cette citationnalité […] comme le rappel de la nécessaire contamination générale »[47]. Ce geste dans l’écriture finira par provoquer des effets « déconstructifs ». Paradoxe, par conséquent, du moment que ces marques ‒ les guillemets ‒, alors qu’elles cherchent à éviter la contamination, vont finalement intervenir en faveur de cette contamination générale.
J’ai essayé de faire en sorte que mon texte accueille ces paradoxes des guillemets dont on peut suivre la trace dans certains travaux de Derrida, peut-être comme un témoignage de sa manière d’habiter et de cohabiter à la limite de la clôture de la métaphysique, de plier cette limite, de la tordre, de la déstabiliser. J’ai déjà dit aussi que l’invention ferait le reste. Pour que ce soit possible, pour que l’invention fasse le reste, dans le cas qui nous occupe ici, à savoir celui de la réponse à la question « comment est-ce que nous écrivons (pensons, parlons) à l’époque de la clôture ? », il faut aussi comprendre les guillemets comme le geste de l’aporie, des voies qui manquent, comme c’est justement le cas lorsque nous nous trouvons à la limite, face à quelque limite, sans savoir quelle est la voie à suivre. Si nous arrivons à ce point et que nous sommes capables de ne pas savoir quelle issue ou quelle décision privilégier, quelle que soit la voie que nous prenions, il s’agira là d’une invention qui, à son tour, inventera le tout autre. Mais, comment dire cela sans nous risquer à quelque pré-vision ? Risque plus que jamais extrême de ruiner toutes nos précautions. Est-ce qu’il est possible de parler d’invention sans conditionner la destinée, la venue de l’avenir, de l’autre ? « Inventer, ce serait alors “savoir” dire “viens” et répondre au “viens” de l’autre. […] De cet événement on n’est jamais sûr. »[48] Les guillemets, bien entendu, ne doivent pas manquer au rendez-vous. La limitation des mots de la tradition a conduit Derrida à inventer[49] au cours de nombreuses occasions, et à faire en sorte que, parmi tous ses gestes et toutes ses performances, quelque chose comme un évènement ait lieu dans son texte : tantôt une lettre qu’il change, tantôt un mot qu’on ne peut différencier par lui-même, qu’on ne peut entendre qu’à le voir écrit, ou encore un mot caché à l’intérieur d’un autre. Ces inventions, évidemment, déstabilisent la clôture, mais finissent surtout par constituer un reste qui échappe à la métaphysique.
Quelle serait la langue de l’invention ? Comment serait-elle possible ? Mais aussi comment serait-il possible de dire qu’une chose comme une « langue » puisse faire partie de l’évènement d’une invention ? Ce qui est sûr c’est qu’une langue, s’il y en a, ne serait sans doute pas une invention, même si c’est un « toi » ou un « moi » qui donne lieu à l’invention. Or, que dit ce mot d’« invention » si ce n’est d’appeler une limite du discours ? Une limite et une chance imprévisible pour qu’une telle limite prenne plus d’amplitude. Mais encore, à quel moment l’invention s’articule-t-elle avec une langue, n’importe laquelle, parmi celles dont nous nous servons d’habitude ? Dès que j’invente, la voix me manque. Ou plutôt, tant que la voix ne me manque pas, je n’invente rien. Cela ne veut pas dire que nous gardons le silence, tant qu’il y a des guillemets. Ceux-ci sont peut-être, à leur tour, l’expression de ce « tant que » : tant que nous essayons de garder le silence. Mais la voix, peut-elle manquer volontairement ? Est-ce que quelqu’un peut prendre une telle décision ? Une « décision », en fait, impossible, voire folle ? Nous n’avons qu’une langue et elle n’est pas la nôtre ; mais, que suppose, donc, le fait de chercher à manquer de voix, d’aller vers cette limite et de l’épuiser ? Est-ce le désir d’abandonner ce que nous appelons une langue qui n’est pas la nôtre qui stimule au fil d’une telle dérive ? Est-ce que quelqu’un, quelqu’un de vivant, est capable de dire « j’abandonne ma langue, qui n’est pas la mienne » ? Voilà trop de questions au point où nous en sommes.
L’invention, cette impossibilité, serait donc l’autre manière à l’aide de laquelle nous essayons d’écrire. Vu que nous ne pouvons pas prévoir que cette invention arrive, il ne nous reste qu’à nous maintenir sur cette limite et, pour le moment, de ce côté-ci, alors que nous entreprenons le travail de deuil de la métaphysique (ce qui cherche à résonner dans la glôture, ce sont ces glas qui sonnent pour la métaphysique). En nous cramponnant peut-être à une langue qui pour nous, qui avons habité si longtemps la clôture, manquerait aujourd’hui un peu de sens. Mais il faudra tout de même dire, au moins, cette « inadéquation ». S’il était question d’énoncer la motivation qui éperonne cette écriture ainsi que ce texte lui-même, il faudrait, malgré tout, l’écrire, bien sûr, entre guillemets.
Source image : Santiago Caneda Blanco – Elementos III (2013), techique mixte sur papier.
[1] Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 233.
[2] Jacques Derrida, « Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms, Parasitisms, and other small Seisms », in Thomas Dutoit et Philippe Romanski (dir.), Derrida d’ici, Derrida de là, Paris, Galilée, 2009, p. 235. Publié d’abord in David Carroll (dir.), The States of “Theory”: History, Art, and Critical Discourse, New York, Columbia University Press, 1990. Pour les précisions concernant l’édition française que je cite ici ainsi que sa première publication en anglais, voir la note de la page 223.
[3] Id., Séminaire La bête et le souverain. Volume I (2001-2002), Paris, Galilée, 2008, p. 193.
[4] Ce criblage devrait nous conduire également vers l’autre face de cette fausse monnaie qu’est mon texte : la lecture. La question qui la stimulerait serait donc la suivante : « comment lisons-nous à l’époque de la clôture ? », mais tel n’est pas ici mon but. Même si je le signale maintenant en guise d’indication, je reconnais ma dette envers Michel Lisse, pour penser et écrire ces textes sur la glôture, et je renvoie à L’Expérience de la lecture et, plus précisément, à sa description d’une lecture criblante ou, comme il l’appelle, « scribblante » : « Une telle lecture qui, à la fois, sépare, discerne, raffine, s’arrête et repart sans cesse, récuse la lecture pensée comme rassemblement dans une unité totalisante», Michel Lisse, L’Expérience de la lecture 2. Le glissement,Paris, Galilée, 2001, p. 80. Même si les guillemets passent, effectivement, au crible, c’est aussi bien pour l’écrivain que pour le lecteur ; cet arrêt, cette suspension qu’ils provoquent, c’est toujours pour l’un et l’autre, et pour les rendre indiscernables dans leurs rôles : le lecteur devient en quelque sorte l’écrivain de son texte au moment où il s’arrête devant les guillemets. Quoiqu’il n’aborde pas cet « effet » des guillemets, je pense que ce livre de Michel Lisse expose mieux que tout autre cette « confusion » des rôles entre lecture et écriture. C’est encore dans ce livre que je prélèverai une réponse à la question de savoir comment nous écrivons à l’époque de la clôture, à savoir : en lisant très attentivement.
[5] Jacques Derrida, « Voice II », in Points de suspension, Paris, Galilée, 1992, p. 178. C’est moi qui souligne. Sur cette performance lire aussi : « je fais quelque chose, je fais des gestes à travers l’écriture, des gestes d’écriture, qui sont eux-mêmes performatifs, qui posent et transforment les “concepts” en question. », Id., « La mélancolie d’Abraham. Entretien avec Michal Ben-Naftali », Les Temps Modernes, n. 669/670, Juillet-Octobre 2012, p. 31.
[6] Nous pouvons également consulter une autre lecture attentive des guillemets heideggériens concernant le « es gibt » et le « ist » de Zeit und Sein, dans la Onzième Séance du séminaire de Derrida Donner le temps II, Paris, Seuil, 2021, p. 119 sq.
[7] Id.,Heidegger et la question. De l’esprit et autres essais [Galilée 1987], Paris, Flammarion, 2010, p. 36.
[8] Ibid., p. 42.
[9] Ibid., p. 42-43.
[10] Jacques Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question, op. cit., p. 43.
[11] Ibid., p. 45.
[12] Jacques Derrida, « Pas », in Parages, Paris, Galilée, 2003, p. 84.
[13] Ibid., p. 85.
[14] Ibid., p. 86.
[15] Jacques Derrida, « La différance », in Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 13.
[16] Id., De l’esprit. Heidegger et la question, op. cit., p. 54.
[17] Id.,« Entre crochets », in Points de suspension, Paris, Galilée,1992, p. 17.
[18] Jacques Derrida, « De l’économie restreinte à l’économie générale », in L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 385.
[19] Ibid., p. 385-386.
[20] Ibid., p. 386.
[21] Jacques Derrida, « De l’économie restreinte à l’économie générale », op. cit., p. 387.
[22] Id., Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2000, p. 340-341.
[23] Ibid., p. 341.
[24] Ibid., p. 256.
[25] Ibid., p. 263, note 3.
[26] Ibid., p. 83.
[27] Ibidem.
[28] Ibid., p. 323.
[29] Ibidem.
[30] Ibid., p. 324.
[31] Pour ne citer qu’un exemple, je rappelle, dès le début, cette digression sur le « il n’y a pas “le” corps » chez Nancy. Ici Derrida va parler de son « geste déconstructeur » (Le toucher…, p. 323) sans guillemets. Il n’en reste pas moins que cette dénomination de « geste » pourrait très bien faire fonction de guillemets en tant qu’il donne à penser un certain écart par rapport à toutes sortes d’affirmations de type méthodologiques qui, évidemment, n’auraient pas de sens à ce moment-là du texte de Derrida.
[32] Ibid., p. 324.
[33] Je rappelle ici l’explication que donne Peggy Kamuf afin de ne pas écrire tout le temps « littérature » entre guillemets : « It is tedious to write repeatedly “literature” in quotation marks. » (The Division | Of literature, Chicago, University of Chicago Press, 1997, p. 6). Avant de les enlever, elle nous explique également ce que signifient ces guillemets ; les nombreuses conventions, traditions ou pratiques qui configurent l’usage et le sens du mot « literature » sans pour autant clôturer ce que ce mot peut signifier : « This indeterminability of what is (or is not) literature, of what properly belongs to the set called literature, is not a contingent condition but a necessary one of continuing to call “literature” by that name » (ibid., p. 6). Ici les guillemets cherchent à sauvegarder cette multiplicité sans détermination de ce qu’est ou pourrait être la littérature afin de conserver justement, sans pour autant le conditionner, ce que dit le mot « littérature », mais encore afin d’expliquer pourquoi toute une histoire institutionnelle et conventionnelle a été incapable de domestiquer ce mot.
[34] Que voudraient dire ici mes guillemets autour du mot « unique » ? Est-ce qu’ils cherchent, tout simplement, à jouer avec la possibilité de distinguer de façon sûre et certaine les positions de Derrida et de Nancy concernant le tact ? Il s’agit là, sans doute, d’une façon risquée de traiter cette question. Risque que court mon texte, en parlant à la limite, de se transformer en une sorte de méthodologisation de la déconstruction, en privilégiant une position par rapport à l’autre. « Avouer le risque pris, l’assumer sans vergogne, cela ne suffit certes pas à le limiter », dit Derrida au début de Le toucher… (p. 10). Néanmoins, il y a peu de choses qui seraient aussi limitatrices de l’avenir que chercher à contrôler les risques.
[35] Ibid., p. 324.
[36] « [J]e savais “zaper” avant même que la télévision ne m’en donne la jouissance, comme j’ai toujours zapé dans l’écriture » (Jacques Derrida, « Circonfession, in Id. et Geoffrey Bennington, Jacques Derrida,Paris, Seuil, 1991, p. 164-165). Je remercie ici Ramiro Moar pour cette référence que, bien entendu, il faudrait miner, creuser, fouiller davantage afin, surtout, de mieux comprendre cette manière de commencer « quelque part où nous sommes » (Jacques Derrida, De la grammatologie, op. cit.,p. 233).
[37] Jacques Derrida, Le toucher…, op. cit., p. 348.
[38] Ibid., p. 347.
[39] Jacques Derrida, « La mélancolie d’Abraham. Entretien avec Michal Ben-Naftali », op. cit., p. 31.
[40] Ibid., 33-34.
[41] Quant à ce que le terme « conditions » peut signifier, voir Jacques Derrida, Donner le temps 1, Paris, Galilée, 1991, p. 31-32.
[42] Néanmoins, Derrida hésite sur l’usage du mot « clôture » en ce qui concerne la métaphysique. Dans un entretien de 1976, par exemple, il va défendre que celle-là est nécessaire en même temps qu’il signale son insuffisance : « Les énoncés discursifs sur la clôture sont nécessaires : mais insuffisants si l’on veut déformer la clôture, la déplacer aussi. […+ C’est cette forme clôture qu’à travers chaque clôture il s’agit peut-être de piéger. […] S’agit toujours d’un piège, donc : piéger la clôture au point qu’on n’arrive plus à se rassurer dans la circonprescription d’un code » (Points de suspension, op. cit., p. 26). Tandis que, en 1999, il déclare : « La figure de la clôture n’est pas très satisfaisante non plus. Je ne me sers plus de ces mots-là. Ce n’est pas que je renie de ce moment pédagogique ou stratégique, mais je crois inopportun de me servir davantage de ces mots-là » (in Dominique Janicaud, Heidegger en France, t. 2, Paris, Hachette, 2001, p. 102). À défaut d’une vérification statistique, il me semble que les derniers textes de Derrida font à peine mention de la « clôture de la métaphysique ». Je crois nonobstant que, en nous guidant peut-être sur les « logiques de la clôture », on peut en trouver une approche à partir de quelques réflexions sur le seuil, dans le premier tome du Séminaire La Bête et le souverain (op. cit., p. 411-412) : « Toujours le seuil, donc. Qu’est-ce que le seuil ? Et dès lors qu’on dit le seuil, LE seuil, l’unité insécable et atomique du seuil, d’un seul seuil, on le suppose indivisible ; on lui suppose la forme d’une ligne de démarcation aussi indivisible qu’une ligne sans épaisseur qu’on ne pourrait franchir ou se voir interdire de franchir qu’un instant ponctuel et en un pas lui-même indivisible. »
[43] Au-delà des réticences de Derrida à l’égard de certains mots dont, parmi les plus polémiques, ceux de « communauté » et de « fraternité », nous ne constatons pas, de sa part, vis-à-vis de ceux-ci cette attitude prononcée de refus que nous trouvons, par contre, vis-à-vis du mot « mariage » : « Si j’étais législateur, je proposerais tout simplement la disparition du mot et du concept de “mariage” dans un code civil et laïque. […] En supprimant le mot et le concept de “mariage”, cette équivoque ou cette hypocrisie religieuse et sacrale, qui n’a aucune place dans une constitution laïque, on les remplacerait par une “union civile” contractuelle » (Apprendre à vivre enfin, Paris, Galilée, 2005, p. 41-42). Je pense, cependant, que même si Derrida articule son rejet de façon, en partie, historique ou théorique, il n’en parle pas moins d’un point de vue aussi bien social qu’académique. Je sais bien que mon texte vise surtout la façon dont nous écrivons « philosophie » à l’époque de la clôture sans pour autant, malgré tout, quitter l’« académie » (s’il y en a), un milieu qui, bien entendu, peut parfaitement contaminer le terrain social, un autre espace dans lequel, il est vrai, le rejet, voire l’abandon de certains mots répond à d’autres impératifs, à n’en pas douter, plus justes et urgents que ceux que j’aborde ici.
[44] Jacques Derrida, « Some Statements… », op. cit., p. 233.
[45] Ibidem.
[46] Ibidem.
[47] Ibidem.
[48] Jacques Derrida, « Invention de l’autre », in Psyché. Inventions de l’autre, t. 1, Paris, Galilée, 1998, p. 53-54.
[49] Cf. Jean-Pierre Moussaron, « L’esprit de la lettre », in Marie-Louise Mallet et Ginette Michaud (dir.), Cahier de L’Herne Derrida, Paris, Éditions de L’Herne, 2004, p. 363-371, qui compile les nombreuses inventions de Derrida impliquant « la création d’un autre paysage de la pensée renouvelée à partir de l’intérieur même du langage » (p. 368).