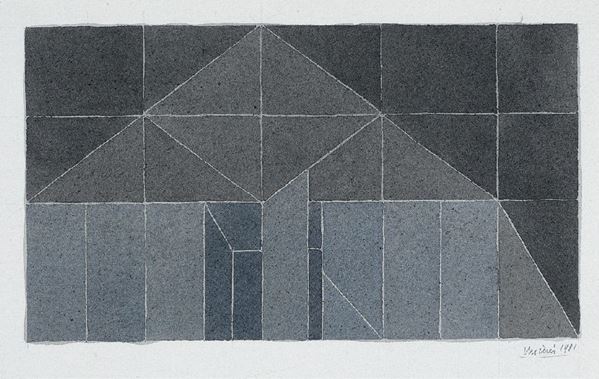Bruno PADILHA*, Du réel : « comme si c’était… », revue ITER Nº3, 2024.
La singularité de la pensée derridienne, stimulante et hyperbolique, aura provoqué, très tôt, des réactions « allergiques »[1]. N’épuisant pas du tout l’accueil de la déconstruction, ces réponses ont néanmoins laissé des marques dans le parcours et dans l’œuvre du philosophe français. À plusieurs reprises, Derrida, lui-même, a dû réagir à ces incompréhensions – nous donnant ainsi des pistes pour une lecture plus vigilante de ses textes et de ses interventions. Or, c’est précisément l’une de ces incompréhensions qui motive notre texte, notamment la très connue accusation d’« idéalisme textuel »[2].
Afin d’éclaircir ce qui nous semble être un sérieux malentendu, nous aborderons cette problématique par le biais du comme si – qui, dans sa multiplicité, donne le ton à ce troisième numéro de la revue ITER. Ainsi, tout d’abord, il faut signaler qu’un tel syncatégorème ne tombe pas du ciel dans la pensée du philosophe, mais qu’il est précisément justifié par ce qui la meut, à savoir la déconstruction de la présence. On pourrait peut-être aussi mentionner que Derrida questionne les conditions de possibilité de la présence plutôt que de l’accepter – presque dogmatiquement– comme simple et originaire.
En effet, la déconstruction a souvent été vue comme une affirmation de l’impossibilité de « toucher le réel », en nous enfermant ainsi dans la textualité. C’est d’ailleurs ainsi que le fameux « il n’y a pas de hors-texte »[3] est rentré dans l’histoire : une affirmation de l’impossibilité d’échapper au jeu permanent des substitutions et des renvois, en oubliant de cette façon tout ce que Derrida affirme explicitement dans La dissémination :
« Avancer qu’il n’y a pas de hors-texte absolu, ce n’est pas postuler une immanence idéale, la reconstitution incessante d’un rapport à soi de l’écriture. […] Le texte affirme le dehors, marque la limite de cette opération spéculative, déconstruit et réduit à des “effets” tous les prédicats par lesquels la spéculation s’approprie le dehors. »[4]
Très tôt le philosophe nous avertit contre une telle lecture du texte comme unité et identité pleine d’où on ne saurait sortir[5], comme le montre la suite du passage précédent :
« S’il n’y a rien hors du texte, cela implique, avec la transformation du concept de texte en général, que celui-ci ne soit plus le dedans calfeutré d’une intériorité ou d’une identité à soi »[6].
Dès lors, ce qu’on doit au moins – et pour l’instant – indiquer, c’est que le texte, « la transformation du concept de texte en général », relance, à nouveau, le rapport entre le dedans et le dehors – par exemple, entre le langage et son autre, ladite réalité. Ainsi, on ne peut pas affirmer d’avance que la déconstruction est simplement la négation d’une quelconque extériorité par rapport au texte, comme si ce dernier était quelque chose de parfaitement et pleinement identifiable. Aussi importantes que le célèbre « il n’y a pas de hors-texte », on comptera toutes les maintes fois où Derrida – parfois en commentant son travail – a insisté sur l’irréductible affirmation du réel dont sa pensée témoigne. Cela non seulement quand il affirme que la « déconstruction c’est ce qui arrive »[7], mais aussi en proposant d’autres « définitions » de la déconstruction dans des situations et des contextes assez hétérogènes[8]. L’essentiel est de toujours souligner la dimension du dehors et de l’altérité que la déconstruction porte et qui porte la déconstruction.
On peut aussi citer les déclarations de Derrida dans un entretien avec Richard Kearney («La déconstruction et l’autre »[9]) qui nous semblent, à ce sujet, très pertinentes et significatives. À la question de Richard Kearney, portant sur le rapport entre langage et référence, naturellement du point de vue de la pensée derridienne (« Qu’en est-il du langage comme référence ? Le langage peut-il se référer en tant que mutation, violence ou monstruosité, à quelque chose d’autre que lui-même ?»[10]), le philosophe répond de manière claire et catégorique :
« Il existe de nombreux malentendus sur ce que d’autres “déconstructionnistes” et moi-même essayons de faire. Il est totalement faux de prétendre que la “déconstruction” est une suspension de référence. »[11]
D’abord, Derrida commence par souligner les nombreux discours concernant ladite suspension de la réalité, qui serait comme synonyme de déconstruction. En fin de compte, dans la phrase suivante, le philosophe évoque même que « la “déconstruction” est profondément préoccupée par l’autre du langage. »[12] D’ailleurs, dit-il, « la critique du logocentrisme est par-dessus tout la recherche de l’autre et de l’autre du langage. »[13] Or, cette dernière phrase justifie déjà notre intention d’analyser le sens par lequel la déconstruction de la présence, de la simplicité de la présence, comme nous l’avons dit antérieurement, avance au nom de ce que le philosophe appelle « irréductibilité du réel » dans « Comme si c’était possible, “within such limits”… »[14]. Voici l’extrait dont il est question ici :
« Quant à la déconstruction du logocentrisme, du linguisticisme, de l’économisme (du propre et du chez-soi, oikos, du même), etc., quant à l’affirmation de l’impossible, elles se sont toujours avancées au nom du réel, de la réalité irréductible du réel »[15].
Il nous semble que le philosophe prétend soustraire ce réel aux valeurs de pure présence. Selon la tradition philosophique, cette présence doit fréquemment être arrachée aux ombres ou à la dissimulation. La philosophie serait précisément cette chasse au réel, à la pleine présence (qui est en soi et pour soi-même, comme nous l’indique Platon sur les formes dans Phédon[16] – les réalités immutables, toujours identiques à elles-mêmes). Réel, dans une perspective philosophique, c’est ce qui est. Dans cette optique, ce que nous enseigne peut-être Derrida ce sont, précisément, les présuppositions de cette petite phrase d’allure tautologique.
Avant de répondre à nos inquiétudes, nous devons rapidement clarifier la question du « comme si » dans sa relation au réel. Rappelons la question de Kearney qui prolonge la réponse antérieure de Derrida, et où il est fait mention de la « monstruosité »[17] liée, dans ce contexte, à la question du langage et de la possibilité de la référence. Or, on le sait, la philosophie s’est toujours imposée en tant que combat contre la monstruosité (qu’elle soit perçue comme production fantaisiste ou comme équivoque) ; pour elle, le monstre est le langage se séparant et se libérant de ce qui est véritablement – en produisant, ainsi, des monstres. Chez Platon, par exemple, il y a la référence au croquemitaine (mormolukeion), « être verbal »[18] qui nous effraie[19]. En conséquence, la philosophie n’est peut-être que la « plus haute musique » pour dissiper de tels monstres et fantaisies : seulement en elle et à travers elle, nous pouvons contempler ce qui est véritablement – la plus réelle réalité. Le langage doit, donc, être soumis à ce qui lui est antérieur et c’est uniquement sous cette condition qu’il peut avoir du sens[20]. Le rêve de la philosophie est un langage univoque ; ou plutôt, comme nous le précise Derrida, le langage univoque n’est pas le rêve de la philosophie, mais la philosophie même[21].
D’autre part, dans L’Université sans condition, le philosophe fait référence à un certain comme si, tournant autour de l’arbitraire, de l’imagination, du rêve[22], en somme, nous croyons pouvoir le dire, de la fiction et de la fictionnalité (et, par conséquent, du monstre et de la monstruosité). Bien que, comme Derrida nous en avertit, son recours au comme si ne se limite pas à cette modalité[23], dans ce texte nous voudrions pourtant nous centrer sur la question d’une certaine fictionnalité repensée par le philosophe au-delà de la distinction entre réel et fiction. À ce propos, Derrida indique de nouveau dans L’Université sans condition que « dès qu’il y a une trace, quelque virtualisation est en cours » et, ainsi, une certaine fictionnalité, un certain « comme si »[24]. Il nous faudra comprendre pourquoi cette certaine fictionnalité ou monstruosité ne portent pas en elles une forme de négation de la réalité.
En nous laissant guider par les mots de Derrida, nous devrons d’abord 1) comprendre dans quelle mesure la déconstruction de la distinction réel/fiction n’est pas un simple accident de parcours, qui, s’il ne peut être évité, pourra finalement être résolu. Ensuite, 2) il faudra expliciter en quoi cette déconstruction n’implique pas la suspension de la réalité, mais conduit vers une autre pensée de la réalité. Dans quel sens la déconstruction de la présence et du logocentrisme est-elle aussi une déconstruction du réalisme[25] et, de ce fait, la construction d’une autre « conception » de la réalité du réel ?
1. Du comme si « originaire »
Tout d’abord, nous devons expliquer en quoi la déconstruction derridienne de la métaphysique de la présence et du logocentrisme conduit au « comme si » derridien.
Dans ce sens, nous voudrions caractériser, très sommairement, chacun de ces gestes qui, selon Derrida, constituent une voix majeure du texte de la tradition philosophique et scientifique – dans lequel, d’une certaine manière, on vit peut-être encore – sans l’épuiser. Nous estimons qu’ils peuvent être définis par ce que le philosophe appelle le « signifié transcendantal ». C’est Derrida lui-même qui nous le dit :
« Nous avons identifié le logocentrisme et la métaphysique de la présence comme le désir exigeant, puissant, systématique et irrépressible, d’un tel signifié. »[26]
« D’un tel signifié », c’est-à-dire, d’un signifié transcendantal. Il faut remarquer, tout de suite, que Derrida qualifie un tel désir (d’un signifié transcendantal) d’« irrépressible », et qu’il n’est pas seulement un accident, une contingence ou un quelconque caprice. Nous verrons, d’ailleurs, de quelle façon ce désir est plus exactement un produit, ou plutôt une trace, de ce qui rend son accomplissement impossible.
Toutefois, que veut dire « signifié transcendantal » ? À la suite de notre réflexion, nous dirions qu’à travers cette expression, on prétend à une réalité (soit-elle l’idée au sens platonicien, Dieu, le sujet, ou même la matière, etc. – en tout cas, ce qui subsiste per se) qui soit antérieure à tout système de signification (linguistique, pictural, graphique, etc.), et même qui le rende possible. Cette réalité est « ce qui est » en soi et par soi-même (Platon, dans le Phédon, s’appuie sur l’expression αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ pour parler de la réalité des idées[27]). Nous dirions qu’une telle thèse, une telle position, définit la métaphysique de la présence. « Ce qui est » est, et ne dépend pas d’un mouvement de signification. Encore une fois, Derrida est assez précis au moment d’expliciter ce qui est ici en jeu. Dans « La double séance », le philosophe écrit : « Il y a d’abord ce qui est, la “réalité”, la chose même, en chair et en os »[28]. D’abord donc « la chose même », « en chair et en os », et, seulement après, l’image, la représentation, « l’inscription ou transcription de la chose même »[29]. Au commencement, c’était la pleine présence, l’origine pure absolument identique à elle-même.
Nous pouvons maintenant comprendre la portée radicale, hyper-radicale même – car, d’abord, la déconstruction derridienne remet en question la quête de la racine, du fondement – du geste de Derrida, quand il écrit qu’« il n’y a donc que des signes dès lors qu’il y a du sens »[30]. Phrase laconique qui, pourtant, ne peut que faire trembler la métaphysique, en travaillant sur (sa) limite pour des raisons déductibles de ce que nous énonçons. Si, depuis qu’il y a du sens, il y a des signes, on ne peut plus parler d’un signifié transcendantal extérieur et antérieur au jeu des différences comme origine du sens. Les différences sont, pour le dire de façon inadéquate mais peut-être compréhensible, l’« origine » du sens. Autrement dit, il n’y pas d’origine, c’est-à-dire, pas de fondement ultime ou de racine. Un mot, un signe ont du sens non pas parce qu’ils expriment une idée, un concept, ou une « réalité sensible », qui ne renverraient qu’à eux-mêmes, mettant ainsi fin au jeu de renvois[31], mais parce qu’ils sont, essentiellement, structurellement, dans leur « dedans » même, liés à d’autres mots et à d’autres signes. Cependant, puisque finalement le concept de signe implique l’architecture métaphysique (et, donc, la position d’un « signifié transcendantal »), Derrida favorisera le terme de « marque » – pour certes échapper aux déterminations métaphysiques, mais aussi pour étendre ce jeu de différences au-delà dudit langage humain. Il faut néanmoins souligner que – disons-le, momentanément, à l’aide d’une terminologie plutôt heideggérienne – si ce n’est pas par le pouvoir du logos que nous avons un rapport au « comme tel »[32], ce n’est pas non plus parce que nous sommes condamnés au langage que ce « comme tel », l’entité des étants, nous échappe à jamais. Ce n’est pas qu’il y ait eu ou qu’il y ait un paradis avant le langage, dans lequel on toucherait la réalité en chair et en os. Cette idée d’un tel paradis n’est elle-même qu’un effet du jeu de renvois des marques, où chacune est structurellement constituée par la trace des autres[33]. Nous croyons surtout que c’est la notion même d’une réalité « en chair et en os » (accessible ou non aux sujets humains) que Derrida remet en cause.
Bien que Derrida affirme, notamment dans La voix et le phénomène, que « la chose même se dérobe toujours »[34], on ne doit pas entendre dans cette affirmation la simple confirmation d’une impossibilité pour l’homme d’atteindre et de saisir les « choses mêmes ». Pour revenir une fois encore au célèbre « il n’y a pas de hors-texte », cela ne signifie pas que nous soyons condamnés, enfermés dans le « texte », incapables de sauter par-dessus ce dernier et de regarder le réel. Et, ainsi, nous devons souligner que s’il n’y a pas de hors de texte, c’est, précisément, parce que le mouvement des productions des différences (l’un des « aspects » de la différance) est déjà en scène partout – plus vieux et rendant possible ce que l’on appelle, plus communément, le langage. Or, si rien ne lui échappe, le texte non plus ne peut pas occuper la place d’une identité à soi qui ne serait pas aussi traversée par un tel mouvement. En bref, le mouvement de production des différences annonce en même temps le différer d’une supposée identité pleine, non parce qu’il est déjà trop tard ou encore trop tôt (la différance n’a pas d’âge, intempestive, on doit la penser selon le toujours déjà[35]), mais dans la mesure où toute identité, tout sens n’est possible qu’avec l’ouverture au(x) autre(s). Autrement dit, et en utilisant des termes plus proches de notre problématique, nous estimons pouvoir affirmer que tout « comme tel » est, en effet, essentiellement (re-)marqué par un « comme si », non seulement à cause du fait que toute identité à soi est elle-même une fiction (nécessaire, mais qui n’existe pas – toute identité est déjà toujours fissurée et divisée), mais aussi en ce que ladite « identité » (d’un concept, d’un mot, enfin, d’une marque) est déjà promise à la répétition, à l’itérabilité[36] – car il n’y a pas de signifié transcendantal auquel elle serait, définitivement, ancrée.
Ainsi, pour Derrida, un certain « comme si », une certaine fictionnalité marquent non simplement tout le langage, mais également tout ce qui est, tout ce qui apparaît. Il n’y a pas de présence sans cet écart, cette division ou cette « archi-synthèse irréductible »[37].
À ce propos, on peut lire dans « Comme si c’était possible, “within such limits”… » ce passage très important :
« Mais il fallait avant tout pendre en compte la possibilité essentielle d’un “comme si” qui affecte de fictionnalité, de phantasmaticité, de spectralité possibles tout langage et toute l’expérience. »[38]
Dans ce contexte, le philosophe lie le « comme si » à la question du « quasi-transcendantal », syntagme auquel Derrida fait souvent appel pour caractériser l’hyper-radicalisme de la déconstruction[39]. La différance, la trace, le supplément, etc. – termes ou notions auxquels, dans divers contextes, Derrida fait appel pour, d’une certaine façon, donner à penser les conditions de possibilité, dans un style presque kantien, de l’expérience, du langage, du sens – ne peuvent, cependant, être entendus en tant que dimension soit subjective soit an-historique. Derrida ne pourrait être plus précis et explicite à ce sujet :
« Nous ne savons donc plus si ce qui s’est toujours présenté comme re-présentation dérivée et modifiée de la simple présentation, comme “supplément”, “signe”, “écriture”, “trace”, n’“est” pas, en un sens nécessairement mais nouvellement an-historique, plus “vieux” que la présence et que le système de la vérité, plus vieux que l’“histoire”. »[40]
Par conséquent, ces conditions (l’écriture, le supplément, le signe, etc.) ne nous renvoient pas à une présence pleine originaire, ou bien à un autre monde ou à des lois immuables (par exemple, les lois de l’entendement) – mais elles sont plutôt les conditions de possibilité de l’histoire et du monde même : plus âgées que quelque structure ou sujet transcendantal. Elles en sont l’ouverture et empêchent leur homogénéisation. Dans cette logique, il est inconcevable de déclarer que la réalité à laquelle nous avons accès est toujours et nécessairement marquée par des conditions et des structures a priori dudit sujet. Finalement, le « comme si » ne relève pas – comme nous l’avons déjà noté[41] – des « jugements réfléchissants » compris comme un pont entre phénomène et noumène, entre nécessité et liberté.
Le « comme si » ne vient donc pas masquer, fictionnaliser n’importe quelle présence préalable et indépendante (qu’elle soit du sujet ou de la réalité antérieure à sa «re-présentation »). Il n’y a pas de présence sans un tel « comme si ». Il n’y a pas de réalité ou de réel sans « comme si ». De cette manière, pour qu’il y ait du X, pour que X apparaisse, pour que X soit, il faut, dans un certain sens, que X n’apparaisse pas (comme tel), que X ne soit pas (en tant que présence pure et pleine). Les conditions de possibilité sont aussi des conditions d’impossibilité. Pas de réel hors de l’effet de la trace, de l’écriture, etc. À travers les beaux mots de Derrida, dans « Ellipse » : «la mort est à l’aube parce que tout a commencé par la répétition »[42]. Comme on le dit en portugais, le comme si « acorda ou vem de véspera como o gaiteiro » (traduit littéralement, « il s’éveille à la veille comme le joueur de cornemuse »).
2. Ce qui reste : l’inconditionnalité du réel
« Le da n’est pas là, hic et nunc, mais il ne manque pas. »[43]
Cette affirmation de Jacques Derrida dans « + R (par-dessus le marché) » nous aidera à expliciter les difficultés que nous sentons ici dans la formulation de nos questions.
En effet, nous avons vu de quelle façon la différance – plus « vieille », d’une vieillesse sans âge (concernant le temps du monde, de l’entité, du sujet, etc.) – évoque, plus précisément, que tout ce qui arrive est déjà marqué par l’altérité. La différance (est) la « trace (pure) », « archi-trace »[44]. Dans ce sens, par exemple, le signe ne peut plus être compris en tant qu’« étant à la place d’une autre chose » – d’une réalité pleinement identique à soi, c’est-à-dire, une pure présence[45]. La déconstruction derridienne nous rappelle, effectivement, que tout a déjà commencé par le signe, ou plutôt la marque. Aucune réalité préalable, aucune chose même mettrait fin au(x) renvoi(s) à l’autre qui constitue l’identité « propre » de chaque marque.
Le mouvement de la différance implique, par conséquent, un certain « comme si » qui ne peut que marquer (comme le dit très bien Fernanda Bernardo) toute unidentité. C’est, finalement, celle-ci qui se voit, de ce fait, questionnée dans sa simplicité et son indivisibilité. L’identité même de la philosophie est aussi en danger. En effet, Socrate affirme dans La République :
« Si les philosophes sont ceux qui sont d’atteindre à ce qui existe toujours d’une manière immuable, et s’il faut refuser ce titre à ceux qui en sont incapables et qui s’égarent dans ce qui est multiple et changeant »[46].
Or, ne venons-nous pas de constater que, selon Derrida, un tel désir est non seulement un leurre, mais il est aussi rendu possible par ce qui le rend impossible ? Il n’y a pas d’identité pure, car tout commence déjà par cette archi-synthèse – identité et différence – que Derrida nous donne à penser. La limite que la philosophie a prétendu établir entre soi et les autres, ses autres (le mythe, la sophistique, l’art, pour n’en nommer que quelques-uns) se trouve ainsi fissurée. Non pas que Derrida affirme que tout s’équivaut, ou que le discours philosophique ne diffère en rien du discours littéraire ou artistique – ce qui reviendrait à nier toute identité et toute différence. Si chaque marque n’est pas indexée à une présence, elle n’est pas davantage un vide complet. S’il n’y a pas de sens sans contexte[47], que pourrait donc être une marque absolument vide ? Ce qui est par conséquent nié ou questionné, c’est l’existence d’un contexte (qui serait plutôt un sans-texte, au sens derridien du terme) absolument libre du jeu de renvois qui constitue la possibilité du sens. Il n’y a pas, répétons-le, de signifié transcendantal.
Néanmoins, un doute guette nos considérations : devant le caractère inéluctable du comme si, comment peut-on parler d’un respect pour l’irréductibilité du réel qui caractérise la déconstruction ? Rappelons les mots de Derrida dans l’entretien avec Richard Kearney :
« La “déconstruction” est profondément préoccupée par l’autre du langage. Je suis toujours surpris par les critiques qui voient dans mon travail la déclaration qu’il n’y a rien au-delà du langage, que nous sommes emprisonnés dans le langage. C’est tout le contraire. La critique du logocentrisme est par-dessus tout la recherche de l’autre et de l’autre du langage. »[48]
Or, ne faisons-nous pas l’avocat du diable, en montrant – souvent au moyen de citations – que les critiques de Derrida ont raison de dénoncer l’« idéalisme » de sa pensée ? Notre lecture ne serait-elle pas victime de la même incompréhension et du même aveuglement ? En d’autres termes, il semble que nous sommes en train d’affirmer que ce qu’on appelle réalité n’est qu’un effet de différance, comme si cette dernière n’était qu’une espèce de champ transcendantal sans sujet[49]. Celui à travers duquel ou à partir duquel a lieu tout ce qui peut avoir lieu.
En vérité, on ne devrait pas ignorer le mouvement (quasi-)transcendantal qui caractérise, aussi, la pensée derridienne. Le philosophe le dit lui-même, il s’agit de scruter les limites et les conditions de possibilité du discours philosophique et métaphysique :
« ce qui m’a paru nécessaire et urgent, dans la situation historique qui est la nôtre, c’est une détermination générale des conditions d’émergence et des limites de la philosophie, de la métaphysique, de tout ce qui la porte et de tout ce qu’elle porte. »[50]
Cependant il serait profondément injuste, et surtout incorrect, de réduire la déconstruction derridienne à ce geste, comme si la différance n’était qu’un nouveau « mot-clé ». Dans ce sens, il faut préciser qu’elle n’est pas un étant présent, un autre nom pour le hautement réel (ens supremum), et qu’elle ne nous renvoie à quelque chose d’inconnaissable ou d’ineffable. N’échappant pas au jeu qu’elle rend possible, la différance ne le contrôle pas non plus. En effet, nous la verrons souvent soumise au même jeu de substitution qu’« elle » ouvre (« supplément », « marque », « archi-écriture », etc., ou encore pour citer deux autres termes qui apparaîtront plus fréquemment dans les années 90, « khôra » et « messianique »). En somme, la différance n’a pas d’identité propre, elle n’échappe pas à la structure du « comme si » qu’elle rend, finalement, inévitable.
On se demandera, naturellement, que faire de l’irréductibilité du réel, si, finalement, ni même la différance échappe à la différance (en tant que production, ni active ni passive, des différences et différer de toute présence pure et pleine). Comme l’écrit Derrida :
« Le dehors, extériorité “spatiale” et “objective” dont nous croyons savoir ce qu’elle est comme la chose la plus familière du monde, comme la familiarité elle-même, n’apparaîtrait pas sans le gramme, sans la différance comme temporalisation, sans la non-présence de l’autre inscrite dans le sens du présent vivant. »[51]
Un tel dehors que nous nommons ici « réel » n’apparaît pas sans ce renvoi à l’autre. Renvoi qui, nous l’avons vu, n’évoque pas une quelconque présence passée ou future. L’autre n’est pas non plus. Dès lors, une fois encore, l’apparaître du réel est déjà comme hanté par un certain « comme si », une certaine fictionnalité. Toutefois, la solution à notre problème ne peut pas arriver – et nous espérons l’avoir démontré – grâce à l’affirmation d’une réalité, de quelque chose préalable à cet apparaître. Il n’y a pas de dehors mystérieux dont les secrets seraient insondables. Rappelons-le : il n’y a pas de hors-texte pur et simple. Pourtant, de l’autre côté, il n’y a pas de texte pur et simple ! D’ailleurs, nous avons vérifié comment la textualité, ou si nous le voulons l’ouverture à l’autre, à l’altérité, dans tout « entité », dans toute marque, empêche un tel dernier texte – autrement dit, pleinement présent à soi, sans failles. Il y a du reste – le reste n’est pas, reste toujours et à jamais.
Et c’est peut-être ce reste ab-solu (ab-solutus), irrémédiablement différé (parce qu’absolument étranger à la présence et au présent), qui nous conduit vers une autre pensée du réel. Le reste est-il quelque chose au-delà ou en-deçà du jeu de l’identité et de la différence, du « comme tel » et du « comme si » ? Pas du tout. Est-il, en conséquence, réductible à ce renvoi in-fini de la présence et de l’absence ? Non plus. Secret absolu[52], c’est-à-dire, secret sans secret. Il n’existe ici rien qui se cache – un noumène au-delà/en-deçà-phénomène. Comme l’écrit, précisément, Fernanda Bernardo :
« [I]l n’y a pas de hors-texte absolu, un hors-texte comme tel : le dehors du texte qui il y a, à savoir, le réfèrent qu’il y a, la chose qu’il y a, la réalité qu’il y a, l’événement qu’il y a ou l’affaire qu’il y a, qu’il faut archiver/ou inscrire/écrire, s’érige et sur-vit (spectralement) dans le texte ou dans le livre. »[53]
Il n’y a donc pas de discours sur, c’est à dire sur un quelconque dehors absolu. Il n’y a pas un dehors comme tel qui serait, ensuite, affecté par la finitude d’un discours plus ou moins limité et limitant. Presque toujours on a pensé la réalité comme la totalité des étants subsistants « en soi et pour soi » – même quand on a fait dépendre cette subsistance des structures a priori du sujet, par exemple, celles-ci ont été pensées par le recours à des notions telles que présence, substance, etc. Derrida nous montre que cela ne marche pourtant pas – tout en questionnant la présupposée unicité desdites entités subsistantes le philosophe nous donne à lire ce qui s’efface nécessairement, constitutivement, dans « ce que l’on croit entendre sous les noms de proximité, d’immédiateté, de présence »[54]. « Il n’y a pas de hors-texte absolu »[55], en effet, mais il n’y a pas non plus de texte absolu, parce qu’il se trouve toujours constitué par la trace d’autre « chose » à laquelle il renvoie in-finiment. La trace comme « ouverture de la première extériorité en général »[56] veut dire qu’il faut affirmer et penser tout autrement l’« irréductibilité du réel ». Il y a le réel, c’est-à-dire l’altérité ab-solue qui n’est qu’à travers le texte – ou plutôt en tant que texte. En déconstruisant la présence originaire, et ipso facto l’origine (pleine), il faut également déconstruire l’opposition réel/fiction – ce que nous avons envisagé de faire ici en suivant le fil du « comme si », afin d’entendre le texte de et dans la déconstruction comme affirmation du dehors, voire du réel[57].
La déconstruction reformule, ainsi, la sécurité de la distinction prétendue fondamentale entre la réalité et la fictionnalité – ou entre l’effectivité et la virtualité[58]. La conception du texte, de la textualité du texte – que beaucoup ont vue dans le schéma de l’idéalisme – est, au contraire – l’ouverture à une nouvelle pensée de l’irréductibilité du réel[59].
Source Image : Giuseppe Uncini – Sans titre (1981).
* Étudiant en doctorat à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, avec le soutien de FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia).
[1] Lee Braver (in A Thing of This World – a History of Continental Anti-Realism, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 2007, p. 431) dit même que Jacques Derrida fut certainement le plus « incompris » et « mal interprété [misconstrued] » philosophe de notre temps.
[2] Cf., notamment, John R. Searle, « The World Turned Upside Down » in Working Through Derrida, ed. Gary B. Madison, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1993, p. 171-177. Plus récentes et, peut-être même, plus étranges, ce sont les affirmations de Maurizio Ferraris, dans la postface à l’édition française de Le Goût du secret (« Postface : et nunc manet in te » in Jacques Derrida et Maurizio Ferraris, Le goût du secret, Paris, Hermann, 2018, p. 123). L’auteur semble faire écho au prétendu idéalisme de la déconstruction derridienne.
[3] Cf. par exemple, Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les Éditions du Minuit, 1967, p. 227.
[4] Jacques Derrida, La dissémination, Éditions du Seuil, coll. « Points essais » [1972], 1993, p. 47-48. Souligné par Derrida.
[5] Il faut signaler que le terme texte ne vise pas seulement des « écrits sur les pages ». Cf. Id., Positions, Paris, Les Éditions du Minuit, coll. « Critique », 1972, p. 82.
[6] Id., La Dissémination, op.cit., p. 48.
[7] Cf. Id.,« Fidélité à plus d’un » in « Idiomes, Nationalités, Déconstructions », Cahiers Intersignes nº 13, automne 1998, p. 261.
[8] Pour cette question, cf. Fernanda Bernardo, « Idiomas da Resistência e da Reinvenção (Desconstrução – Pensamento – Literatura) » in Derrida – o dom da Différance, Coimbra, Palimage, note 37, p. 59.
[9] La traduction française de cet entretien est disponible dans « La déconstruction et l’Autre » in « Derrida. L’événement Déconstruction », Les Temps Modernes, Juillet/Octobre 2012, nº 669/670, p. 7-29.
[10] Ibid., p. 25.
[11] Ibid., p. 26.
[12] Ibid. Souligné dans le texte.
[13] Ibid. Souligné dans le texte.
[14] Jacques Derrida, Papier Machine, Paris, Galilée, 2001.
[15] Ibid., p. 315.
[16] Platon, Œuvres complètes, t. IV, 1re partie : Phédon, trad. Léon Robin, Paris, Les Belles-Lettres, 1926, 78c.
[17] Pour une autre lecture et perspective sur cette « monstruosité », cf. Fernanda Bernardo, « “Perdão por não querer dizer…”: o segredo da literatura de Abraão a Derrida » in RCL|Convergência Lusíada, nº 34, juillet-décembre 2015, p. 55. Dans la note 36 de cette même page, l’auteure nous renvoie à Heidegger (Qu’appelle-t-on penser ? trad. Aloys Becker et Gérard Granel, 3ème éd., Paris, PUF, 1973, p. 28 – « Ce qui, en soi, selon son être [l’être de l’homme], est un Montrant, nous le nommons un “Monstre”. Dans le mouvement vers ce qui se retire, l’homme est Monstre. Parce que ce Monstre, cependant, montre dans la direction de ce qui se re-tire, il n’annonce pas tant ce qui se re-tire, mais plutôt le retirement lui-même. Le Monstre demeure sans signification »). Cette « figure » de la monstruosité apparaît déjà, comme le signale Fernanda Bernardo, dans « exergue » du livre De la grammatologie (op. cit., p. 14).
[18] Cf. Maria Patera, « Phobêtra et Mormolukeia. Figures de l’épouvante et de la peur dans l’imaginaire grec » in École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Annuaire, tome 113, 2004-2005, p. 455.
[19] Cf. Platon, Phédon, op.cit., 77e.
[20] Cf. Jacques Derrida, « La forme et le vouloir-dire » in Marges – de la philosophie, Paris, Les Editions de Minuit, p. 199.
[21] Id.., « La Mythologie Blanche » in Marges – de la philosophie, op. cit., p. 295.
[22] Id., L’Université sans condition, Paris, Galilée, 2001, p. 27.
[23] Dans L’Université sans condition, Derrida énonce trois possibilités 1) cette fictionnalité que nous avons évoquée ci-dessus, apparentée à l’imagination et au rêve, puis ces deux autres : 2) « ou bien est-ce que, seconde possibilité, par ce “comme si”, nous mettons en œuvre certains types de jugements, comme par exemple ces “jugements réfléchissants” dont Kant disait régulièrement qu’ils opéraient “comme si” (als ob) un entendement contenait ou comprenait l’unité de la variété des lois empiriques […] ? » (Ibid., p. 27) ; 3) « Est-ce que, enfin, troisième possibilité, un certain “comme si” ne marque pas, de mille façons, la structure et le mode d’être de tous les objets qui appartiennent au champ académique qu’on appelle les Humanités, les Humanités d’hier ou celles d’aujourd’hui et de demain ? » (Ibid., p. 30). À la fin de son texte, le philosophe déclare que « cette force accordée à une expérience du peut-être, elle garde sans doute une affinité ou une connivence avec le “si” ou le “comme si”. […] ce “comme si” n’est plus réductible à l’ordre de tous les “comme si” dont nous avons parlé jusqu’ici. » Ibid.,p. 76.
[24] Cf. Ibid., p. 25.
[25] Cf. Lee Braver, A Thing of This World, op. cit., p. 13-30.
[26] Jacques Derrida, De la grammatologie, op. cit., p. 71-72.
[27] « En soi et par soi » dans la traduction de Léon Robin. Cf. Platon, Phédon, op. cit., 100b.
[28] Jacques Derrida, La Dissémination, op.cit., p. 236.
[29] Ibid.
[30] Ibid., p. 73.
[31] Ibid., p. 71.
[32] Cf. Martin Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique – monde-finitude-solitude, trad. Daniel Panis, Paris, Gallimard, p. 1992, p. 397-400 et p. 435 sq. Lire, par exemple : « la structure de l’« en tant que » [die « als »-Struktur, qu’on peut aussi traduire, pour plus facilement la lier à notre question, par « structure du comme »] est, d’une façon générale, la condition de possibilité de ce λóγος. » Ibid., p. 454.
[33] Cf. Id., De la grammatologie, op. cit., p. 90.
[34] Id., La voix et le phénomène, Paris, PUF, coll. « Quadrige », [1967] 1993, p. 117.
[35] Cf. Jacques Derrida, Heidegger : la question de l’Être et l’Histoire. Cours de L’ENS-Ulm 1964-1965, Paris, Galilée, 2013, p. 77.
[36] Cf. Id., De la grammatologie, op. cit., p. 298 ; Jacques Derrida, Limited Inc., Paris, Galilée, 1990, p. 27 sq et p. 100.
[37] Ibid., p. 88.
[38] Id., Papier Machine, op. cit., p. 298.
[39]Autour de cette question du quasi-transcendantal, cf. Geoffrey Bennington, « Derridabase » in Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Derrida, Paris, Seuil, 2008, p. 223 sq. ; Rodolph Gasche, The Tain of the Mirror – Derrida and the Philosophy of Reflection, Cambridge/London, Harvard University Press, 1986, p. 212 sq.
[40] Jacques Derrida, La voix et le phénomène, op. cit., p. 116.
[41] Cf. supra, note 23.
[42] Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Seuil, coll. « Essais », p. 435.
[43] Jacques Derrida, La vérité en peinture, op. cit., p. 181.
[44] Id., De la grammatologie, op. cit., p. 89-92.
[45] Id., « Le puits et la pyramide » in Marges – de la philosophie, op. cit., p. 82-83.
[46] Platon, Œuvres complètes, Tome VII, 1ère partie : La République, livres IV-VII, trad. E. Chambry, Les Belles Lettres, 1933, 484a. On notera également la suite de ce passage : « lesquels parmi eux faut-il choisir comme chefs de la cité ? »
[47] Jacques Derrida, « Survivre » in Parages, éd. revue et augmentée, Paris, Galilée, 2003, p. 116.
[48] Id., « La deconstruction et l’autre », loc.cit.,, p. 26. Souligné dans le texte.
[49] Id., « Introduction » in Edmund Husserl, L’origine de la géométrie Paris, PUF, [1962] 2010, p. 84-85.
[50] Id., Positions, op. cit., p. 69.
[51] Id., De la grammatologie, op. cit., p. 103.
[52] Cf. Id., « La littérature au secret » in Donner la mort, Paris : Galilée, 1999.
[53] Fernanda Bernardo, « Idiomas da Resistência e da Reinvenção (Desconstrução – Pensamento – Literatura) », op. cit., p. 66-67 (c’est l’auteure qui souligne).
[54] Jacques Derrida, De la grammatologie, op. cit., p. 103
[55] Id., La dissémination, op. cit., p. 47-48.
[56] Id., De la grammatologie, op. cit., p. 103
[57] Cf. Id., La dissémination, op. cit., p. 48
[58] Cf. Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1994, p. 126.
[59] Cf. Timothy Mooney, « Derrida’s Empirical Realism » in Philosophy & Social Criticism, vol. 25(5), 1999, p. 33-56 ; Michael Marder, « Différance of the “Real” » in Parrhesia, nº 4, 2008, p. 49-61.